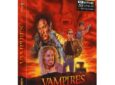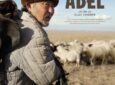Le festival de Gindou serait-il victime de son succès ? Peut-être encore davantage que l’an passé, cette édition a été marquée par une affluence record. En effet, faire la queue trois quarts d’heure avant une séance ne vous garantissait pas forcément un accès à la salle de l’Arsénic mais, fort heureusement, grâce à une excellente organisation et au dévouement des projectionnistes, certains films (à l’instar du poignant Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi) purent bénéficier d’une deuxième séance improvisée. Il fallait aussi un certain sens de l’organisation pour composer avec les aléas météorologiques. Si le festival débuta lors du dernier week-end caniculaire que connut la France cet été, la projection de Soulèvements de Thomas Lacoste en milieu de semaine fut interrompue par l’orage (ironie du sort, un violent coup de tonnerre se fit entendre au moment même où défilaient les images de grenades lacrymogènes lancées sur les manifestants de Sainte-Soline par la police) et, en attendant une accalmie et un sage repli vers la salle de l’Arsénic, le réalisateur put échanger quelques mots avec les spectateurs. Ce sont aussi ces aléas qui font le charme d’un festival qui a su garder une taille humaine et un esprit joyeux et bon enfant. A Gindou, pas de compétition mais des échanges, des partages, une curiosité et un amour du cinéma qui se conjuguent avec des valeurs humanistes (comme le rappelait André Bargues, président de l’association Gindou cinéma).
Pour ces 41es rencontres, Yolande Moreau était l’invitée d’honneur. L’occasion de revoir les films qu’elle a réalisés (notamment le beau Quand la mer monte) et ceux où elle tient la vedette (le désopilant Louise-Michel de Kervern et Delépine). L’occasion également de l’écouter évoquer son travail, ses rencontres (celle avec Agnès Varda qui fut l’une des premières à la faire tourner avec Sans toit ni loi) ou de raconter de nombreuses anecdotes, souvent irrésistibles, avec son ton inimitable.
A côté de cette petite rétrospective, les festivaliers se virent offrir un panorama riche (une quarantaine de films) de documentaires et de fictions regroupés sous le joli terme de « vagabondages ». Côté fiction, force est de constater que les véritables coups de cœur furent plus rares que l’an passé (Miséricorde, All we Imagine as Light, Slocum et moi…). Beaucoup de films jouaient la carte du « sujet de société » (homosexualité féminine, mariage pour tous, adoption, immigration, maladie…) sans toujours parvenir à se dépêtrer d’une certaine lourdeur démonstrative. On saura gré, néanmoins, à Pauline Loquès (Nino) d’avoir trouvé une certaine justesse de ton, entre humour et gravité, pour filmer la trajectoire de son jeune héros atteint d’un cancer. On saluera par ailleurs la performance du jeune comédien Théodore Pellerin qui traverse le récit en funambule avec une grâce constante. Sa ressemblance criante avec Grégoire Colin fait d’ailleurs le lien avec certains films de Claire Denis et une manière assez fine de traduire les émotions de manière atmosphérique plus que psychologique. On appréciera également, dans un autre registre, le parti-pris d’Alice Douard de vouloir faire rire d’un sujet sociétal (un couple de lesbiennes qui va avoir un enfant et qui oblige l’une d’elles à entamer des démarches d’adoption). Superbement interprétée par Monia Chokri (vue également dans le plus contestable Love me Tender d’Anna Cazenave Cambet) et Ella Rumpf (qui jouait dans Grave), Des preuves d’amour est une comédie assez fine et très bien écrite qui déjoue le pathos qu’on pouvait attendre d’un tel sujet et trouve un équilibre plaisant entre le rire franc (certaines scènes sont vraiment hilarantes) et l’émotion.
Il nous faudra sans doute revoir Kontinental’ 25 de Radu Jude pour l’apprécier à sa juste valeur. Difficile en effet de lutter contre la fatigue lors d’une séance retardée par l’orage et qui débuta à 0 h 30 passées. Le cinéaste roumain réalise ici un improbable remake du Europe 51 de Rossellini, débutant également par un suicide qui bouleverse l’existence d’une huissière de justice. Tourné avec les moyens du bord (un téléphone portable) mais offrant de très beaux moments de mise en scène, le film épouse la trajectoire de son héroïne qui, à l’instar du couple de Septembre sans attendre de Trueba, ne cesse de ressasser son histoire face aux individus qu’elle rencontre (son mari, ses supérieurs hiérarchiques, la police, un ancien étudiant ou encore un prêtre). Cette forme minimaliste permet pourtant à Radu Jude d’ausculter tous les maux de nos sociétés européennes contemporaines. Leur culpabilité et leur impuissance face à la marche dramatique du monde (le génocide à Gaza, l’envahissement de l’Ukraine par la Russie…) mais aussi les replis nationalistes (cette femme, d’origine hongroise, subit la xénophobie d’une frange de la population roumaine) et les dysfonctionnements d’une société passée du communisme autoritaire de Ceausescu au libéralisme sans barrière. Le cinéaste ne joue pas la carte de la démonstration didactique mais celle de l’allégorie ironique, parfois un brin austère (de très longs plans fixes), mais souvent mordante.
Météors, le nouveau film d’Hubert Charuel (Petit Paysan), co-signé par Claude Le Pape, n’est sans doute pas exempt de défauts mais il est constamment surprenant. Débutant comme une chronique autour de jeunes hommes un peu paumés et sans avenir, il parvient néanmoins à éviter l’écueil naturaliste auquel il semblait promis. Le récit débute même comme une pure comédie, avec un enlèvement de chat et une confrontation avec les flics d’une grande drôlerie. Puis ce sont les ruptures de ton qui caractérisent l’œuvre, glissant imperceptiblement de la chronique sociale vers le mélodrame autour des amitiés brisées. Mais ce qui séduit le plus, c’est la manière dont Charuel ancre ses personnages dans un territoire et une ville. L’action se déroule à Saint-Dizier, en Haute-Marne, au cœur de cette fameuse « diagonale du vide ». Mais plutôt que d’appuyer une vision misérabiliste, le cinéaste joue sur l’étrangeté de ses décors, qu’il s’agisse de cette étonnante tour Miko au cœur de la nuit ou encore les murs de béton de poubelles nucléaires où vont finir par travailler Mika et Dan. Le côté oppressant de ce décor confère parfois au film une dimension onirique, comme un cauchemar sans fin où les personnages sont constamment écrasés et annihilés. On regrettera une fin un peu plus convenue et le jeu parfois un peu approximatif de Paul Kircher*. Ses acolytes, Idir Azougli et Salif Cissé, sont, en revanche, parfaits.
Finalement, ce fut la Palme d’or du dernier festival de Cannes, Un simple accident de Jafar Panahi, qui domina la sélection. Après avoir amené sa voiture chez un garagiste, un homme est enlevé par un ancien prisonnier qui croit avoir reconnu en lui son tortionnaire. Renouant avec une forme circulaire qu’il affectionne (l’ancien prisonnier cherche à retrouver d’autres victimes afin de confirmer ses soupçons), Panahi signe un récit qui flirte avec le thriller, marqué par des éclats de violence (surtout psychologique mais parfois physique) assez inédits chez lui. D’une certaine manière, l’œuvre constitue le contrepoint idéal (pour ne pas dire l’antidote) aux Graines du figuier sauvage de Rasoulof. Dans les deux cas, un bon père de famille est soupçonné d’avoir participé aux exactions du régime et doit rendre des comptes.Il s’agit alors de poser la question des réparations ou de la « vengeance » et de savoir s’ils sont de simples exécutants d’un régime inique ou de vrais bourreaux. Victime lui-même de la République islamiste et bénéficiant toujours d’une liberté fragile (comme le rappelle le sidérant plan final), Panahi parvient pourtant à conserver une certaine distance nécessaire à la réflexion, évitant l’écueil où sombrait Rasoulof dans son dernier tiers lourdement démonstratif. Dans Un simple accident, la question de la vengeance est d’emblée questionnée. Se débarrasser sans procès des tortionnaires, c’est se placer à leur niveau et agir à leur manière. Sans angélisme (les réminiscences du passé qui, peu à peu, surgissent, sont terribles), Panahi opte néanmoins pour une croyance en l’humain, au remords et à une possibilité de pardon pour avancer vers un avenir meilleur. Le film n’est pas d’un optimisme béat (loin de là), souvent dur, mais il laisse encore une place à l’espoir et c’est ce qui le rend précieux.

© Les films Pelléas
***
Difficile, en revanche, de garder espoir face aux nombreux documentaires présentés dans la section « vagabondages ». Des ruines de Gaza dans Put Your Soul on Your Hand and Walk et sa jeune photographe palestinienne tragiquement décédée juste après la sélection du film à Cannes aux conditions de vie de migrants camerounais tentant de rejoindre l’Espagne via le Maroc dans Les Voyageurs (David Bingong) en passant par la situation des prisonniers dans la maison centrale de Poissy (Conversations de Bertrand Meunier), le tableau fut plutôt sombre. L’espoir subsiste néanmoins chez Thomas Lacoste qui donne la parole aux militants des « Soulèvements de la terre » dans son Soulèvements. Pour le coup, le tableau paraît presque trop idéalisé (aucune contradiction ne semble exister au sein du mouvement et les intervenants sont tous très beaux et extrêmement brillants) mais il reste salutaire à l’heure où ces défenseurs d’un monde plus respectueux de l’environnement sont criminalisés.
Par leurs qualités formelles et leur intensité, trois films se sont distingués. Nous reparlerons prochainement de Conversations puisque nous avons eu la chance de pouvoir interroger son réalisateur mais soulignons déjà que son dispositif minimaliste à la Depardon période Délits flagrants (un plan fixe, deux chaises et un échange entre un surveillant pénitentiaire et des prisonniers condamnés pour de longues peines) permet de recueillir des paroles aussi précieuses que rares (notamment du côté des surveillants) et de dresser un constat en creux alarmant autour de la situation des prisons en France. Aucun didactisme mais un sens du cinéma qui éclate le temps de deux plans généraux d’une puissance époustouflante, qui disent avec des moyens très ténus ce que peut représenter l’univers carcéral.
A l’opposé de cette approche assez austère, le Belge Johan Grimonprez opte avec Soundtrack to a Coup d’état pour un montage tonitruant et la collision permanente d’images d’archive hétéroclites, d’une bande-son très riche et de phrases (citations diverses, extraits de livres ou de journaux) collées à même l’écran. Partant d’un événement qui pourrait presque paraître anecdotique (l’interruption d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU en 1961 par la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques), le cinéaste embrasse la question de la décolonisation du Congo belge jusqu’à l’assassinat du premier ministre Lumumba favorisé par l’État belge et la CIA. A partir de cette histoire, c’est tous les soubresauts de la Guerre froide qui ressurgissent : Khrouchtchev, Nasser, Castro, la question des droits civiques pour les Noirs américains, la décolonisation de l’Afrique… Grimonprez brasse de nombreux éléments et son film a beau être d’une densité remarquable (2h30 d’informations en continu), il parvient à être toujours clair et « pédagogique ». On pourra lui reprocher parfois un parti-pris univoque (l’URSS et Cuba sont présentés sous leur meilleur jour, favorables à l’indépendance des anciennes colonies et alliés du tiers-monde) mais ce qui emporte au bout du compte l’adhésion, indépendamment de la richesse du contenu, c’est la manière dont le metteur en scène s’appuie sur la pulsation du jazz pour rythmer son montage. Nous découvrons, en effet, que le jazz fut, pour la C.I.A, une manière de promouvoir un certain modèle démocratique américain. Pensée comme un outil de propagande (Armstrong est envoyé en tournée en Afrique, avec des agents de la CIA dans son staff), cette musique représente pourtant un véritable élan émancipateur, avec des artistes militant pour la reconnaissance des droits civiques. Le film rend bien cette énergie créatrice et ce mouvement révolutionnaire qui cherche à tout emporter sur son passage mais qui se heurte aux écueils de l’Histoire et aux tentatives de récupérations politiciennes.
Après La Vierge, les Coptes et moi, le réalisateur franco-égyptien Namir Abdel Messeeh est venu présenter à Gindou son nouveau film, l’enthousiasmant La Vie après Siham. Reprenant les codes du « home-movie », il mêle divers types d’images : documentaire au présent, extraits de films familiaux (Super 8 ou vidéo), extraits de son film précédent mais également des films populaires égyptiens des années 60/70 ou de Youssef Chahine (on reconnaît Le Retour de l’enfant prodigue). Le tout pour évoquer avec beaucoup d’émotion la disparition de sa mère. Interrogeant le passé à travers les images, le cinéaste tente de se rapprocher de son père et lui faire parler de son histoire d’amour singulière. Il revient également sur son enfance puisqu’il fut laissé à une tante quand il était bébé dans un village de Haute-Égypte. Tout cela pourrait être larmoyant mais le film séduit au contraire par sa vivacité et son humour. Les extraits de films mélodramatiques servent à reconstituer l’histoire du père et de la mère de Messeeh et nous tiennent à distance du pathos. Conscient de son manque de moyens, le réalisateur bricole avec un matériau très intime un essai introspectif qui parvient néanmoins à acquérir une portée universelle.

© Météore films
***
A Gindou, une petite programmation patrimoniale (en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse) est toujours prévue. Cette année, il s’agissait de confronter autour d’un thème commun un regard masculin et un regard féminin. Pour évoquer le désir d’émancipation des femmes au début des années 60, nous pûmes revoir le facétieux (mais mineur) Une femme est une femme de Godard et découvrir, en face, l’étonnant La Dérive de Paula Delsol où la réalisatrice colle aux basques de son héroïne, Jacqueline, qui fait le difficile apprentissage de la liberté. Abandonnée par son compagnon avec qui elle avait pris la route, elle retourne dans sa famille à Palavas-les-Flots. Suivant les préceptes de la Nouvelle Vague, Paula Delsol filme son héroïne en toute liberté, épousant les mouvements de son désir et de ses envies. Sa manière de refuser les carcans de la famille classique (ce qui lui vaut les regards réprobateurs du voisinage) et de papillonner de garçon en garçon valurent au film une interdiction aux moins de 18 ans et une diffusion dans les salles malfamées de Pigalle. On ne plaisantait pas (encore) avec la liberté sexuelle à cette époque ! Il était amusant de voir ce film le même jour que Sans toit ni loi car on retrouve (de manière beaucoup plus légère) des scènes similaires : la prise en stop par un routier forcément libidineux, le moment où l’héroïne se retrouve prisonnière d’une fête de village et est prise de panique, symbolisant le rapport conflictuel au monde de Mona et de Jacqueline. Outre la liberté de ton et une mise en scène vive, on appréciera la manière dont la cinéaste évite la caricature. Si Jacqueline s’oppose par son attitude à un modèle familial conservateur et conformiste, cela n’empêche pas Paula Delsol d’offrir une chance aux personnages de la mère (Paulette Dubost) et de la sœur.
Deux documentaires « historiques » illustrèrent également, à leur manière, le combat des femmes pour la légalisation de l’avortement. Interdit de diffusion et même de projections privées, Histoires d’A. (1973) de Marielle Issartel et Charles Belmont est un formidable document sur les combats du M.L.A.C (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Il allie des qualités « pédagogiques » (une scène d’avortement, filmée avec pudeur mais en intégralité, d’une puissance rare) et un sens du montage étonnant qui permet au couple de réalisateurs de saisir la parole le temps de débats passionnants, d’assemblées mouvementées… Tourné quelques années après, donc une fois la légalisation de l’avortement légiférée, Regarde, elle a les yeux grands ouverts (1980) de Yann Le Masson s’intéresse également au M.L.A.C et à son devenir : faut-il arrêter la lutte alors que la loi est passée ou, au contraire, la poursuivre puisque certaines femmes de l’association doivent être jugées pour « exercice illégal de la médecine ». Là encore, le témoignage est souvent passionnant et la grande scène de manifestation devant le tribunal est un sacré morceau de cinéma, saisissant avec intensité le nécessaire combat des femmes. On pourra néanmoins trouver que les deux séquences qui encadrent la partie centrale du documentaire ont un peu vieilli. Il s’agit de deux accouchements à domicile (que le cinéaste filme, cette fois, de manière frontale) où se devinent les excès et les limites de la liberté après 68 : éloge des médecines douces et « naturelles » et méfiance envers l’hôpital, la médecine institutionnelle, communautarisme contestable (tout le monde autour de la femme qui accouche, y compris les gamins qu’on réveille…).
Enfin, derniers regards croisés autour de la question du genre et de l’androgynie. Nous avions pu découvrir à Gindou l’an passé le très beau La Communion solennelle de René Féret et, cette année, Mystère Alexina du même metteur en scène qui eut les honneurs de la projection. Alexina est un hermaphrodite, élevé comme une fille pendant son enfance jusqu’au début de l’âge adulte où elle est engagée comme institutrice. Mais le désir qu’elle éprouve pour une de ses comparses (incarnée par la gracieuse Valérie Stroh) révèle sa part « masculine ». Ce film « historique » évoque parfois le cinéma de René Allio (comme Moi, Pierre Rivière…, l’histoire d’Alexina a été exhumée par Michel Foucault), mélange de classicisme et de distanciation. C’est le dessinateur Vuillemin qui tient le rôle d’Alexina et l’approximation de son jeu le rend finalement assez touchant et correspond parfaitement au propos d’un film qui ausculte avec talent les ambiguïtés du désir et de l’identité. On regrettera juste des conditions de projection assez médiocres puisque le film était projeté hors de Gindou (une belle initiative consistant à mettre à l’honneur le cinéma itinérant et à proposer des films dans les villages alentours) et le son était particulièrement mauvais. A revoir, donc. La vision de l’identité fluctuante s’avère beaucoup plus « rock’n’roll » chez Marie Losier. Avec The Ballad of Genesis and Lady Jaye, la réalisatrice nous plonge dans l’univers de la musique industrielle, de l’underground new-yorkais et de la performance dans un style haché qui évoque parfois celui de Jonas Mekas. A partir des années 2000, Genesis va pratiquer diverses opérations chirurgicales pour ressembler à son épouse Lady Jaye. Si la cinéaste s’intéresse à la manière dont les frontières du genre sont dépassées par les deux personnages excentriques qu’elle suit, elle montre surtout une histoire d’amour aussi passionnée qu’électrisante. Un amour absolu qui rend d’ailleurs assez poignante la fin de l’œuvre.
D’une certaine manière, cet amour pourrait également symboliser ce que fut cette édition du festival de Gindou : un éloge de la diversité, de l’anticonformisme, de la différence enrobé dans un amour indéfectible du cinéma…

* Son frère Samuel nous a davantage convaincu dans un film pourtant bien moins intéressant : La Danse des renards de Valery Carnoy
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).