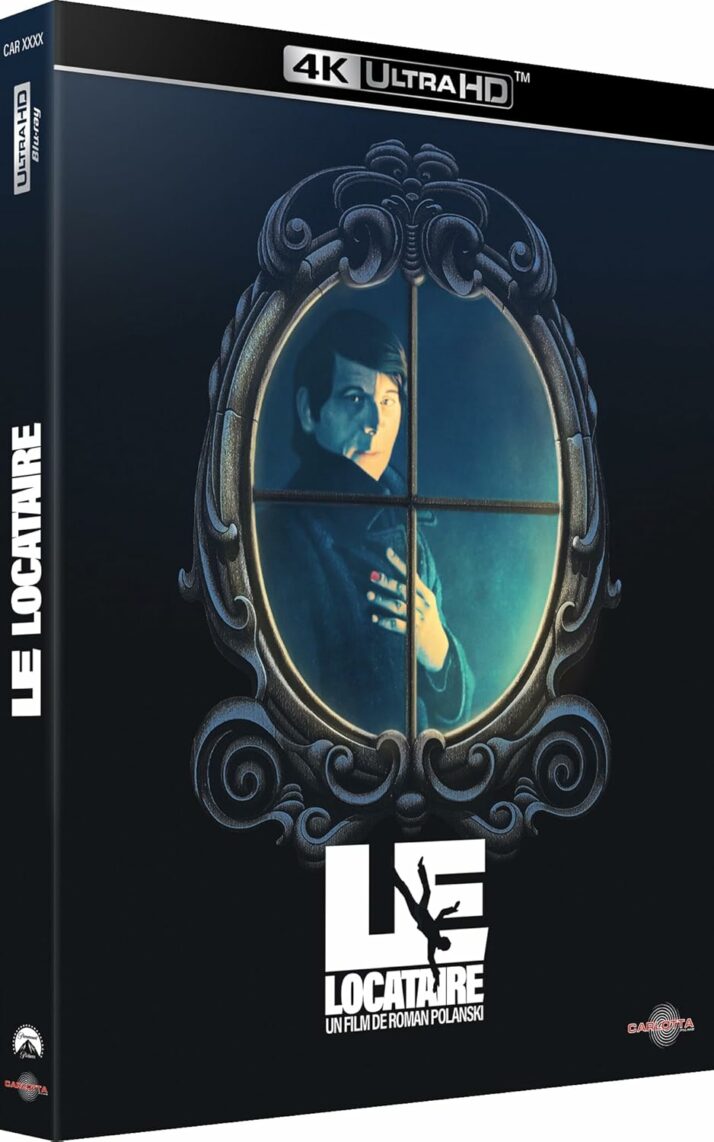Publié en 1964, le premier roman de Roland Topor, Le Locataire chimérique, a très rapidement intéressé le monde du cinéma et, notamment, Hollywood. Il semble étonnant de prime abord que les écrits de l’artiste français, cofondateur du mouvement Panique (un « antimouvement » d’aspiration anarchiste et antidogmatique revendiqué comme un style de vie), soient susceptibles d’attiser la curiosité des studios américains. Cependant, à y regarder de plus près, la greffe ne semble pas totalement contre-nature. Cette histoire d’un jeune homme timide qui emménage dans un appartement dont l’ancienne locataire vient de tenter de se suicider, provoquant l’animosité inexplicable de ses voisins, s’impose comme un matériau parfait pour un thriller paranoïaque, genre très en vogue outre-Atlantique. En effet, le pays est embrasé par de nombreuses désillusions qui secouent son histoire et fragilisent sa cohésion. Le scandale du Watergate a parachevé d’instaurer ce climat de défiance, déjà bien entamé par le fiasco du Vietnam ou l’assassinat de Kennedy.
Jack Clayton qui vient de signer son adaptation de Gatsby le magnifique (1974) avec Robert Redford et Mia Farrow, ne cache pas son intérêt pour le livre. Un accord est trouvé avec Paramount et le metteur en scène des Innocents commence à plancher sur la transposition. C’est alors que le studio décide, sans davantage d’explications, de lui retirer le projet au profit d’un cinéaste vedette sous contrat, auréolé du succès de Chinatown : Roman Polanski. Clayton, fou de rage, claque la porte de la major tandis que le réalisateur de Rosemary’s Baby, proche de Topor, s’attelle à l’adaptation aux côtés du fidèle Gérard Brach (Répulsion, Cul-de-sac, Quoi ?) avec qui il était en train de plancher sur un film d’aventures à grand spectacle qui deviendra, quelques années plus tard, Pirates. De leur collaboration naît donc Le Locataire qui s’est imposé comme la pierre angulaire de la filmographie de son auteur après avoir été initialement rejeté par la critique et le public. Presque un demi-siècle après sa sortie et sa sélection en compétiltion au Festival de Cannes, comment aborder ce cauchemar éveillé ? Comment l’appréhender aujourd’hui dans la globalité d’une carrière et d’une vie tant discutée et débattue ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, le long-métrage était encore inédit en France en Blu-Ray et UHD, Carlotta est venu pallier ce manque. Profitons de la sortie de cette superbe édition pour tenter d’apporter quelques éléments de réponse.

Le Locataire © Carlotta Films
JH cherche appartement
Le film constitue l’ultime chapitre d’une trilogie centrée autour d’appartements maudits, initiée en 1965 avec Répulsion, et poursuivie trois ans plus tard avec le choc Rosemary’s Baby. Après Londres et New York, c’est à Paris que le protagoniste se retrouve plongé au cœur d’un suspense paranoïaque. Ici, le studio loué par Trelkovsky, situé au dernier étage d’un immeuble parisien cossu, devient un personnage à part entière. Hanté par des sons étranges, vestige des codes des récits de maison hantée, il est arpenté par la caméra flottante, presque spectrale, de Sven Nykvist, chef opérateur attitré d’Ingmar Bergman (Cris et chuchotements, La Source, Persona). Le générique composé d’un long mouvement de grue (première utilisation de la Louma au cinéma), démarre sur un visage mystérieux avant de descendre le long d’une façade et d’aboutir sur le héros pénétrant la cour intérieure. L’architecture de l’édifice, entièrement construit en studio et fruit du travail du chef décorateur Pierre Guffroy, écrase la frêle silhouette de l’homme, déjà menacé sans même le savoir.
Ce lieu quasi unique devient un microcosme en soi, expulsant hors-champ les rues de la ville. Les extérieurs sont souvent relégués au second plan, vagues formes floues à peine discernables. Même la fenêtre de Trelkovsky donne sur une cour intérieure, lui bouchant de fait tout horizon. Plus encore, les déplacements du protagoniste se déroulent en un cut (pour l’anecdote, un certain Jacques Audiard a secondé Françoise Bonnot au montage), comme s’il se téléportait d’un endroit à l’autre avant de revenir inlassablement à son point de départ. Ici, nulle carte postale touristique de Paris. Polanski observe la Ville Lumière tel un no man’s land grisonnant et étouffant, un espace imprécis en construction, comme il le refera plus tard dans le thriller hitchcockien Frantic. Dans Le Locataire, le seul indice clair de la situation géographique arrive au bout de près d’une heure et demie, lorsque le protagoniste longe un quai embrumé d’où émerge la tour Eiffel. Une image ordinaire qui rompt partiellement avec la grammaire du film, au point de brusquer par sa banalité supposée. L’appartement est donc l’épicentre de toutes les peurs et tensions. Les innombrables séquences intérieures multiplient les miroirs et surfaces réfléchissantes, créant des mises en abîmes encapsulées dans des vignettes au sein même des plans. Le cinéaste parvient, en un détail anodin, presque absurde (une dent retrouvée dans un mur), à générer l’angoisse et à nous plonger dans ce qui constitue le cœur du récit : la paranoïa grandissante d’un personnage principal à qui il prête ses traits.

Le Locataire © Carlotta Films
Take Shelter
Quel est le passé de cet individu a priori sans histoire ? D’où vient-il lorsqu’il passe la porte de cet immeuble ? Il n’a pas de prénom et se présente maladroitement, tel un étrange dandy sur la retenue. Synecdoque vivant, il est même résumé à sa fonction, somme toute commune, de « locataire », au point de donner au film son titre. Un paradoxe au sein d’une œuvre qui déforme la quotidienneté jusqu’au cauchemar et utilise l’anonymat de son protagoniste pour laisser libre cours aux interprétations et projections, tout en disséminant des indices. Une plongée kafkaïenne dans la psyché d’une individualité esseulée qui entretient de troublantes filiations avec le metteur en scène, dont la présence dans le rôle principal ne doit rien au hasard. L’homme, qui a toujours fait du cinéma un moyen de transcender ses démons et de faire état du chaos de son existence, mais aussi plus largement de la condition humaine, nous convie, sans le dire explicitement, au cœur de ses tourments. Les emblématiques lunettes de Sharon Tate portées par Stella, ou la présence de son ami Bruce Lee à travers une séance de cinéma en amoureux, ne constituent pas de simples clins d’œil, ils servent de repères tangibles et personnels à l’intérieur d’un long-métrage cryptique et allégorique.
Initialement actif et entreprenant, Trelkovsky est dépossédé de son libre arbitre au moyen de détails a priori anodins, dont la gravité graduelle se révèle peu à peu. Le barman qui lui prépare son chocolat sans même le consulter et lui vend une autre marque de cigarettes que sa préférée, le transforme au fur et à mesure en Simone Choule, la précédente locataire. Stella, campée par Isabelle Adjani, qui faillit tourner dans le projet Pirates aux côtés de Jack Nicholson, l’infantilise et le chosifie même. Récit d’une aliénation progressive, Le Locataire observe l’homme transformé insidieusement en cette femme (le travestissement est un motif cher au cinéaste, en témoigne le rôle de Donald Pleasence dans Cul-de-sac) qui perd sa volonté propre et assiste passivement à sa propre dépossession. On s’invite chez lui, on déplace ses meubles, des passants l’entraînent dans des endroits sans qu’il n’ait son mot à dire, et même, on le cambriole… On lui dénie son identité et, au fond, son droit à exister. Le spectre de la première tragédie de la vie de Polanski (la Shoah) croise celui de la suivante (l’assassinat de Sharon Tate), dans un geste inconscient et réparateur. Le film dresse un état des lieux psychologiquement préoccupant de l’auteur, contrarié par la maîtrise absolue d’une mise en scène magistrale posant la forme finale du thriller polanskien. La destruction de son avatar de fiction à l’écran va de pair avec sa possible reconstruction derrière la caméra. Dans une vie incertaine et à la merci d’aléas cruels sur lesquels l’humain n’a qu’une prise limitée, l’art offre un espace de certitudes.

Le Locataire © Carlotta Films
Théâtre de l’absurde
Dans son interview inédite présente en bonus, intitulée Paranoïaque à Paris, le cinéaste revendique la nature de comédie du film. Si l’on est en droit de douter de son efficacité comique (Le Bal des Vampires dans lequel il jouait également, était plus clair sur ce point), il fait néanmoins montre d’un réjouissant sens de l’absurde, probablement hérité de Roland Topor. L’artiste, dont certains dessins apparaissent au détour d’affiches surréalistes, infuse certains gags à la limite du burlesque (Trelkovsky se prend une porte, des poubelles difficiles à porter l’obligent à se contorsionner), du scatologique (la voisine qui se soulage sur le palier), voire du franchement dérangeant (la concierge rit du suicide de Simone, une gifle est assénée à un enfant). Une inquiétante étrangeté irrigue l’ensemble du métrage, renvoyant à son statut quasi fantastique. Ainsi, lors d’une curieuse homélie, un prêtre semble s’adresser directement au héros. De même, lors de visions cauchemardesques, celui-ci se retrouve plongé dans un appartement aux proportions faussées, fruit d’un travail ingénieux d’effets visuels, rappelant à quel point Polanski est avant tout, un immense formaliste.
Peu à peu, ce n’est donc plus seulement son identité que le protagoniste perd, mais également son lien avec le réel. Les nombreuses références à l’Egypte antique (Simone se change en momie, des hiéroglyphes ornent les murs des toilettes, le salon est rempli de bustes de Néfertiti), au-delà de renvoyer un imaginaire propice aux mystères, génèrent une seconde lecture, évoquant des mythes tels que la pesée des âmes. Au fond, l’esprit de Simone Choule, immobilisée, n’est-il pas en train de trouver un nouvel hôte valide en la personne du nouveau locataire ? S’il ne répond fort heureusement jamais aux divers questionnements que soulève son récit, préférant laisser libre cours à l’interprétation de chacun, Polanski n’hésite pas à convoquer une imagerie horrifique pleinement assumée. La danse macabre finale, véritable carnaval filmé à la courte focale où les conspirateurs revêtent des formes démoniaques (Rosemary’s Baby ne faisait qu’évoquer implicitement cette imagerie), nous force à adopter le point de vue subjectif du héros. Entraînés dans cette ronde, nous ne pouvons que nous abandonner et lâcher prise.

Le Locataire © Carlotta Films
L’étranger
Si le cinéaste choisit de ne jamais nous désolidariser de son personnage principal (c’est-à-dire, de lui), c’est aussi car il souhaite nous faire partager pleinement ses peurs et ses angoisses. Né en France, Roman Polanski est pourtant considéré comme un étranger lorsqu’il revient dans l’Hexagone au début de sa carrière dans les années 60. Le rejet qu’il ressentit alors se retrouve dans la manière dont ses voisins traitent Trelkovsky. Les Parisiens le questionnent sur son nom (dans son supplément, Samuel Blumenfeld revient d’ailleurs sur l’importance des patronymes dans l’œuvre du réalisateur), sans réellement savoir si le problème pour eux vient de son origine polonaise ou de sa consonance juive. Tout le monde paraît lui être hostile, même un chien qui se montre agressif dès qu’il s’approche.
La persona publique de Polanski et son rôle finissent par se fondre l’un dans l’autre, le protagoniste se retrouvant accusé à tort d’être un fêtard invétéré (réputation dont le cinéaste et sa compagne, Sharon Tate, jouissaient à Hollywood), mais aussi un pervers libidineux (un voisin lui lance même « Vous pourrez vous rincer l’oeil »), image que diverses affaires finiront par lui accoler dans l’inconscient collectif. Autour de lui, des collègues envahissants, suspicieux et lourdingues, incarnés par des acteurs français (Bernard Fresson en beauf qui se croit tout permis), souvent issus du café théâtre. Se croisent des membres de la troupe du Splendid (Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Michel Blanc) et du Café de la Gare (Rufus, Romain Bouteille, Marie-Christine Descouards), échos à une tradition locale de l’humour. À l’inverse, la plupart des voisins, complotant contre le jeune Polonais sont issus de l’âge d’or hollywoodien. Des figures telles que Shelley Winters (La Nuit du chasseur), Melvyn Douglas (Ninotchka, The Changeling) ou Jo Van Fleet (À l’Est d’Eden) composent les habitants de l’immeuble. Le metteur en scène renvoie ainsi dos à dos l’exclusion ressentie dans les deux pays où il a séjourné.
Sa trilogie reflète d’ailleurs probablement son vécu. Une Belge exilée à Londres dans Répulsions, une jeune femme issue de l’Amérique rurale perdue en plein cœur de Manhattan dans Rosemary’s Baby, un expatrié louant un appartement parisien ici : trois personnages extérieurs, menacés ou persécutés. Là où la paranoïa de Carole, interprétée par Catherine Deneuve, ne semblait jamais corrélée à une quelconque réalité tangible, Rosemary et Trelkovsky sont factuellement confrontés à des individus mal intentionnés. Pourtant, si la jeune WASP enceinte faisait face à une secte satanique souhaitant mettre au monde l’Antéchrist, celle-ci se montrait aux petits soins et en apparences anormalement bienveillante. L’immigré polonais, lui, affronte de plein fouet et de la plus brutale des manières, le racisme et la xénophobie ordinaire. De « bons citoyens » en somme qui ne souhaitent rien d’autre que vivre en paix et pointent du doigt les étrangers (madame Garderian et sa fille, probablement rejetées à cause de leur nom arménien). Sous ses atours de thriller claustrophobique, Le Locataire dépeint en creux une barbarie ordinaire, une haine de l’autre, que le cinéaste lui-même subit à divers moments de sa vie, que ce soit en Pologne, en France ou aux États-Unis.

Le Locataire © Carlotta Films
Wanted and Desired
Question délicate qu’il serait suspect de contourner sans créer un angle mort critique, bien que nous n’ayons aucune envie de nous épancher sur des éléments extérieurs ayant biaisé la lecture de l’une des œuvres les plus denses de XXIème siècle, Le Locataire précède un point de bascule dans la vie de son créateur. De victime, Roman Polanski passera bientôt au statut de bourreau. L’année 1976 résonne donc comme un moment de calme avant la tempête. Celle-là même qui le conduira à rejoindre Paris en janvier 1978, comme Trelkovsky auparavant. Cet homme sans prénom, acculé et condamné, prend une dimension supplémentaire à l’aune des déboires judiciaires de son interprète. L’adaptation de Topor n’est plus simplement un paroxysme stylistique, mais également une prémonition allégorique, mal aimable et déstabilisante. Cet aspect, évidemment rétrospectif, n’était pas présent lors de la conception du film, mais teinte aujourd’hui inévitablement la façon dont on le reçoit. Il amplifie la complexité de la psyché du protagoniste autant qu’il révèle la part sombre de son auteur, qui à ce stade ne s’était jamais autant dévoilé à travers l’une de ses réalisations. Le pouvoir de fascination du long-métrage et sa manière de continuer à se nourrir inconsciemment du réel des décennies après sa conception accentuent son caractère définitif et infini, aux côtés de chefs-d’œuvre presque conventionnels en comparaison (Chinatown, Le Pianiste). C’est aussi à ce prix douloureux et exaltant qu’il se redécouvre.
Disponible en 4K UHD et Blu-Ray chez Carlotta Films.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).