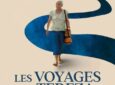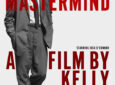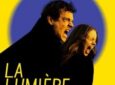Alors que Marche ou crève est sorti sur les écrans il y a quelques semaines à peine, voici qu’un autre roman de Richard Bachman, pseudonyme de l’immense Stephen King, a le droit à son adaptation cinématographique: Running man. Étonnamment, sous ses airs de blockbuster assumé, le film se révèle quant à lui très fidèle à l’œuvre originale. Et pour cause, quel meilleur choix que celui du Britannique Edgar Wright, dont l’humour corrosif des débuts semblait jusqu’alors avoir été oublié dans son Angleterre natale, pour réaliser cette satire de l’Amérique contemporaine.
En préambule, rappelons que Stephen King s’inspire d’une nouvelle de Robert Sheckley parue dans The Magazine of Fantasy et Science Fiction en 1958 dont Yves Boisset tirera son film éponyme en 1983. Boisset accusera de plagiat les producteurs de la première adaptation de Running Man en 1987 par Paul Michael Glaser avec Arnold Schwarzenegger et gagnera son procès. A signaler également que contrairement à ce que pourrait croire le très méchant et satirique La Dixième victime d’Elio Petri ne s’inspire pas de cette nouvelle mais d’une autre de Sheckley au sujet extrêmement proche mais traitée sur un ton plus humoristique.

Running man est le seul roman – au sens strict – de science-fiction du prolifique Stephen King. L’action se déroule en 2025, et il est très amusant de voir comment était imaginée notre époque en 1982 dans le cerveau génialement malade du maître de l’horreur. Nul doute que le contexte politique d’alors – la présidence Reagan (le fait que celui-ci ait été d’abord un acteur avant d’être un politicien), le triomphe du libéralisme et bien sûr de l’écolo-scepticisme – a inspiré la société dystopique façon 1984 décrite dans Running Man. Mais King était probablement bien loin d’imaginer que certaines de ses visions seraient largement dépassées, avec un personnage tel que Trump président des États-Unis par exemple.
Là où quelques adaptations de l’auteur au cinéma se servent littéralement des intrigues, au détriment d’une réelle interprétation et en oubliant le caractère subversif des romans (c’est par exemple le cas pour la version Schwarzenegger), Edgar Wright choisit de conserver la critique qui est faite de la manipulation médiatique et du Capitalisme à outrance, plus que jamais pertinente de nos jours.

Mieux encore, dès les premières images, le doute ne plane pas pour le spectateur à qui l’on tend un miroir à peine déformé de l’Amérique d’aujourd’hui, fascisante et terrifiante. Wright dépasse le roman en accentuant l’aspect politique de l’intrigue. Le Running Man est un jeu télévisé (une véritable vision de télé-réalité!) dans laquelle les candidats doivent survivre un mois à la traque conjointe des terribles Chasseurs et des forces de l’ordre. Chaque jour où le candidat n’est pas mort augmente ses gains, tout comme chaque policier ou Chasseur qu’il tue. Personne n’a jamais gagné, la mort constitue la seule issue de l’émission.
Si la lutte des classes est toujours là en toile de fond dans une société toujours plus fracturée, le réalisateur britannique s’en donne à cœur joie pour faire de son anti-héros le porte-voix des cols bleus, contre les cols blancs (appelés Exec dans le film). Le fameux Ben Richards (le running man!) apparaît sous les traits de Glen Powell. Oubliée la belle gueule un peu lisse et aseptisée du pilote de Top Gun: Maverick, l’acteur Américain incarne ici le visage d’une colère destructrice.

Wright montre l’implosion de valeurs Américaines (celles de la famille par exemple) au profit d’une vision forcément sombre et nihiliste. Ainsi, au-delà du vernis civilisationnel censé réguler les pulsions humaines, les États-Unis seraient fondés par la violence, marqueur génétique profondément ancré dans une culture du divertissement cynique. Running man, c’est la mise en scène de la frustration et de la haine d’une classe moyenne abrutie par l’omniprésence des images, miroirs déformés d’une réalité altérée, tronquée, falsifiée. Ainsi la masse des honnêtes gens devient le jouet d’une classe dirigeante qui désigne la classe ouvrière, pauvre et en proie au chômage, comme son ennemie, capable de lui ravir le peu qu’elle a.
Le tour de force du film se situe un peu ailleurs, puisque Wright se fait manipulateur en faisant de son pamphlet un agréable blockbuster haut de gamme, c’est-à-dire au budget bien conséquent et où le spectateur en a pour son argent. Les scènes d’action sont hyper efficaces, magnifiquement mise en scène sans jamais être bourratives, grâce à un rythme qui sait aussi se ménager. Sous ces airs de comédie testostéronée, le film trompe son monde façon contrebande. Bien sûr, le réalisateur Anglais se fond dans le système Hollywoodien quand il fait ce film; ainsi il se compromet ironiquement, à l’image du producteur du jeu Dan Killian (excellent Josh Brolin) jouissant de la révolte de sa victime.

Qu’importe, car au final, malgré quelques facilités scénaristiques (par ailleurs absentes du roman, King restera toujours un éternel pessimiste), Edgar Wright introduit une joyeuse dose de punk dans un film qui aurait pu être standard et aseptisé, comme en témoigne son fabuleux générique de fin, superbe tract. Il retrouve en quelque sort l’essence d’un certain cinéma populaire qu’on croyait perdu. Derrière le cinéma commercial, un appel à la révolution. Cela rappelle aussi la série B agressive d’antan, lorsque le cinéma servait à déverser sa rage et que Carpenter nous jetait son They Live en plein dans la figure, même si la démarche anarchiste décontractée et grand public se rapprocherait plus des aventures d’un Snake Plissken.
Notons aussi l’image des forces de l’ordre qui, après d’autres films récents tels qu’une Bataille après l’autre, n’est plus indiscutablement celle d’une autorité bienveillante et protectrice sur grand écran, mais le bras armé d’une société oppressive.
A l’image d’un certain âge d’or de la contestation dans le cinéma Américain dans les années de présidence de Bush Jr, gageons que la situation politique actuelle des États-Unis, si déprimante soit-elle, permette de voir dans les années à venir fleurir sur les écrans nombre d’œuvres avec une dimension plus ou moins contestataire. Ainsi, Wright se permet-il de provoquer le spectateur en déchirant le quatrième mur dans une section finale à l’odeur d’essence. L’air de rien Running Man injecte du vrai fiel dans un blockbuster familial. Et rien que pour ça, il fait un bien fou.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).