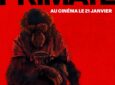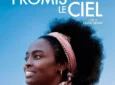C’est peu dire que la France compte de nombreux festivals de cinéma. Une correspondante m’envoyait d’ailleurs récemment une recension de toutes ces manifestations et en a dénombré pas moins de 241 ! L’enjeu pour les équipes qui animent tous ces festivals, c’est évidemment de pouvoir se distinguer des autres et d’inscrire leurs rencontres dans la durée. À l’instar des rencontres de Gindou qui fêtaient cette année leur 41e anniversaire, le festival de Marcigny, petite bourgade du sud de la Saône-et-Loire comptant 1.700 habitants, se singularise par son exceptionnelle longévité puisqu’il fut créé en 1971 et fêtait donc sa 54ème édition.
Animé par l’association Marcynéma et son équipe de bénévoles passionnés, ces journées dédiées au cinéma se déroulent dans la belle salle du Vox et des événements annexes leur sont rattachées : exposition de photos (signées Thierry Berthou) à l’office de tourisme, exposition de belles affiches de cinéma des années 50-70, entoilées et conservées par la Marcynémathèque…
Dans une ambiance très conviviale (beaucoup d’habitués que l’on retrouve de séance en séance), le festival propose pendant cinq jours un parcours thématique à travers une programmation de qualité.
C’est au monde rural, par exemple, que fut consacrée une des journées du festival. Excellente occasion de revoir le magnifique Peaux de vaches de Patricia Mazuy. Ce qui frappe immédiatement en revoyant ce premier long-métrage de la réalisatrice, c’est la manière dont elle parvient à s’extraire de la veine dans laquelle elle semble d’abord s’inscrire (en gros : le réalisme à la Pialat). En filmant le retour à la ferme d’un homme condamné à la prison (Jean-François Stévenin), retrouvant sur place son frère (Jacques Spiesser) et sa jeune épouse (Sandrine Bonnaire), Patricia Mazuy réinvente la mythologie du western. Elle filme les machines agricoles comme les chevaux chez Ford ou Hawks et parvient à inscrire son récit dans un territoire rural parfaitement délimité. Quant à la rivalité entre les deux frères, celui qui a payé pour avoir incendié autrefois la ferme et celui qui est parvenu à avoir une vie confortable en dépit des zones d’ombre que recèle son passé, elle a également des accents bibliques. La force de Patricia Mazuy est de parvenir à incarner ces conflits et l’évolution des personnages sans le recours à la psychologie ou au réalisme mais en inventant son propre langage, sauvage et stylisé.
Aline Issermann : réalisatrice engagée

© Panoceanic films
Une des journées thématiques nous permit également de (re)découvrir une cinéaste que l’on connaît mal, Aline Issermann, venue à Marcigny en compagnie de son actrice fétiche Mireille Perrier. La réalisatrice nous raconta ses nombreux déboires avec le milieu du cinéma (un producteur escroc sur Le Destin de Juliette et une caméra d’or à Cannes ravie par un autre en raison de querelles intestines, l’ostracisme qui la frappa pour avoir osé aborder le thème de l’inceste dès le début des années 90…) et put nous présenter trois longs-métrages. Un peu à part, La Vallée des anges mériterait assurément une restauration (la copie présentée était plutôt médiocre) pour remettre en valeur les lieux désolés que la cinéaste filme avec talent. Le projet est singulier puisque Aline Issermann apprend qu’une usine désaffectée à Villerupt en Lorraine va bientôt être rasée. Elle se rend alors sur ce site industriel à l’abandon et improvise avec une petite équipe des micros-fictions. S’inspirant des lieux, une équipe de tournage déambule et imagine des saynètes venues des temps passés. Les acteurs apportent parfois eux-mêmes des livres et en lisent des extraits. Ces éléments hétéroclites tendent à former une forme de rêverie poétique autour d’un lieu voué à la disparition. Ce sont des fantômes qui hantent ces grands hangars où dorment les machines, dernières traces d’un passé sidérurgique récent. Si ces fantômes sont parfois incarnés par les comédiens de l’équipe dans le cadre du tournage, Mireille Perrier tient le rôle d’un « vrai » fantôme qui surplombe cet univers et qui semble faire le lien entre tous les personnages. Jouant à merveille sur l’expressivité de son visage, Issermann rend parfois hommage au cinéma muet (des raccords entre les plans d’un prêtre en contre-plongée et les gros plans de l’actrice renvoient à La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer) et nimbe l’œuvre d’une profonde mélancolie en se demandant où vont les fantômes quand tout a été détruit. Sans être parfait, le film d’Aline Issermann parvient à conserver la mémoire d’un lieu, disparu à tout jamais quelques mois après la fin du tournage.
Avec ces deux autres films, Aline Issermann apparaît comme une cinéaste attirée par les « grands sujets » (un peu comme Yannick Bellon autrefois). Avec toujours ce risque que le contenu l’emporte sur la forme et la bride. Présenté comme un film sur les violences conjugales, Le Destin de Juliette parvient pourtant à échapper à l’écueil du didactisme. Le film narre l’histoire d’une jeune femme des années 60 vivant à la campagne et travaillant à l’usine. Par un concours de circonstances, elle est invitée à épouser un homme (Richard Bohringer) qu’elle n’aime pas. Petit à petit, elle va réaliser que son mari est également un homme renfrogné et brutal… Aline Issermann, à travers ce destin, nous plonge dans une époque que l’on idéalise souvent (le miracle économique des trente glorieuses). Mais derrière cette façade, il y a l’existence de gens modestes, laissés pour compte du progrès et vivant selon des traditions archaïques. Impossible pour Juliette de divorcer, par exemple, lorsque la situation devient insupportable. La réalisatrice ausculte évidemment la condition féminine de l’époque (l’assignation à un simple rôle de ménagère) et évoque la question des violences au sein du couple. Mais la force du film tient à sa manière de faire passer les personnages avant le message. On est ému par cette Juliette (superbement incarnée par Laure Duthilleul, qui tient également un rôle secondaire dans Peaux de vaches) à la force paradoxale (entre détermination et résignation). Quant à son mari, s’il n’a évidemment pas le beau rôle, il n’en demeure pas moins « victime » d’un système social injuste.
L’Ombre du doute apparaît également comme un film précurseur puisque la cinéaste abordait, 30 ans avant tout le monde, la question de l’inceste et la difficulté pour les enfants de se faire entendre face à la justice. Le sujet est fort, documenté et il est difficile de ne pas être touché par le combat de cette petite fille de 12 ans qui doit se battre pour faire reconnaître les crimes de son père (Alain Bashung, pas toujours parfait mais habité par son rôle). L’œuvre a un côté « salutaire » qu’il est impossible de nier mais on peut néanmoins regretter qu’elle soit un tantinet didactique. Prenons par exemple le personnage de l’avocat d’Alexandrine (Thierry Lhermitte) : on sent que tous les mots qu’il prononce ne visent qu’à faire connaître sa fonction qui venait alors d’être reconnue (le droit pour un mineur d’être assisté d’un avocat venait à peine d’être accordé). Et tout le film fonctionne un peu sur ce principe : la professeur qui se doit d’écouter les mots couverts des enfants, l’éducatrice… De même, les ressorts de l’inceste au sein de la famille sont étudiés de manière assez didactique : la mère (Mireille Perrier) qui est d’abord dans le déni avant de croire sa fille, le père qui fut lui-même victime d’abus dans son enfance… Tout cela est à la fois assez juste mais asséné de manière beaucoup trop démonstrative. On le regrette d’autant plus qu’Aline Issermann a un vrai talent de cinéaste, comme le prouve ce passage où les enfants fuguent et se trouvent confrontés, le temps d’une scène quasi-onirique, à Peau d’âne. Là encore, une restauration s’imposerait pour rendre justice à la photo de Darius Khondji.
Puisque Mireille Perrier, notre Lillian Gish, était invitée, nous pûmes découvrir un film tout récent (il est sorti en juin dernier) mais passé assez injustement inaperçu : Différente de Lola Doillon. La cinéaste s’intéresse ici aux troubles du spectre autistique à travers le quotidien de sa jeune héroïne Katia (Jehnny Beth), documentaliste dans une rédaction de presse. À la fois très brillante et appréciée, elle souffre de troubles nombreux : crainte du bruit et de la foule, crises d’angoisse, difficulté à maintenir une relation stable avec son petit ami Fred… A l’instar de L’Ombre du doute, on sent que le film est extrêmement bien documenté et que Lola Doillon veut faire œuvre de pédagogie. Le spectateur doit mieux connaître ce que sont les TSA en sortant de la salle. D’où le côté parfois un peu scolaire du récit qui analyse toutes les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les individus porteurs de ce type de troubles : difficultés professionnelles, difficultés familiales et sentimentales…Le film n’est pas non plus dénué d’un côté émollient puisque tout l’entourage de Katia ou presque (seule sa mère, jouée par Mireille Perrier, est dans le déni) est remarquablement attentif et compréhensif. Mais ces quelques bémols ne doivent pas nous empêcher d’apprécier ce film qui emporte l’adhésion grâce à l’énergie de sa mise en scène, une direction d’acteurs parfaite (Lola Doillon a de qui tenir et l’avait déjà prouvé dans Et toi, t’es sur qui?) et un ton jamais larmoyant. La grâce de Jehnny Beth emporte tout sur son passage et l’on oublie finalement ses troubles pour voir évoluer un vrai personnage de cinéma, plein d’humour et de vitalité.
Le fantasque Luc Moullet

© La Traverse
L’événement de ces rencontres fut incontestablement la présence de Luc Moullet, accompagné d’Antonietta Pizzorno, sa compagne depuis 1969 (« dans un couple, ce sont les 50 premières années les plus difficiles », nous a-t-il affirmé). Quatre longs métrages accompagnés de deux courts pour se replonger dans le cinéma fantasque, farfelu, décalé, minimaliste et parfois absurde de Luc Moullet. Contemporain de la Nouvelle Vague (il écrivit dans les Cahiers du cinéma un long papier élogieux sur A bout de souffle en 1960), le cinéaste nous rappelait, en présentant son premier film tourné à 23 ans Un steak trop cuit, qu’il n’était désormais plus fréquent de pouvoir rencontrer l’auteur d’un film tourné il y a 65 ans !
Pour cerner (même si c’est de manière sans doute trop schématique) la singularité de l’œuvre de Moullet, il faudrait repartir de son hilarant court-métrage Essai d’ouverture. Dans ce petit film de 13 minutes, Luc Moullet débute sur une idée minimaliste (ses difficultés pour ouvrir une bouteille de Coca-Cola) et explore toutes les possibilités liées à cette expérience, de la plus basique (un bon coup de poignet) à la plus absurde et « hénaurme » (la gigantesque machine à débouchonner les bouteilles). Or tous les films de Moullet fonctionne un peu sur ce principe d’expansion. On part de l’infiniment petit pour couvrir avec une maniaquerie drolatique tous les aspects de l’idée originelle. Ainsi, Genèse d’un repas débute de la manière la plus triviale puisqu’on partage le déjeuner du couple Moullet/Pizzorno. Le cinéaste s’interroge sur ce qu’il y a dans son assiette (du thon, une omelette et une banane) et va remonter les trois filières de ces aliments, allant jusqu’au Sénégal pour observer l’industrie du thon et en Équateur pour la banane. Plus de 45 ans après son tournage, le film reste passionnant tant il parvient à tirer un simple fil pour aborder de nombreux problèmes : exploitation des travailleurs dans le tiers-monde (où les enfants sont mis à contribution), absurdité des circuits commerciaux, la question des marges par rapport aux coûts de production, les débuts de la mondialisation… Tourné dans la mouvance du cinéma militant, le film s’en distingue par son refus de se plier aux dogmes (certains lui ont reproché son regard sur les travailleurs français) et par une forme d’humour absurde qui jaillit çà et là. Luc Moullet inventait à sa manière la « traçabilité » des aliments et, poussant son raisonnement par l’absurde, il proposait en guise de conclusion une autocritique de son film, admettant qu’en le réalisant, il participait lui-même à une forme d’exploitation (les matières premières nécessaires à la création d’un film).
Cette autocritique, on la retrouve à la fin de La Terre de la folie, son dernier long-métrage à ce jour. En effet, on y voit Antonietta Pizzorno qui se dispute avec son époux en affirmant que tout ce qu’il a filmé n’est qu’un prétexte à montrer sa propre folie. Car ce documentaire pataphysique entend prouver qu’il existe au cœur de ses chères Alpes du Sud (Moullet est le cinéaste des éboulis et des roubines), une sorte de « pentagone de la folie » où, à l’instar du poème d’Hugo mis en musique par Brassens, le vent qui descend de la montagne rend fou. Partant de cette théorie assez farfelue, recoupant d’ailleurs la mémoire familiale du cinéaste (certains de ses aïeux ont été gagnés par cette folie), Moullet entreprend de recenser un certain nombre de faits divers, du plus célèbre (l’affaire Dominici) au plus local. Que le cinéaste mène l’enquête avec sa bonhomie légendaire et son inimitable phrasé offre un contrepoint savoureux à ce catalogue d’atrocités. L’humour noir du film tient à ce principe d’accumulation (il faut entendre ce gendarme qui raconte comment un boucher schizophrène a tué sa fille et a dispersé ses membres dans des sacs poubelles transportés à divers endroits) et de localisation somme toute assez arbitraire.
Dans ses fictions, Luc Moullet aime également partir d’une idée précise pour en explorer toutes les dimensions. La Comédie du travail met en scène trois personnages au cœur d’une France où sévissent la crise et le chômage : un banquier à la routine bien rodée (Roland Blanche), une agente de l’ANPE (la délicieuse Sabine Haudepin) et un « chômeur professionnel » qui ne rêve que d’escapades dans la montagne. À partir de ces trois individus qui finiront par se rencontrer, le cinéaste construit son récit sur une accumulation de saynètes qui dessinent chacune un aspect des problèmes liés au chômage. On évolue entre Tati, avec de nombreux gags reposant sur une idée visuelle (les files qui se forment à l’ANPE et les échanges entre les deux queues où les chômeurs se répartissent par âge) et Mocky : goût pour les seconds rôles aux trognes impayables (on retrouve d’ailleurs des acteurs communs aux deux cinéastes, à l’instar de Jean Abeillé ou Dominique Zardi), pour l’humour noir (l’ouvrier qui creuse des canalisations à toute vitesse pour avoir plusieurs contrats et qui finit enterré dans une de ces travées) et une certaine forme d’irrévérence (les stakhanovistes y sont fort justement raillés). Sur un sujet grave, Moullet propose une comédie décalée et souvent très drôle. Quinze ans plus tard, il retrouve cette structure picaresque (une succession de saynètes) dans Les Naufragés de la D17. Tandis que des coureurs de rallye automobile tentent de traverser une des régions les plus sauvages des Alpes du Sud, divers personnages s’agrègent pour former une farandole décalée et burlesque. On y croisera des astronomes (Mathieu Amalric et Sabine Haudepin), des militaires en goguette, menés par le tordant et toujours excellent Jean-Christophe Bouvet, un dépanneur très particulier (il secourt les automobilistes à l’aide de deux vaches), un berger dont la demeure a des vertus aphrodisiaques… Moullet aborde son récit avec une liberté qui ne ressemble qu’à lui. Les gags sont nombreux et l’humour permet de mettre l’accent sur certaines absurdités plus générales (la politique européenne, la crainte des « Arabes » et de Saddam Hussein en cette époque de guerre du Golfe…). Son comique est assez minimaliste mais fonctionne par sa dimension loufoque et fantasque. Moullet prétend que la fin de son film est un hommage à King Vidor et qu’il faut toujours voler des choses aux autres cinéastes mais dans un autre contexte (pour que cela ne se voit pas). Ainsi, la fin de La Comédie du travail est, pour lui, un emprunt à Bergman (on peut d’ailleurs voir dans ce film une séquence entièrement construite sur la mécanique des gestes, comme dans Pickpocket de Bresson). Avec ce cinéaste, le spectateur ne sait jamais sur quel pied danser (est-ce de l’art ou du cochon?) mais c’est ce principe d’incertitude, doublé d’un sens aigu du comique, qui fait le prix de son œuvre encore trop mal connue.
Éclectisme

© Potemkine films
Pour finir, nous eûmes droit en guise de dernière journée du festival à divers coups de projecteur où se côtoyaient George Romero et Hou Hsio-Hsien (on ne craint pas l’éclectisme à Marcigny et c’est ce qui fait l’intérêt de ces rencontres!). Pour ma part, j’ai terminé mon séjour avec le merveilleux Adieu Philippine de Jacques Rozier. Intéressant de revoir ce film comme contre-champ du Destin de Juliette puisque les années 60 que nous découvrons ici sont imprégnées d’une légèreté, d’une insouciance et d’une liberté qui réjouissent et émeuvent. La trame sentimentale est minimaliste (un jeune homme qui hésite entre deux jeunes filles, amies pour la vie) et nous mène des studios de télévision parisiens (avec Averty) aux plages de Corse dans un souffle vivifiant. Tout ce qui fait la beauté du cinéma de Rozier est déjà là : son goût pour un cinéma buissonnier et libre, son attachement aux temps morts, aux instants privilégiés d’un bonheur éphémère, à la complicité des jeunes filles – on pourrait écrire une thèse sur les fous-rires chez ce cinéaste -… Ces moments où la vie a plus d’incandescence, le cinéaste les saisit merveilleusement bien, sans pour autant oublier de laisser planer une ombre mélancolique. En effet, Michel doit partir pour le service militaire, ce qui signifie gagner l’Algérie à cette époque. Déjà le retour d’un des amis du jeune homme offrait au hors-champ (la « guerre sans nom ») une occasion de s’inviter dans un quotidien insouciant (un repas de famille).
Ce rendez-vous avec les héroïnes de Rozier constitua le plus parfait moyen de quitter Marcigny : sur une note légère et euphorique, mais non sans une certaine mélancolie de voir se terminer d’aussi jolis moments…
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).