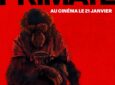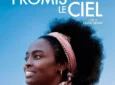Escapade annuelle vers l’hyperespace du splendidement bizarre, le Lausanne Underground Film Festival signait mi-octobre sa 24e parade. L’occasion de se goinfrer de ces éternels sandwichs aux falafels, mais surtout l’immuable délice de s’en mettre plein les tympans, et plein la rétine. Au menu de ce deuxième compte-rendu : des pulsions espagnoles frénétiques, des courts-métrages qui déménagent et une caresse lumineuse. C’est parti !
On l’attendait, elle est arrivée : la rétrospective dédiée aux pulsions du cinéma espagnol entre 72 et 84, celle qui réservait les pages les plus cheloues de cette édition de festival, celle qui devait montrer que la dictature franquiste se combattait aussi avec des films carrément chokbars, celle qui me mettait perso el cuchillo entre los dientes – pour le dire dans la langue de Cervantes. Le documentaire Exorcismo: The Transgressive Legacy of Clasificada “S” (2024), annoncé « brillante mise en contexte », était projeté la veille : je m’étais résigné – drame du festivalier – à lui préférer d’autres rivages.
Après la théorie s’ouvrait donc la pratique ce vendredi 17 octobre, avec La Cloche de l’Enfer signé Claudio Guerin en 1973. Alberto Sedano – le réalisateur d’Exorcismo – déblaye en avant-séance qu’il s’agit du parfait exemple du film d’horreur s’efforçant de contester le régime franquiste. Le Caudillo ne mourra que deux ans plus tard, en 1975. En attendant, l’opposition cinématographique tente des ronds de jambe, contourne tant bien que mal la censure, et s’attaque métaphoriquement à tous les symboles de la dictature. Ici, la famille, l’église, les institutions conservatrices, et même l’acteur Alfredo Mayo qui avait tourné, courant des années 40 et 50, dans des fictions propagandistes. Devant la caméra de Guerin, il incarne un personnage crépusculaire et toxique. Ajoutant aux couches surnaturelles de l’intrigue, la fin de tournage connaitra un virage funeste : le réalisateur décède d’une chute depuis le clocher qui avait été construit pour les intérêts du film. Des perspectives pas super golries, surtout qu’Alberto Sedano finit par nous préparer à des scènes de torture animale « très dérangeantes » …

Pas besoin d’ailleurs d’attendre bien longtemps ! Les premières minutes régalent effectivement de séquences d’abattoir nauséabondes, construites en montage alterné pour mieux expliciter la référence évidente à La Grève d’Eisenstein (1925), à son expression graphique et son pendant symbolique : en Espagne aussi, le prolétariat n’est que du bétail. Alors bravo à Alberto Sedano de se soucier du bien-être animal mais il a quand même oublié de préparer aux autres scènes de violences, cette fois sexuelle, incestueuse et pédophile ! Oui, La Cloche de l’Enfer ne fait pas dans la dentelle. Il fait cependant ce qu’il semble vouloir faire : choquer, bousculer, abasourdir. Au point de ne pas toujours être clair, d’assumer quelques angles morts scénaristiques, mais qu’importe : un train fantôme n’a pas forcément besoin d’être didactique. Rendons hommage enfin à la performance XXL du français Renaud Verley, formidable dans son rôle d’ange vengeur, charmeur et sadique, rappelant le charisme diabolique des Malcolm McDowell ou autre Helmut Berger. Cette retrospective espagnole commence très fort …
Pas de panique, la séance d’après offrait un océan de douceur et de lumière. Devant une assemblée pleine à craquer, Bridgett M. Davis compostait le premier des trois films choisis dans le cadre de sa carte blanche : le splendide Losing Ground (1982). « Je savais que ce film existait, que Kathleen Collins y explorait la sensualité d’une femme noire, qu’elle l’avait pensé seule, loin d’Hollywood et avec un budget très serré » nous explique Davis. « Il n’était visible nulle part mais sans même l’avoir vu, il était devenu une sorte de bonne fée sur le berceau de mon propre film [Naked Acts], une voix qui m’invitait à me lancer à mon tour. Ce n’est qu’après la restauration de Losing Ground, bien plus tard, que je l’ai découvert en pleurant à chaudes larmes : il était juste tout ce que j’espérais qu’il soit. » Kathleen Collins décède d’un cancer en 1988, quelques années seulement après cet unique long-métrage qu’elle n’avait pu, faute de moyens, complètement terminer. C’est sous l’égide de sa fille qu’il finira par être tout à fait post-produit, offrant au monde la chance merveilleusement inoubliable de le découvrir.

Qu’est-ce que ça raconte ? L’histoire de Sara, professeure de philosophie émérite, et de son mari Victor, peintre talentueux et hédoniste. Lui veut croquer tous les plaisirs de la vie ; elle préfère se consacrer à ses recherches sur l’expérience extatique. L’histoire d’une incompréhension, de nouveaux horizons, d’une réappropriation par la protagoniste, de ses choix, de son corps, de son libre-arbitre. Mais par-delà cette romance pudique et déjà ensorcelante, Losing Ground détonne, comme Naked Acts, par son témoignage intersectionnel : il balance à la face de qui le regarde la rareté des films réalisés par des femmes noires racontant l’histoire de femmes noires. Il n’est pourtant pas un manifeste politique, ne fait aucune leçon de morale et se contente de mettre dans la lumière ce qui ne l’était pas : le genre de film qui respire et qui répare. Kathleen Collins réunit d’ailleurs un casting époustouflant : Bill Gunn, Duane Jones, et puis bien sûr dans le rôle de Sara, la magnétique Seret Scott – qui se destinera plutôt à une carrière dans les séries télévisées et au théâtre. Alors foncez, foncez, foncez mettre de la magie plein vos rétines – le BluRay est dispo chez Kino Lorber !
Tradition exploratoire du festival de Lausanne, défrichage rituel et azimuté, les courts-métrages expérimentaux étaient bien sûr de retour cette année. Avec deux programmes, pensés comme les échos du positionnement militant de cette XXIVe édition : « DESIST » projeté le lendemain, « RESIST » ce jour-ci. Introduit par la géniale Jessica Macor, l’assemblage compilait des horizons différents, de la prise de vue réelle à l’animation, de l’Autriche à la Colombie. Alors tout était évidemment très beau, mais perso, je retiens surtout trois films. À commencer par l’éthérique As Told by a Corpse, réalisé en 2025 par Yace Sula, mêlant les régimes d’image, de grains, de glitch, pour discuter des thèmes de maternité et d’identité – du grand art bizarre ! Ensuite, le fascinant You Have No Mother! (2025) – d’autant plus fascinant qu’il n’est que le film de fin d’étude de la réalisatrice coréenne Yoonseo Lee : il articule une réflexion acerbe sur la notion de famille à une photographie noir et blanc, sublime et poignante. Enfin, le clou du spectacle, film qui a reçu depuis le prix du meilleur court expérimental, l’inénarrable The Martial Forest (2025) : bourrasque pop et acidulée, tornade surexcitée mais raffinée, le film de l’artiste J Triangular est un vent de fraicheur, explorant l’esthétique kung-fuesque tout en la réactualisant d’une main de maitre – et sa soundtrack est superbe. Bravo !

À l’heure où les paupières sont déjà lourdes, où les concerts font déjà trembler les murs, les écrans du LUFF sont encore sur orbite – le kif. 22h45, deuxième round de la retrospective ibérique, avec la projection du rarissime Dimorfo (1980). « Le film le plus étrange du programme, et peut-être même de l’histoire du cinéma espagnol en général » nous tease Alberto Serano toujours au micro. Un film dont même la genèse est plus « grande que la vie ». Rodjara en écrit le script avant de filer plein gaz en Suède pour essayer de convaincre Bergman de le mettre en images. Sauf que le grand Ingmar est à la retraite, que l’histoire ne dit même pas si rencontre a été faite, et voilà que le vingtenaire rentre penaud au pays avec un gros bâche à déclarer à la douane. Son film, il le réalise lui-même. Il interprète aussi le rôle du protagoniste. Dimorfo finit par sortir dans quelques salles confidentielles, réapparait vaguement en VHS, et puis repart clopin-clopant séjourner aux oubliettes. Rodjara, lui, se spécialisera dans les films d’animation – psychédéliques – pour les enfants tout en mutualisant ses décors pour d’autres films, cette fois pornographiques – pour les adultes. Très étrange indeed !

Rodjara, homme de contraires donc, à l’image de ceux que réconcilie son film : bis et auteuriste, ambitieux et désinvolte, candide et impudique, suranné et rock’n’roll. Du lard et du cochon, tout à la fois. Il rappelle Théorème (1968) ou La Femme des Sables (1964), autant qu’il offre à la série Z grand-guignolesque l’un de ses sommets sibyllins. Difficile d’ailleurs de le résumer, tant chaque virage narratif s’accompagne d’un enrobage improbable et déconfit. Dans le monde merveilleux de Dimorfo, les femmes tombent enceinte à 80 ans, les matriarches sont en réalité des patriarches, et le petit-déjeuner se déguste tout nu sur les toits. Des deux cotés de la caméra il n’y a que Rodjara finalement qui semble croire à son histoire. À l’image du personnage qu’il incarne, mi-séraphin mi-grand dadais, trimballant sa figure longiligne dans le labyrinthe crédule de son intrigue. Alors oui, maladroit parfois, imparfait souvent, Dimorfo n’est pas de ces métrages qui tsunamisent la rétine. Il n’en est pas moins sincère, contagieux, touchant. Comme une lettre écrite au Père Noël, comme un scénario que l’on embarque en Suède, comme un rêve qui pourfendrait le réel.
Suite et fin de ce compte-rendu festivalier bientôt en ligne – stay tuned !
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).