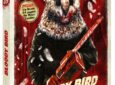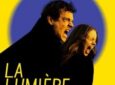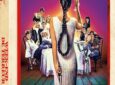Escapade annuelle vers l’hyperespace du splendidement bizarre, le Lausanne Underground Film Festival signait mi-octobre sa 24e parade. L’occasion de se goinfrer de ces éternels sandwichs aux falafels, mais surtout l’immuable délice de s’en mettre plein les tympans, et plein la rétine. Au menu de ce troisième et dernier compte-rendu : des filles qui gueulent dans un micro, du cannibalisme, des combinaisons latex et des jeeps qui roulent à toute berzingue. En piste !
Samedi 18 octobre. Troisième journée de festival. Les voix sont cassées, les cache-nez remontés jusqu’aux cernes, les allures se brinquebalent sur l’esplanade du Casino de Montbenon, et le cours du Doliprane monte en flèche … Les affres des festivités commencent déjà à laisser quelques traces à l’heure d’aborder un nouveau marathon cinématographico-musical : 19 films projetés et presque autant de concerts – haut les coeurs ! Alors impossible de tout voir bien sûr et je me résous à faire l’impasse sur certaines rétrospectives cinéphiles. J’en attrape une autre, dédiée à la musique comme « opium » des masses et compilant quelques opus inoxydables : Privilege (1967) de Peter Watkins, Metal Messiah (1977) de Tibor Takács ou encore Decoder (1984) de l’allemand Muscha. C’est Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains (1982) qui nous occupait en ce début d’après-midi.
« Un film de studio » nous alerte le programmateur Eric Peretti en avant-séance – au LUFF, l’expression ferait presque figure de gros mot – mais pas seulement ! Le projet est à l’initiative de la scénariste Nancy Dowd, oscarisée en 1978 pour le drame romantique Coming Home. Elle souhaite cette fois s’inspirer de la scène punk explosive, et surtout de ses artistes féminines qui défraient les ondes et la chronique. Dowd s’entoure de la journaliste Caroline Coon, à l’avant-garde du mouvement, et toutes deux élaborent une fiction imprégnée de fantasmes et de réalisme : celle d’un groupe de filles, irrévérencieuses et magnétiques, qui s’envolent vers la gloire à grands coups de guitares électriques et de slogans féministes. Le sujet est d’actualité et le projet prend de l’ampleur : Paramount le produit, Lou Adler le réalise, certains membres des Clash ou des Sex Pistols viennent même s’y greffer. Jusqu’à ce que les deux scénaristes quittent définitivement le navire : entre autres imbroglios, le studio juge que le dénouement scénarisé est trop couteux et lui préfère – comme par hasard – une alternative beaucoup moins progressiste.

Et cette tension finit par transpirer tout au long du film, comme s’il ne savait pas choisir entre sa récupération tardive ou ses velléités d’origine, entre la comédie romantique ou la fable anarchiste, entre ses producteurs ou ses scénaristes. C’est sans doute sous l’égide des premiers que les seconds rôles masculins gagneront en importance, quitte à limiter, s’approprier, annihiler, l’éclat des Stains et de ses trois musiciennes – comble de l’ironie, ce n’est même pas l’actrice Diane Lane, prodigieuse protagoniste, qui figure en première ligne du générique. Dans la version qui sort sur les écrans, le groupe est finalement coupé dans son envol, renvoyé à la case départ. Nancy Dowd et Caroline Coon prévoyaient, elles, un épilogue triomphal : une tournée éclatante, un rayonnement autonome, une sanctification féministe. C’est hors-champs que les deux finiront par avoir gain de cause, avec l’essor dix ans plus tard du mouvement Riot grrrl : de Bikini Kill, de Bratmobile, de Sarah Jacobson, de toutes ces artistes qui se réclameront du film et qui, dans la foulée de Nina Hagen, de Lene Lovich, de Siouxsie, des Slits, des Marine Girls, des Raincoats […], montreront que les filles ça balance plutôt pas mal aussi. Un film donc imparfait mais néanmoins essentiel, à voir, revoir, et même à écouter – parce que la soundtrack envoie la salsa !
Changement de salle et sacré changement d’ambiance avec le retour sous les projecteurs lausannois de Kazuo Hara. Après l’abrasif Goodbye CP (1972) – chroniqué dans nos colonnes -, après Extreme Private Eros (1974) – que j’ai malheureusement loupé -, le documentariste japonais présentait chronologiquement L’armée de l’empereur s’avance (1987) : son titre peut-être le plus légendaire et assurément l’un des plus troublants. Il lui aura fallu treize ans pour accoucher de cette troisième réalisation. Une éternité. Sa méthode reste pourtant inchangée : une focale étroite, serrée, charnelle, entre la caméra et son sujet. Ici, c’est le dénommé Kenzo Okuzaki qu’Hara-San cisaille, capture sous toutes les coutures. « Il aimait se présenter comme un artiste » nous explique ce dernier, avant d’ajouter amusé : « personnellement, je le voyais plutôt comme un terroriste ». Une ligne de crête plutôt étroite, et finalement à l’image du personnage : vétéran de la campagne nippone en Nouvelle-Guinée, Ozugaki s’est lancé dans une quête effrénée, vengeresse, presque mystique, pour révéler la vérité sur la mort de ses camarades de guerre, pour démasquer coûte que coûte les atrocités de la loi martiale et de ses subordonnés.

Parce que oui, la Nouvelle-Guinée entre 1942 et 1945 n’avait pas tout à fait l’air d’un séjour au Club Medi. Se déplient au fil des images quelques révélations sordides, allant de la famine, aux exécutions arbitraires et même jusqu’au cannibalisme. Oui, plutôt morbide. Mais par-delà l’enquête, le regard distancié et rétrospectif – qui pourrait vaguement rappeler The Act of Killing (2012) -, c’est surtout la méthode documentaire qui bouleverse en cela qu’elle a de s’infiltrer complètement, passionnément, jusqu’au-boutistement dans les pérégrinations de son objet d’étude. Tantôt Sisyphe, tantôt Ubu, Kenzo Okuzaki est de ces personnages que l’on dirait plus grands que la vie. De la même manière, Kazuo Hara faisait, dans Goodbye CP, le portrait de Yokota Hiroshi, atteint de paralysie cérébrale et cependant militant acharné contre la marginalité. Le réalisateur japonais aurait-il donc pour seul talent de dénicher ces trajectoires hors du commun ? Non. Car la science de ces deux films est d’abord celle de la curiosité débridée : celle qui écoute, qui regarde, qui transperce, qui refuse la trivialité ; celle qui amplifie le réel de nuances dissidentes ; celle qui combat les évidences, avec empathie et humilité. Vous l’aurez compris, L’armée de l’empereur s’avance est un film spécial, le genre que l’on se prend en pleine face et auquel on pense ensuite très souvent. Découvrir cette retrospective sur grand écran est une chance, un privilège, un luxe, celui dont le LUFF a définitivement le secret.
Dimanche 19 octobre. Dernière journée de festival. Un bouquet final aux allures de feu d’artifices avec quelques obscurs moment de gloire à ne louper sous aucun prétexte – et surtout pas celui de la fatigue. Le premier : Poppers (1984), coché depuis des lustres dans mon calendrier. Après tout, qui se serait pas extatique à l’idée de voir ce que recèle un titre pareil, a fortiori quand il est assorti d’un si beau poster – il faut le voir pour y croire. Mais bref ! Expert des bizarreries cinégéniques hispaniques, Alberto Serano est encore dans les parages et il souffle sur les braises de mon enthousiasme, précisant en avant-séance que ce film est, de toute la rétrospective dédiée aux frissons espagnols « classés S », son favori. Peut-être parce qu’il dénote du reste du lot. Serano nous rappelle que le général Franco est mort près de 10 ans plus tôt, en 1975. Au milieu des années 80, l’Espagne achève doucement sa transition démocratique, débarrassée des fantômes de son passé, et assortie d’une génération aussi talentueuse que pleine d’avenir : celle d’Almodovar et de la Movida. De fait, alors que La Cloche de l’Enfer (1973), Le Prêtre (1978), Bacanal en Directo (1979) et Dimorfo (1980) se teintaient d’une note lugubre – ou carrément déconfite -, Poppers est lui éclatant, gage d’une jeunesse non plus réprimée mais triomphante. C’est elle, désormais, qui met à mort l’establishment !

Comme dans La Cloche de l’Enfer, cet establishment est incarné notamment par l’acteur Alfredo Mayo, à l’affiche de films propagandistes dans les années 40-50. Il incarne ici un oligarque surpuissant qui organise, avec ses amis tout aussi vicieusement riches, une chasse à l’homme : celle du jeune Santos. Sauf qu’il a de la ressource ce sosie officiel de Benjamin Siksou – la génération Pavillon Baltard aura la ref. Il s’en sort et finit, au bras de la sublime Giannina Facio, par se venger et renvoyer le boomerang dans les dents de la joyeuse bande surpuissante. Précisons tout de même que Santos bénéficie d’une plot armor niveau légende, mais on s’en doute, Poppers ne s’embarrasse pas vraiment de cohérence. Le film est une sorte de mix, improbable mais efficace, entre le charisme musclé de Hard Target (1993) et la luxure décatie des 120 Journées (1975) de Pasolini. Une ronde fiévreuse, frénétique donc, arrosée d’une esthétique glam et new wave, incandescente et sensuelle, qui doit beaucoup à la photographie de Federico Ribes. Au final, le réalisateur José María Castellví signe ici une oeuvre qui accepte délicieusement son statut de série Z : rare, précieuse, démesurée. Et pour qui se demande encore la raison d’être d’un tel titre : elle vaut le farfelu détour et a bouclé la séance dans un éclat de rire !
Ultime projection avant l’extinction des feux festivaliers. Et bien sûr, le LUFF cuvée 2025 ne pouvait s’achever qu’avec un film magnifique. Bridgett M. Davis compostait le dernier billet de sa carte blanche avec un nouvel hommage à une réalisatrice noire-américaine : Leslie Harris. Toutes deux ont le même âge, ont grandi dans le même quartier de Brooklyn. Elles ne se connaissent pas mais en 1992, Harris signe Just Another Girl on the I.R.T. et l’emmène, en totale indépendance, jusqu’au prestigieux Sundance Festival où elle devient la première femme noire à remporter un prix. Pour Davis, c’est une décharge, une révélation, un appel : elle commence à tourner son Naked Acts (1996) 18 mois plus tard, à peine. Les deux films sont donc liés, comme une porte ouverte et une porte franchie, comme l’élargissement saisi d’un champ des possibles. Mais Just another girl répare aussi une injustice : si les hood movies foisonnent dans les années 90, ils ne parlent que de mecs, de leurs problèmes et de leurs gros pecs. Ils cantonnent les femmes à un statut d’exutoire ou de faire-valoir. Petite révolution du coup, changement de perspective : c’est vers une ado, brillante et turbulente, que Leslie Harris braque la caméra et le micro.

Et autant l’avouer d’emblée : Ariyan A. Johnson, interprète de la protagoniste Chantel, crève somptueusement l’écran. De sa gouaille épidermique, de sa vulnérabilité élégante, de son charisme naturel et magnétique. Le film n’adresse pourtant pas un sujet facile : la grossesse accidentelle d’une lycéenne et les conflits qui en découlent avec le père, sa famille, ses amies. Mais voilà, Just another girl sonne vrai et sonne juste. La narration a précisément l’épaisseur du vécu, autant que les plans dans les rues de New-York, que cette scène au bureau du planning familial, celle du pique-nique à Prospect Park, ou celles innombrables de transports en commun entre le domicile, le lycée et le lieu de travail. Leslie Harris documente, exalte un ici et un maintenant. Elle inonde ses images d’innombrables détails qu’ils soient stylistiques, musicaux, argotiques. Elle enregistre pour célébrer et pour rendre hommage. Au point d’assumer une subjectivité radicale et de ne raconter que ce qu’elle connait. C’est sans doute ce qui rend le film si pur, si combatif, si attendrissant : il n’élude rien de sa propre vérité. Comme une invitation à se raconter soi-même, à son tour !
« Voilà, c’est fini » nous dirait Jean-Louis. Ces comptes-rendus éludent malheureusement quelques projections impériales : celle notamment d’Anything that moves (2025), grand gagnant de la compétition international des longs métrages ; du Prêtre (1978) ; d’Un Homme comme tant d’autres (1964) ; de Bacanal en Directo (1979). Ils se résignent à élaguer également le récit du concert incantatoire et féérique du groupe France. Et ils se désespèrent bien sûr de tous ces films qui n’ont pas pu être vus : les retrospective dédiées à Barbara Meters ou à Robert Downey Sr. Toute la majestueuse programmation du festival est à retrouver en ligne !
Un immense merci à Julien Bodivit, à Eric Peretti, à Jessica Macor, à toute l’équipe du LUFF, à tous•tes les bénévoles, de nous faire vivre cette grande messe annuelle du bizarre.
Rendez-vous l’année prochaine !
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).