Bis Repetita (ou pas)
Comme en 2025, nous nous sommes rendus au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand le temps d’un week-end, au lendemain de l’ouverture. Après un passage particulièrement apprécié l’année précédente, la crainte de la déception nous a brièvement effleuré l’esprit mais elle s’est totalement estompée au sortir d’une première séance adorée. Un enthousiasme qui tenait autant à la qualité du programme découvert qu’à la manière dont cette séance s’est imposée à nous. Arrivés très tôt dans le centre-ville, les files d’attente étaient déjà considérables pour les premières séances de la journée à la Maison de la Culture et témoignaient d’une impatience de la part d’un public qui répond toujours aussi massivement à l’appel du court. Du calme à la tempête : une heure et demie plus tard, nous étions rattrapés par la réalité d’une fréquentation intense. La séance de compétition initialement visée était complète. Ni une ni deux, nous modifions un programme savamment pensé en amont pour une autre séance panorama. La rétrospective thématique intitulée « Voyage voyage : est-ce que tu viens pour les vacances » et le programme Vacances 4. Pas de compétition donc, et une séance parsemée de coups de cœur, à la teneur dépaysante. On ne pouvait rêver meilleure entrée en matière finalement.

Marie Louise © La Ruche Productions
Un peu moins de quarante-huit heures plus tard, notre passage en 2026 touchait à sa fin. Le bilan ? Six séances auxquelles allaient s’ajouter une projection VR et quelques rattrapages annexes hors salles obscures. Court et intense, à l’image des films découverts au fur et à mesure du week-end, l’expérience fut différente de l’année précédente et a minima tout aussi enthousiasmante. Un peu moins de séances de compétition (2 Nationale / 1 Internationale / 1 Labo), un extra (Décibels !) et un panorama (Vacances 4, évoqué plus haut), sans oublier un passage en Panorama Réalité Immersive pour une expérience d’un nouveau genre.
Avant d’aller plus loin et de relater nos impressions ainsi que nos découvertes préférées dans ce que nous avons pu voir de ce cru 2026, saluons l’institution inébranlable qu’est ce festival qui, d’année en année, maintient son niveau d’exigence avec une adhésion toujours aussi franche (168 000 spectateurs recensés pour cette édition) d’un public curieux et passionnément avide de découvertes. Un événement d’envergure internationale qui garde précieusement sa dimension humaine et son accessibilité, tout en faisant battre le cœur de la ville avec une intensité rare. Puissent les choses perdurer ainsi encore de nombreuses décennies !
Aux avants-postes
Notre échantillon de séances dessine quelques tendances qui se répondent parfois d’un programme à l’autre. L’originalité et le renouvellement des propositions reposent le plus souvent moins sur une réinvention des outils de scénario ou une révolution du langage filmique que sur l’intégration de nouvelles représentations ou problématiques dans des formes existantes. La subversion des codes prime ainsi généralement sur la création de récits ou d’approches entièrement inédites. À moins, et c’est parfois le cas, que ces histoires et ces styles neufs émergent directement de ces nouveaux enjeux simulant une continuité feinte. Ce questionnement ne concerne pas exclusivement la forme courte. Celle-ci, en écho au propos exprimé lors d’une interview réalisée durant le festival que nous publierons prochainement, permet une approche plus directe et se place en première ligne du cinéma de demain.

Coyotes @ Salaud Morisset
Autres constats, la percée d’un pur cinéma de genre, venant parfois se substituer à un cinéma ouvertement engagé. Du polar aux thrillers, les maux du monde sont toujours au cœur des créations mais sont abordés avec plus d’aisance au moyen de formes allégoriques. La tentation d’hybrider le documentaire et la fiction, d’abolir les frontières et de faire voler en éclats les étiquettes est également présente. Le court est un terrain de liberté, soumis à des contraintes différentes de celles du format long, en plus d’être délesté de la pression commerciale. C’est à ce prix que celles et ceux qui se saisissent de cet espace pour imposer durablement leurs visions se démarquent. En fin de compte, davantage que son palmarès (précieux mais qui ne constitue pas la seule finalité), un festival comme le Court se pose en vitrine exceptionnelle pour le format qu’il honore et valorise avec exigence et ambition.
Comment penser le monde par l’image dans un paysage où les écrans et les projections sont partout ? Dans un quotidien où l’apparemment vrai est parfois en réalité falsifié ou truqué, le cinéma et la mise en scène semblent plus que jamais inscrits dans nos vies. Dans ces temps mouvementés et mouvants, le rôle des cinéastes n’en demeure pas moins essentiel, pour ne pas dire crucial, afin de créer une dialectique susceptible de nous éclairer ou de nous questionner.
Courts en tension

Une Brèche © Ô Films
Dans Coyotes de Saïd Zagha, une chirurgienne palestinienne rentre chez elle après une longue garde de nuit, sans se douter que son trajet sur une route isolée de Cisjordanie va bouleverser sa vie à jamais. Thriller nocturne sec et tendu, soutenu par une superbe photographie, Coyotes déploie une atmosphère de film noir, sur laquelle plane l’ombre du cinéma de Michael Mann (les coyotes du titre et du film renvoient inévitablement à Collateral). Placés dans un contexte de tension géopolitique extrême, où les individus ne sont plus que des pions manipulables jouant tant bien que mal de leurs pouvoirs et statuts, ces motifs esthétiques se trouvent revitalisés. Le trouble initial se mue en angoisse à mesure que les rebondissements révèlent la véritable nature de l’inconnu venu en aide à la protagoniste. Saïd Zagha ménage le suspense et les attentes (jusqu’à quel point la corruption morale doit s’exercer pour se sortir d’une situation sans issue ?) jusqu’à un final brutal et cathartique. Ici, l’héroïne se bat moins pour un idéal que pour sa survie, et avec elle le cinéaste remet l’humain et le viscéral au centre du récit, au moment d’aborder en toile de fond une situation qui secoue continuellement l’actualité, dans un geste assuré, précis et violent. D’apparences trompeuses et de thriller, il en est également question de l’autre côté du globe dans Une brèche de Jean-François Leblanc. Caroline, détective à la SQ (Sûreté du Québec), se déplace en compagnie de son partenaire Frédérick pour une rencontre de routine avec un témoin. En ce mardi matin, elle n’a aucune idée que sa vie sera chamboulée à tout jamais. Excellent polar québécois qui commence de manière quasi anodine, jouant volontairement la carte de la quotidienneté pour nous absorber crescendo grâce à une mise en scène nerveuse. Entre une photographie crépusculaire et des plans-séquences jamais démonstratifs, la tension monte jusqu’à un final implacable. Très américain dans ses références, Une brèche se distingue par son décor et son accent, donnant moins l’impression d’imiter son voisin que de se poser en alternative viable.
L’amour à la plage

Au Bain des dames © Margaux Fournier / Caviar / Les Films de Nout
Dans un tout autre registre, Au bain des dames de Margaux Fournier a galvanisé la salle lors de la projection à laquelle nous avons assisté. Dans ce documentaire d’une demi-heure, la réalisatrice suit Joëlle qui, tous les jours, rejoint ses amies retraitées sur la plage du Bain des Dames, à Marseille. Comme dans un théâtre à ciel ouvert, elles rient, parlent d’amour, de sexe, de corps qui changent, et refont le monde avec la liberté de celles qui n’ont plus rien à prouver. Fort d’une authenticité et d’une originalité qui désemparent d’entrée, le film observe des femmes d’une liberté stupéfiante, souvent irrésistibles (la manière de parler sans filtres de sexualité par exemple) et parfois bouleversantes (le récit glaçant de violence conjugale). La réalisatrice observe avec tendresse ces récits quotidiens qui accouchent d’un dessein plus grand, celui de relater la vérité d’un monde d’avant qui cohabite avec le nouveau. Une génération s’adapte tant bien que mal à des codes qui ne sont pas les siens (les applications de rencontres) et va préférer les espaces de convergences au conflit, à l’instar d’un final réconciliateur entre les différentes tranches d’âge sur fond de Johnny Hallyday. Potentiel culte en puissance.
La plage et Marseille constituent aussi le cadre de Marie Louise de Régis Fortino, réalisé en 2020, dans lequel Mehdi rejoint ses amis à la plage un jour d’été. Entre l’apparition d’un plongeoir qui le défie et le regard d’une belle inconnue qui l’envoûte, Mehdi réussira-t-il à se faire une place dans l’arène ? Dans un noir et blanc inhabituel pour ce décor et cette jeunesse tchatcheuse, le cinéaste filme alternativement (et parfois simultanément) des corps, des visages et des paroles, des groupes et des individualités. Entre naturalisme et stylisation, il distille un trouble dans sa manière de contempler un cadre en apparence familier. Marie Louise s’anime et prend vie à travers des questions de pure mise en scène : comment faire émerger une individualité au sein d’un groupe ? Comment amener de la nuance dans ce qui peut sembler binaire jusque dans son esthétique ? Comment filmer un visage, observer un corps, mais aussi le transformer visuellement ? De ces intentions sous-jacentes se dessine une peinture sentimentale, à la fois pudique et flamboyante, où la légèreté n’est qu’une impression ou plutôt une protection face à la profondeur des émotions et intentions à la fois inavouables et irrésistibles. Du noir et blanc à la couleur, le film laisse progressivement se dévoiler son envergure à travers ses transformations, qui accompagnent l’éclosion d’un et d’une héroïne.

Marie Louise © La Ruche Productions
De plage il en est également question chez Raphaëlle Petit-Gille, et ce dès son titre : Fanny à la plage, mais sur un mode bien différent. À travers cette carte postale des vacances à la mer d’une mère célibataire, errant de barbecues en glaces à l’italienne, le film dessine le portrait d’une femme décoiffée, atterrie sur la plage d’une mer polluée. Entre colère et tristesse, avec le silence comme seule réponse à ses deux petits garçons, Fanny se noie dans l’étendue de ses désirs impossibles. Moyen-métrage perturbant qui, dans un cadre prétendument solaire, opère une chronique inconfortable à travers un personnage toujours sur la brèche. Dépassée et en quête de jours meilleurs, elle n’est ni un modèle ni fondamentalement mauvaise, elle s’accroche tant bien que mal, toujours à deux doigts de glisser, se relève à chaque humiliation ou coup du sort. La force du film est d’aller sonder sa part d’ombre sans jugement, dans une auscultation mal-aimable et émouvante, à laquelle s’ajoute l’interprétation profonde d’une comédienne qui fait office de révélation : Marie Denys, primée à juste titre.
L’envers des vacances
Les Vacances, deuxième court-métrage d’Emmanuelle Bercot, Prix du jury à Cannes en 1997, n’a rien perdu de sa pertinence. À la veille des vacances, Anne (Catherine Vinatier) n’a pas assez d’argent pour emmener sa fille, Mélody (Isild Le Besco), passer quelques jours loin de la petite ville de province où elles vivent. Face à la déception de sa fille, elle va essayer de trouver la somme nécessaire. La mise en scène inspirée entre réalisme social et fraîcheur naturaliste observe deux excellentes actrices se débattant à l’intérieur d’un récit vibrant et émouvant, entre lumière et dureté. Peinture d’une précarité poussée à bout, en difficulté pour relever la tête, dans laquelle se distinguent de subtiles velléités pop grâce notamment à un très bon usage de la musique intradiégétique. Un cinéma empreint de vérité qui n’oublie jamais d’être vivant et refuse de se figer. Petite curiosité, le réalisateur José Pinheiro (Ne réveillez pas un flic qui dort / Parole de flic) est remercié au générique de fin, sans que l’on ne connaisse son apport sur le court-métrage.
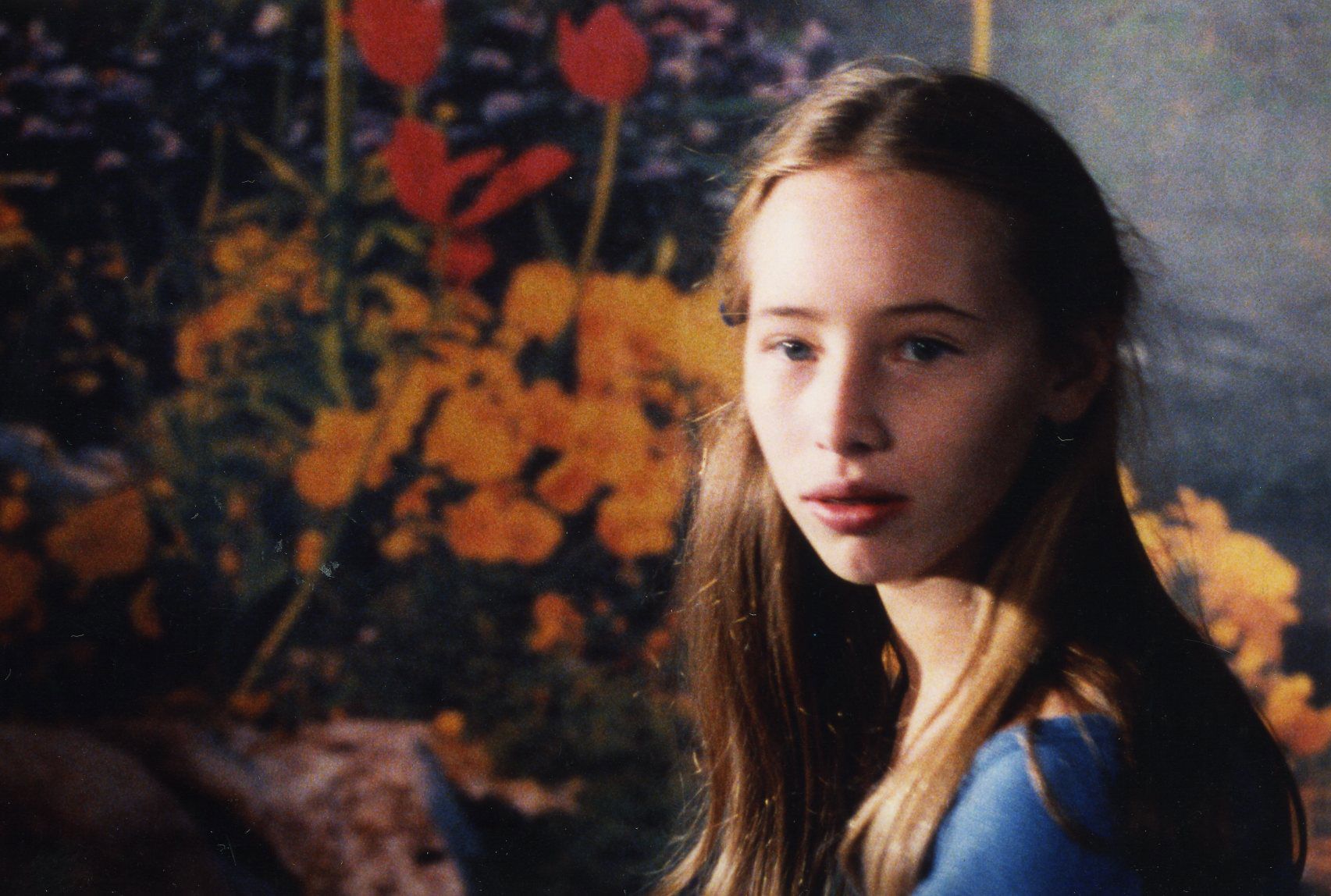
Les Vacances © La Fémis
Dans Resort, Emma Birkø filme avec, une fois n’est pas coutume, cruauté et lyrisme, l’impossible rencontre entre deux classes sociales en mariant deux territoires de cinéma : l’Europe du Nord et le Maghreb. Lorsque Sara rencontre Saïd dans la station balnéaire où elle séjourne avec sa mère pendant ses vacances en Tunisie, elle est contrainte de réaliser que le monde n’est pas aussi simple qu’elle l’imaginait. Choc esthétique et culturel dans lequel une princesse sort de sa prison dorée pour se rendre compte de la réalité du monde dans lequel elle vit et de sa position de dominante impuissante. La chronique solaire et brutale se distingue par sa justesse et sa spontanéité, annihilant toute tentation programmatique en observant deux visages de cinéma embarqués dans une utopie éphémère avant un réveil brutal. Qui a le plus appris, le plus perdu ? Ce récit initiatique laisse des points de suspension tout en assumant une dimension délicatement moraliste. Très fort.
Pour le plaisir
Dans une veine plus légère (à tempérer néanmoins), La Grande envie de Julien Aveque confronte plaisir trivial et drame de la vie. Francis, 15 ans, prépare sa chambre pour une masturbation en bonne et due forme devant les photos Instagram d’une jeune fille. Alors qu’il commence tout juste son affaire, il apprend la mort de son grand-père. Teen-movie empreint de gravité, se tenant à distance de la tentation potache tout en assumant sans détour la simplicité de son pitch, le film avance entre amusement et tendresse, comique de situation et sensibilité. Julien Aveque confronte la pulsion et le fantasme au réel et à ses surprises, bonnes comme mauvaises. L’efficacité de sa réalisation et la qualité de son écriture bénéficient de l’interprétation de jeunes acteurs justes et spontanés, qui donnent corps à des personnages auxquels l’adolescent que nous fûmes s’identifie sans mal. Un régal.

La Grande envie © Sourire Productions
Bixente, le héros de Biche de Yoann Hébert, quant à lui, entre en scène après “l’acte”. Nous sommes au lendemain d’une soirée lors d’un week-end entre copains et copines : alors qu’il s’en veut d’avoir encore couché avec une fille la veille, il se retrouve exposé à ses amis qui ne comprennent pas qu’il n’en soit pas fier. Observé dans un plan fixe frontal, dont la rigidité impose une vie à l’intérieur du cadre et une constante rigueur rythmique dans le jeu, le film ne se limite pas à une performance technique. L’image crue a quelque chose de déstabilisant, elle met le personnage à nu, face à nous et sans défense. À la faveur de cette mise en scène dense et épurée, Biche explore une zone de trouble et une pression sociale par le prisme d’un héros paumé, peu sympathique, mais rendu empathique au fil des minutes alors que ses failles se révèlent.
Frontal également mais sur une veine satirique, le jouissif A shot of art d’Ilke Paddenburg qui se pose en émule inspirée de Ruben Östlund. Lorsque deux bénévoles habituées d’un festival international d’art s’immiscent dans le périmètre d’une installation hautement controversée, la situation dégénère rapidement… Mais qui est véritablement responsable d’avoir franchi les limites ? Avec deux héroïnes inattendues (deux femmes âgées) et innocentes, aux prises avec une proposition artistique qui les dépasse, la cinéaste ose un geste frondeur et incisif qui s’abstient de passer par l’allégorie au moment de vilipender un patriarcat ici montré sans détour et dans son plus simple apparat. Il est moins question de dénoncer l’art contemporain ou l’évolution des luttes que de peindre avec amusement et sarcasme une fracture générationnelle.
Aux confins des formes
Dans un programme Labo 5 dominé par des essais théoriques questionnant le rapport aux images et la manière dont celles-ci sont de plus en plus ciblées et formatées pour toucher une audience réfléchie en tant que telle, Sh de Qi Duan propose une alternative organique à ces interrogations. Dans une esthétique animée changeante, le film interagit directement avec le spectateur sans le moindre dialogue par le biais d’une approche pulsionnelle, entre rêve et cauchemar, où la sexualité et la violence pénètrent le quotidien de l’héroïne (un avatar de la réalisatrice), entre fantasmes, angoisses et projections. Un poème subjectif ainsi résumé dans le synopsis : Dans cette époque d’angoisse collective, de crise de l’identité personnelle, je me sens souvent comme suspendue au-dessus du monde, tandis que tout perd de son goût, mais j’ai quand même l’envie de faire ce que bon me semble. Si l’on se coupe de la réalité, que va-t-on faire ? Va-t-on se libérer de nos désirs sans retenue, ou lâcher prise avec espièglerie ? Dans tous les cas, il est légitime de commencer par prendre du bon temps. Sh mélange abstrait et concret dans un élan habité.
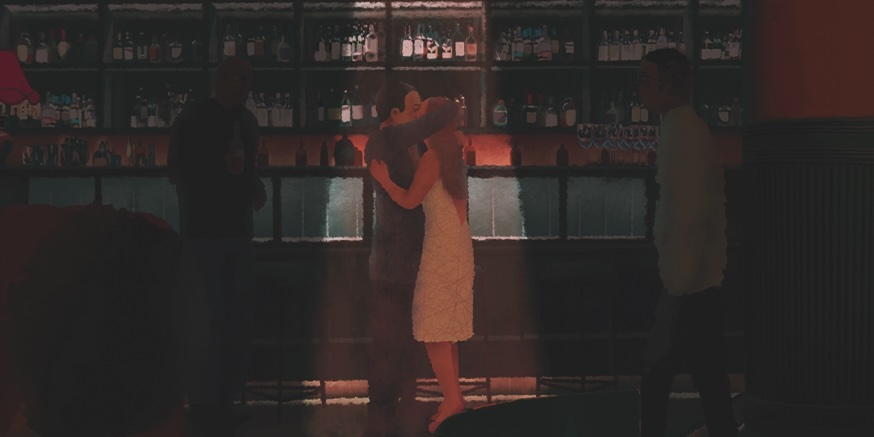
Sh © China Academy of Art
S’affranchir des limites de représentations traditionnelles est l’un des projets que couve Um de Nieto inspiré de l’œuvre de Daichi Mori. Le peuple des oiseaux est entré dans un chaos violent, en proie à un phénomène inquiétant : leurs œufs semblent hantés par des visages démoniaques. Leur éclosion semble annonciatrice d’une imminente catastrophe. Visuellement fou, le film mélange 2D et 3D, live et animation, superposant plusieurs techniques et styles de dessins pour une esthétique de synthèse dont la richesse épouse une mise en scène frénétique et virtuose. Un trip hallucinogène sous acide qui secoue l’essence jusqu’à l’épuisement mais avec une inventivité constante et jubilatoire.
Forme passionnante et aléatoirement considérée, le clip faisait l’objet d’un programme spécial Décibels ! avec douze films projetés donnant une envergure nouvelle à ces œuvres sur grand écran. On a apprécié le très sympathique Jack White, Archbishop Harold Holmes réalisé par Gilbert Trejo et surtout boosté par la performance galvanisante de John C. Reilly. Très chouette également, the business crew is there for u de crenoka réalisé par Léa Enjalbert & Florine Paulius où l’animation presque enfantine contraste avec des sonorités métalliques accrocheuses. Il y avait également deux vidéos signées de figures majeures du contemporain : No Touch de Sleaford Mods (feat. Sue Tompkins), mis en images par Andrea Arnold, et Big Sleep de The Weeknd & Giorgio Moroder, réalisé par Gaspar Noé. La cinéaste britannique apporte sa touche par son esthétique rappelant son Fish Tank, donnant au morceau une touche de pop sociale, créant par ses visions un rapprochement avec la musique. L’auteur d’Irréversible retravaille autour de motifs épileptiques déjà creusés sur Lux Æterna, qu’il décline ici dans un autre rythme et une autre atmosphère pour un objet virtuose et éreintant. Nos deux coups de cœur de ce panel furent des découvertes. Tout d’abord Common Loon de Xiu Xiu joué et mis en scène par la performeuse et vidéaste Alicia McDaid alias McDazzler. Un clip bruyant et mal élevé, punk et trash, expérimental et inventif qui donne l’impression d’assister à la rencontre entre le John Waters de la première période et le Harmony Korine de Gummo. Déluge de visions incarnées où les performances se succèdent dans la jouissance et l’opulence, c’est la découverte devant et derrière la caméra d’une artiste à suivre. Moins clivant, Triángulo de Amor Bizarro de Triángulo de Amor Bizarro, super morceau soutenu par une centrifugeuse à images en 16mm signée Sergio Soso, inspirée et guidée par une furie créative qui donne l’impression aux sons de fondre sur le cadre.
Présenté en section VR immersive, Fallax d’Owen Hindley est une expérience à mi-chemin entre la 3D (le gain constant en termes de profondeur de champ) et le jeu vidéo (le spectateur est partiellement actif). La trame est minimaliste et le film peu narratif : un prisonnier évadé s’enfuit dans les étendues sauvages islandaises et est attiré dans un monde étrange où le temps et la nature ont leur propre cadence. Ce projet animé interroge : le format VR peut-il s’adapter au live ? Si oui, à quelles fins ? Dans le cas présent, nous devenons partiellement acteurs de la mise en scène. Le film est dépourvu d’indications : nous sommes libres d’orienter notre regard dans un espace qui se configure alternativement par la verticale et l’horizontale. Quelle est la place du metteur en scène dans un dessein où l’on ne se contente plus de regarder ?
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).
























