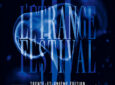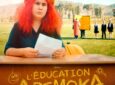En marge de la trente-et-unième édition de l’Etrange Festival, nous avons pu rencontrer l’un de ses héros, le cinéaste Kazakh Adilkhan Yerzhanov, prenant une place de plus en plus importante dans le cinéma mondial d’auteur et de genre. Il nous parle ici de sa relation avec ce festival-« phénomène », de l’impact de son adolescence sur sa cinéphilie, ainsi que du rapport entre les états du monde et les noirceurs de son cinéma. (Vifs remerciements à Clara Ollier et à Jean-Bernard Emery du service presse de L’Etrange Festival, ainsi qu’à l’interprète Eugénie Zvonkine sans laquelle cet entretien eut été impossible)
Vous avez au fil du temps tissé une relation d’amitié étroite avec l’Etrange Festival. Comment avez-vous rencontré le festival et ceux qui le font ?
L’histoire a commencé avec le premier film que j’ai présenté ici en 2016, La Peste dans le village de Karatas. Je n’avais alors que peu d’expérience avec les festivals, du moins pas l’expérience que j’ai aujourd’hui, j’étais très heureux d’être sélectionné avec ce film, je trouvais cela génial. Je me trouvais chanceux : ce film-là était étrange, beaucoup de gens ne le comprenaient pas, j’étais donc très fier de pouvoir le révéler au plus grand nombre. Je ne pouvais cependant pas être là physiquement, le film est venu tout seul. Je suivais alors à distance les réactions du public, les recnesions autour du film, et j’étais très impressionné de voir qu’il y avait énormément de réactions et d’articles à propos de mon long métrage ; il y en avait plus que lorsque mon film précédent, The Owners (2014), avait été montre hors sélection à Cannes. Je me suis dit « : C’est incroyable ! Qu’est-ce que c’est que ce festival où il y a plus de public qu’à Cannes ? » Je me suis alors dit que soit le film était génial, soit c’est le festival qui l’était, soit les deux.
En 2019, je suis venu moi-même. L’Etrange Festival avait gentiment programmé une rétrospective de mes premiers films, j’en ai alors montré plusieurs. Et en découvrant le festival de mes propres yeux, j’ai compris pourquoi il y avait autant de public, pourquoi il y avait autant d’amour ! Parce que je crois que ce n’est pas juste un festival… c’est un phénomène ! L’Etrange Festival est comme un immense club de cinéphiles permettant aux gens de se réunir pour découvrir, discuter du cinéma. Découvrir des films rares, des pépites, des films cultes. Et non seulement se réunir et en parler : c’est un festival qui génère du nouveau cinéma, parce qu’il génère des rencontres entre des gens qui ont ensuite envie de travailler ensemble, qui donnent le la de certaines tendances cinématographiques permettant ensuite de créer de nouveaux films. Et n’est-ce pas le meilleur que peut donner un festival ?

Cadet (©Tiger Films)
Vous êtes un cinéaste très prolifique ; vous tournez avec une moyenne approximative de deux films par an sans que jamais vos œuvres ne soient cheap. Elles sont toujours très bien écrites, souvent dramatiquement puissantes. L’écriture doit être très rapide, de même que les tournages. Quelle est votre méthode de travail ?
Si je devais résumer ma méthode en un seul mot, j’emploierais « paranoïa » (Rires) J’ai toujours peur que quelque chose ne fonctionne pas. Je suis toujours très inquiet. Par exemple, je fais en général entre vingt et trente versions de mes scénarios, et il m’arrive souvent, au bout de ce long processus, de m’en débarrasser définitivement. Il y a beaucoup de projets que j’ai écrits, ré-écrits et ré-ré-écrits et pour lesquels j’ai progressivement perdu la flamme, pour lesquels j’ai compris que cela donnerait un film que je n’ai pas envie de faire, et que j’ai donc jetés. Les films qui parviennent à voir le jour après tout ce processus ont été très modelés.
Une fois que j’ai fait toutes ces versions et qu’on commence à passer à la phase de la réalisation, je me mets à vérifier le scénario lors des répétitions avec les acteurs, et j’améliore, j’affine toujours en confrontant mon scénario aux personnes qui vont l’incarner. Là se trouve la paranoïa envers mes scénarios : je veux toujours les améliorer car j’ai toujours peur que quelque chose ne fonctionne pas. Et quand débute le tournage, je vérifie constamment ce que je fais ; tous les soirs de tournage, je revois tous mes rushes pour vérifier ce que les prises de vue ont donné, si tout a marché ou non. Je dis souvent que mon scénario change jusqu’au clap de début de tournage du plan, et qu’il ne s’achève véritablement que lorsque j’ai entièrement fini le montage du film. Je ne cherche qu’à l’améliorer constamment, constamment durant toute la production. Ce n’est pas parce que j’aime l’improvisation, comme certains pourraient le penser ; je ne tiens qu’à l’amélioration ! J’ai cette même recherche avec les acteurs et lors du montage : je répéte énormément, je discute avec mes acteurs et avec mes équipes. Je suis très ouvert à leurs suggestions. Et pour répondre à la question de la raison du nombre conséquent de mes films sans qu’ils ne soient faits au rabais, c’est peut-être justement parce que nous sommes une équipe très soudée et que nous travaillons de concert.
On a pu voir quelques-unes de vos références lors de la Carte Blanche que vous a autorisée la programmation de l’Etrange Festival, mais il semble y en avoir d’autres, encore plus significatives. On peut par exemple penser au cinéma de Takeshi Kitano, et plus particulièrement à ses premiers films (Violent Cop, Sonatine…) en voyant vos propres œuvres, teintées d’une vraie noirceur à laquelle vous alliez un certain humour à froid.
C’est très juste de parler de Kitano. Je l’adore. Je me souviens, quand j’avais quatorze ou quinze ans, que c’était la première fois que l’on montrait son cinéma à la télévision kazakhe ; ils avaient fait une rétrospective de ses films et ils en montraient un par jour, à une heure du matin. Un peu par hasard, j’ai regardé le premier, c’était A Scene at the Sea (1991), et j’ai immédiatement été harponné. Et donc, rituellement, j’ai continué à me coucher tard pour regarder ses films, et en dix nuits, j’ai vu presque toute sa filmographie d’alors. Je me suis alors dit que c’était un cinéma incroyable. A l’époque, je pensais que l’art et essai, c’était du cinéma ennuyeux. Je ne savais pas qu’un jour, mes propres films seraient catégorisés comme de l’art et essai, mais à l’époque, pour moi, art et essai, cela voulait dire noir et blanc, le cinéma à la Bergman. Je n’aimais pas cela, ces films-là ne m’attiraient pas du tout. Et j’ai vu Kitano. Et j’ai trouvé cela très drôle, très proche de moi, très compréhensible, avec des gags visuels qui fonctionneraient de façon universelle, avec un humour que l’on pourrait presque trouver dans la cour en bas de l’immeuble de chez soi parmi les gamins… Et puis soudain, les films basculaient et on se retrouvait du côté de la tragédie antique. J’ai trouvé cette approche très forte.
A cette époque, je ne faisais pas de films, je dessinais des bandes dessinées, comme pouvait le faire un gosse de quatorze-quinze ans, avec des crayons et des feutres. Visuellement, c’était très naïf, et il faut dire que je ne dessinais pas très bien. Mais les thèmes que je développais étaient très graves : je parlais de la mort, de souffrance existentielle. Et j’ai retrouvé chez Kitano quelque chose de cet ordre-là : une œuvre qui se présente sous des allures enfantines mais ayant un contenu très sérieux. Je ne suis dit que c’était ce cinéma-là que je voudrais faire. Kitano était donc mon premier maître en cinéma.
Et en ce qui concerne le cinéma américain ? Le personnage principal de Moor a quelque chose des héros de Michael Mann, un personnage taiseux qui exécute ceux qui pourraient mettre en péril son entourage…
Très juste ! Michael Mann, tout à fait ! James Caan dans Le Solitaire (Thief, 1981), formidable ! Michael Mann est très important pour moi. C’est un peu Kitano sans humour. Il a son charme, son propre univers. J’ai découvert Heat (1995) quand j’avais treize ans, c’est-à-dire à l’époque où l’on pose les bases de cinéphilie, et cela a été un film fondateur. Ce qui est amusant, c’est qu’avec les camarades avec lesquels j’ai découvert ce film, on était en désaccord car ils trouvaient que c’était un film d’action ennuyeux, alors que moi, je le trouvais absolument dingue ! J’ai dû voir ce film mille fois, et à chaque fois que je le revois, je découvre de nouvelles strates dans la sédimentation de la mise en scène. Heat est un peu comme une Iliade, où chaque personnage est un personnage principal. J’adore la façon qu’a Mann de construire ses personnages, à mon sens nietzschéens. Chacun de ses héros est un peu le « dernier des Mohicans », le dernier de son espèce en voie d’extinction. J’aime le souffle épique de ses films, j’adore la façon qu’il a de travailler la lumière avec laquelle il s’avère souvent novateur. Avec Le Solitaire, son travail sur les néons était très en avance sur son temps, par exemple. C’est certes un cinéaste commercial mais Michael Mann est bien plus que cela, c’est un véritable auteur. Pour moi, c’est une idole. (Un temps) Et s’il devait y avoir un triumvirat du cinéma, selon moi, outre Kitano et Mann, je rajouterais Jean-Pierre Melville.

Moor (©Arizona Distribution)
Votre cinéma était très noir, et il est passé à un au-delà du noir depuis quelques temps, plus précisément depuis Steppenwolf (2024). Vous avez basculé vers un cinéma plus nihiliste. Est-ce en rapport avec la situation politique de votre pays ?
(Un temps) Oui, c’est sûr que ce qui se passe dans le monde ne m’est pas indifférent, cela résonne en moi. Pour ne citer que deux événements, la tentative de coup d’Etat en janvier 2022 au Kazakhstan, mais également l’invasion russe en Ukraine m’ont marqué. Tout cela ne prouve que l’absurdité de l’arbitraire de la violence s’imposant à nous. On se rend compte que la paix est une sorte d’illusion extrêmement fragile. On avait l’impression de vivre dans un monde où la raison dominait, où il y avait des limites, des choses qu’on ne pouvait pas faire. Qu’on n’était plus au Moyen-âge. Et soudainement, tout cela a basculé, on se retrouve comme dans un western où seul le tir bien visé parvient à trancher les situations. Le droit du plus fort devient la règle. Ce sont les lois du cinéma de genre, en fait ! Steppenwolf est donc le reflet de toutes ces émotions et de toutes ces réflexions.
Je pensais aussi à Cadet, tourné cette année mais situé en 2022, année du coup d’Etat, et qui vous permet pour la première fois de recourir réellement au cinéma d’horreur…
Oui, mais pour moi, Cadet était aussi une sorte de jeu. J’ai été approché par la société Tiger Films, une grosse société de production kazakhe faisant du cinéma commercial, et pas du tout de cinéma d’auteur. Mais ils sont cependant venus me voir en me disant : « Travaillons ensemble. Faisons quelque chose qui serait à la fois du cinéma d’auteur et du cinéma de genre. » Je leur ai répondu que si je devais vraiment faire un film de genre, je voulais m’attaquer au cinéma d’horreur. Parce que je pensais que dans le cinéma d’horreur, je pouvais créer un style qui ressemblerait à mon style propre. Cadet se love donc dans une enveloppe de films d’horreur afin de raconter ce que je pense du monde. Je pense que le film s’inscrit dans cette veine très actuelle de l’elevated horror.

Steppenwolf (©Blue Finch Films)
Et pouvez-vous parler en quelques mots de Kazakh Scary Tales que, comme certains festivaliers, nous ne pourrons pas voir lors de cet Etrange Festival [du fait du blocage du Forum des Halles lors du mouvement social du 10 septembre dernier] ?
Cette série est assez mystique, c’est donc assez cohérent que de façon inattendue, suite à des désordres, la projection ait été annulée. (Rires) Elle a été commandée et produite par une nouvelle plateforme de streaming au Kazakhstan, Freedom Media, qui va ouvrir au mois d’octobre. Kazakh Scary Tales sera l’un des tout premiers contenus de cette plateforme, et j’en suis très heureux et honoré. Au départ, nous avons pensé cette série comme une anthologie d’histoires basées sur le folklore kazakh. Mais j’ai imaginé une ligne narrative permettant de relier l’ensemble des épisodes (il y en aura dix en tout). Cette ligne narrative reliera un policier et une chamane. Nous y croisons des monstres du folklore : Albasti, Jesternaki, Superi… Dans tous les folklores, il y a des monstres, que l’on retrouve un peu partout, tout cela est assez universel : des vampires, des sorcières… Mais au Kazakhstan, on peut remarquer que les monstres folkloriques sont presque exclusivement des femmes. Je trouve ce rapport aux aspects démoniaques attribués aux femmes vraiment très intéressant.
Comment l’expliquer ? Je pense que dans la steppe, les femmes avaient beaucoup moins de droits que les hommes, ce qui provoquait beaucoup d’injustice et de désespoir. Et que les hommes avaient très peur de la colère et de la vengeance possible des femmes désespérées. Dans la série, c’était mon leitmotiv : ce sont des histoires de femmes offensées qui se transforment et deviennent des monstres. Mais je vais vous spoiler un peu la série : selon moi, les vrais monstres de la série, ce sont les hommes.
Votre cinéma est ancré dans l’histoire de votre pays, dans son folklore, dans sa géographie. Mais son centre névralgique est bel et bien la ville imaginaire de Karatas. Que représente-t-elle pour vous ? Un laboratoire politique ?
Soyons honnêtes : dans un premier temps, Karatas existe pour une question pratique. Parce que c’est très pratique de situer une action dans un lieu qui n’est pas de référents réels. On peut inventer ce qu’on veut. Quand on filme dans un lieu réel tel qu’il est et que l’on peut nommer, il y aura toujopurs quelqu’un qui connaît le lieu et qui vous dira : « Oui mais là, ça ne marche pas ! En vrai ça se trouve pas là ! Et ça ne peut pas marcher comme ça ! » J’enlève toutes les questions possibles. Je peux filmer à un bout de la ville, carrément changer de ville pour le plan suivant… c’est Karatas !
Mais évidemment, il y a plus que cela. Pour moi, quand je dis que l’action se passe à Karatas, cela signifie qu’il n’y aura pas de soirées chics et glamours. Ce sera une histoire honnête, avec de la réalité sociale et de la cruauté. Je ne suis pas là pour faire plaisir et mettre des paillettes. C’est plus qu’un lieu, c’est peut-être une philosophie. Et ce qui est intéressant, c’est que c’est peut-être un lieu qui ne m’appartient plus vraiment. Récemment, deux films kazakhs à succès sont sortis, Dastur [Kuanysh Beisekov, 2023] et Qaitadan [Duman Yerimbek, 2025] ; dans l’un, on cite carrément Karatas, et dans l’autre on parle d’un village appelé Karagash. C’est donc aujourd’hui un toponyme qui n’existe plus seulement pour moi ; il existe pour les autres, et il indique qu’à cet endroit, il y a de la réalité sociale et des idées sur le fonctionnement du monde.

Assaut (©Destiny Films)
Votre filmographie peut être vue comme un fil tendu influencé par votre histoire personnelle, elle-même influencée par l’Histoire nationale de votre pays. Ce qui est intéressant dans l’observation de ce fil, ce sont les effets d’échos dans votre cinéma : les lieux de tournage réutilisés (l’école militaire de Cadet employant par exemple le même bâtiment que le collège d’Assaut [2022]), les spectres de Moor ayant les mêmes attributs et les mêmes pouvoirs que ceux de Cadet… Que pensez-vous de l’idée d’une filmographie considérée comme une nouvelle Histoire qui lui serait interne ?
C’est une question intéressante. Je pense que parfois, tout cela s’imbrique de façon inconsciente. Une pensée me préoccupe, m’obsède ; elle va passer de film en film sans forcément que je ne le formule tel quel. J’utilise souvent les mêmes ingrédients mais pour faire une sauce différente. Mon cinéma est un peu comme une cuisine où j’essaie toujours de préparer le cocktail idéal, je mélange mes divers ingrédients mais les éléments premiers sont cependant souvent les mêmes. Tout devient alors question de combinaison. Par exemple, si l’on prend Moor, c’est un homme et une femme en duo ; dans Steppenwolf, c’est la même chose, mais je les ai juste changés de place. Qu’est-ce que ça produit ? C’est un peu une expérimentation de différentes combinaisons. Mais oui, en effet, on retrouve souvent des motifs similaires : les masques, les fantômes… Je suis un peu comme un savant fou dans mon laboratoire essayant de donner vie à quelque chose en changeant de place les éléments. Parfois cela marche, parfois non. Mais tout cela m’amuse.
Pour finir, votre cinéma est parsemé de références littéraires occidentales (Hermann Hesse dans Steppenwolf, Descartes scandant Cadet, sans compter les nombreuses références littéraires de L’Education d’Ademoka [2022]…). Mais dans une vue d’ensemble de votre cinéma, l’absurdité camusienne semble déterminante. Qu’en pensez-vous ?
Oui… Par ailleurs, le titre du film La Tendre indifference du monde (2018) est une référence directe à L’Etranger de Camus…

La Tendre indifférence du monde (©Arizona Distribution)
Je le sais bien, c’est pour cela que je vous pose cette question. (Rires)
Je trouve très importantes les premières lignes qui ouvrent L’Etranger d’Albert Camus : « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. » On plonge directement dans la pensée de Camus, qui parle de cette indifférence, de cette incapacité à s’émouvoir de la marche du monde, mais aussi de chose très graves qui arrivent autour de nous. C’est quelque chose que je retrouve aussi chez Michael Mann. A la fin de Collateral (2004), quand le personnage de Tom Cruise meurt, il dit une phrse qui ressemble à la première phrase du roman de Camus, une chose du genre : « Quand j’étais dans l’avion de Dallas à los Angeles, j’en n’avais rien à cirer de rien… ». Au fond, les deux œuvres parlent de la même chose. Ce rapport au monde me fascine, ce monde qui reste indifférent : des bombes explosent, des gens meurent et pourtant la vie continue, la nature fleurit, comme si de rien n’était. La nature est indifférente à ceux qui l’entourent : si la planète explose, peut-être la vie continuera ailleurs, ou autrement. C’est un fondement de mon esthétique, cette tendre indifférence du monde.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).