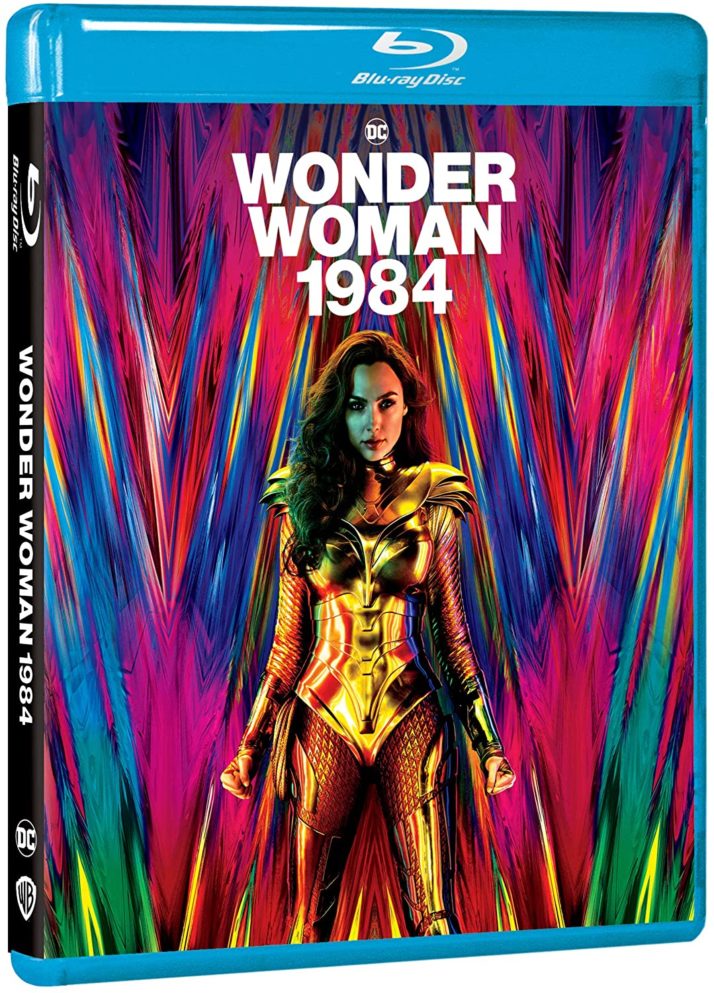En 2016, l’Univers cinématographique que tente de mettre en place DC pour concurrencer Marvel prend sérieusement du plomb dans l’aile. À l’échec artistique de Batman v Superman (Zack Snyder) s’ajoutent des résultats commerciaux en deçà des attentes qui amènent Warner à réorienter le ton de son Suicide Squad (David Ayer) prévu quelques mois plus tard, afin de surfer sur le carton de Deadpool (Tim Miller). Si cette deuxième sortie sauve les apparences sur le plan du box-office, elle illustre une absence de ligne directrice réfléchie quant à l’approche que souhaite donner la firme à ses mastodontes super-héroïques, hésitant entre sérieux sentencieux post-Nolan et légèreté pop dans le sillage de son rival tentaculaire. À la surprise générale, l’année suivante, Wonder Woman s’octroie très largement les faveurs de la critique et du public en suivant un modèle d’origin story classique, à l’efficacité éprouvée ailleurs, tout en reniant tout semblant de personnalité. Produit par l’inénarrable Zack Snyder, le film signé par Patty Jenkins (quatorze ans après son coup d’essai Monster, davantage resté dans les mémoires pour les prestations de ses actrices que ses ambitions formelles) devient d’un même élan le plus gros succès pour un long-métrage mettant en scène une super-héroïne, mais aussi pour une œuvre réalisée par une femme. Indépendamment de sa qualité, il acquiert ainsi une valeur symbolique aussi contestable que concrète, faisant de lui une sorte d’étendard d’un bouleversement de façade au sein de l’industrie hollywoodienne. Une séquelle inflationniste était logiquement attendue, le budget passe donc de 149 Millions $ à 200, le cachet de Gal Gadot est drastiquement augmenté (10 millions $ contre 300 000 pour le premier épisode), tandis que la réalisatrice occupe cette fois-ci deux postes supplémentaires, à la production et au scénario. Neuvième opus du DCEU (DC Extended Universe), il connaît plusieurs reports tout au long de l’année 2020 en raison de la pandémie, avant de sortir simultanément sur la plateforme HBO Max et dans une poignée d’écrans américains, ainsi que quelques territoires dans lesquelles les salles sont restée ouvertes. En France, son sort est simplifié, disponible en VOD depuis le 31 mars, il arrive en DVD/Blu-Ray le 7 avril, soit une configuration inédite pour un blockbuster de cette échelle financière. Deux nouveaux venus dans la galaxie DC rejoignent la distribution, Kristen Wiig (après le refus d’Emma Stone) et Pedro Pascal (connu notamment pour son incarnation du Mandalorien de la série éponyme). Diana Prince (Gadot) s’est intégrée à la civilisation et continue sa vie parmi les humains, même si elle revêt de temps en temps son costume de Wonder Woman pour aider les autres, en prenant bien soin de cacher toute trace de son passage. En 1984, elle travaille pour la Smithsonian Institution à Washington, D.C.. Elle y fait la rencontre du Dr Barbara Ann Minerva (Wiig), une nouvelle collègue qui souffre d’un profond manque de confiance en elle, et la prend rapidement comme exemple. Barbara est chargée d’identifier plusieurs antiquités récupérées lors d’un casse. Parmi ces dernières se trouve une pierre dont la légende raconte qu’elle exauce les vœux de celui qui la tient entre ses mains. Cette mystérieuse relique attire l’attention de Maxwell Lord (Pascal), un entrepreneur charismatique au bord de la faillite et prêt à tout pour retrouver la gloire…

Copyright 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.
Disons-le tout net, Wonder Woman 1984 constitue un désastre artistique spectaculaire, faisant de lui un exemple symptomatique de blockbuster fade et lissé, excluant de fait toute ambition. La violence est à la fois quasi absente et paradoxalement bêtement inconséquente, tandis que les éventuelles aspérités des personnages, au mieux purement fonctionnelles, se révèlent gommées au maximum, réduites à néant ou à l’état d’archétypes vus et revus. Est-ce une surprise au sein d’une production hollywoodienne contemporaine n’hésitant plus depuis longtemps à confier ses projets d’envergure à des yes men interchangeables (quelle différence existe-t-il réellement entre les frères Russo, David Leitch ou John Watts ?), au point de faire passer des réalisateurs tels que Paul W.S Anderson, Michael Bay ou même Zack Snyder, pour des auteurs en puissance. Ces données prises en compte et assimilées, le long-métrage s’avère tout de même incroyablement avare en spectacle et totalement indigne d’un tel budget. Du combat contre la méchante Cheetah (au design rappelant les heures sombres du Cats de Tom Hooper), filmé dans une pénombre aux airs de cache-misère, à ce plan trop long sur une colonne en carton-pâte digne des films Cannon, tout paraît cheap et de mauvais goût. L’un des seuls passages témoignant d’un semblant de recherche esthétique (un vol en jet pendant le feu d’artifice du jour de l’indépendance), plutôt que créer la sidération visuelle à laquelle il pourrait prétendre, frappe par sa gratuité, sa vacuité et constitue un frein à la progression d’une intrigue déjà tout sauf palpitante. Au gré de péripéties neurasthéniques voire totalement aberrantes (l’impossibilité de voyager sans passeport), le récit suit donc l’héroïne et son petit ami revenu à la vie sous un prétexte pour le moins tiré par les cheveux (mention spéciale à la calamiteuse prestation de Chris Pine, trouvant son acmé dans la scène de découverte du monde « moderne »). Doté d’une durée excessive et absurde de 2h30, le tout prend des atours d’interminable et peu excitant épisode de la série télévisée des 70’s, auquel le métrage rend un hommage appuyé et peu subtil au travers d’un caméo. Confinant les avancées des personnages à de simples coïncidences (le premier film de super-héros Lelouchien ?) ou coups de chance (le bad guy rencontré par hasard sur une route, un billet d’avion trouvé dans une poubelle, un plan de satellite négligemment épinglé au mur) le scénario écrit à six mains (notamment en collaboration avec l’auteur de comics Geoff Jones), tourne rapidement à la farce pure et simple. Si seulement les morceaux de bravoure étaient au rendez-vous… Mais sur ce versant-là, ces nouvelles aventures de l’Amazone se révèlent d’une banalité peu commune, rendant n’importe quel volet de la saga Avengers aussi inventif et maîtrisé que du John McTiernan. Entre climax mous (la séquence avec les camions en Égypte) et économie de moyens incompréhensible, à l’instar de ce flash-back en Grèce antique, réduit à des plans très rapprochés, le plaisir du spectateur est quelque peu oublié. L’introduction est en cela symptomatique : un tournoi organisé sur l’île des Amazones est illustré à travers des exploits en CGI moches, rendus anodins par manque de mise en scène, plus proche des épreuves de Fort Boyard que d’une olympiade échevelée. S’ensuit un montage des aventures de Diana dans la décennie 80, surdramatisant chacune de ses actions, pourtant aussi peu excitantes que franchement convenues. S’ajoutent le contexte des eighties, dont le revival est déjà faisandé depuis quelques années, des histoires de prophétie maya et de menace soviétique comme dans n’importe quel nanar de vidéoclub, ainsi qu’un fan service stérile (l’armure inspirée par une BD dessinée par Alex Ross), démontrant, si besoin était, que la pop culture commence à sérieusement se mordre la queue. Si le premier opus offrait au moins son lot d’iconisation à outrance (certes appuyée sans finesse par les ralentis hérités du producteur Zack Snyder, dont Jenkins s’est émancipé à l’occasion de cette suite), ici tout est d’une platitude absolue, loin d’une quelconque ambition cinématographique. La présence du chef-opérateur Matthew Jensen, déjà à l’œuvre sur l’épisode précédent, qui a principalement travaillé pour la petite lucarne, couplé aux divers plans sur des écrans télé parsemés au cours du long-métrage, fait presque office de note d’intention inconsciente sur ce point. Autre preuve de ce manque d’originalité et de personnalité, l’utilisation du thème de Sunshine signé John Murphy lors d’une séquence aérienne, alors que le score est signé par l’expert des bandes originales de super héros, Hans Zimmer, donnant au tout des allures de copies de travail non finalisée. Néanmoins, tous ces défauts pourraient passer pour une inconsistance pop et décérébrée engageant à la clémence, si Wonder Woman 1984 ne prétendait pas à des velléités thématiques militantes.

Copyright 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.
Entre la réalité d’un film et le fantasme qu’il peut constituer dans l’inconscient collectif, il y a parfois un décalage énorme. Érigé par certains et certaines, comme une date cruciale dans la culture populaire selon une grille de lecture non cinématographique, uniquement fondée sur des idées préconçues : le sexe de l’héroïne et de sa réalisatrice constituant deux éléments suffisants pour faire du premier Wonder Woman, un film profondément féministe. Une vertu qui se limitait en réalité à une petite blague balancée en coup de vent, le reste n’étant que le décalque d’une formule désormais bien connue au sein des aventures portées par des homologues masculins. Cependant, à n’en pas douter, la production et Patty Jenkins n’ont pas été sourdes à ces compliments et avaient visiblement à cœur de pousser le curseur « engagé » via cette suite. On ne va en aucun cas blâmer ce désir d’épaissir le propos et cette volonté de répondre à des problématiques contemporaines, mais le fait est qu’entre des intentions potentiellement louables et leur concrétisation, le long-métrage a tout faux. Pire il finit par épouser la même logique binaire et manichéenne que ce qu’il prétend dénoncer. Quand Wonder Woman 1984 prend, à travers les personnages de Diana Prince et de Barbara, le parti de présenter des femmes intelligentes occupant des postes prestigieux, les dialogues ne décollent pas au-delà de discussions sur les chaussures à talons (une thématique qui revient à plusieurs reprises) ou la valeur marchande d’une pierre millénaire. Entre cliché féminin éculé et approche capitaliste de l’art, se tient là un premier fossé entre un progressisme de surface et une nature intrinsèque de grosse production destinée à brasser un maximum de recettes. La même Barbara, dépeinte sans subtilité comme faible et laide, ne peut s’en remettre qu’à des qualités décriées telles que la gentillesse, la dérision et une bienveillance démonstrative (on prend le soin de nous la montrer donnant à manger à un sans-abri) pour maigrement exister. Lorsqu’elle a l’opportunité d’exprimer ses souhaits profonds, ceux-ci se résument à être « forte, sexy et cool » comme Diana, donnant l’impression de réciter les pages estivales d’un vulgaire magazine tendance avec une superficialité dérangeante. Wonder Woman, super-héroïne en puissance, voit son combat pour la cause féminine limité à refuser la galanterie d’un homme lui laissant la priorité pour prendre le taxi. Pire, elle ne semble vivre que dans le regret de l’amour perdu de Steve, une dépendance affective loin de toute forme d’émancipation personnelle. Convaincue que cette vision puérile et creuse du combat féministe suffit, la cinéaste n’arrange pas les affaires en filmant systématiquement des femmes victimes (une scène d’agression par un yuppie grotesque et ridicule au point de faire passer Death Wish pour un documentaire de Raymond Depardon), sans le moindre point de vue, quand elle ne glisse pas dans la bouche de sa protagoniste des punchlines prétendument progressistes (« I Hate guns ») qui n’ont rien à envier à Steven Seagal ou autre yakayo bas du front. Ces aspirations de premier blockbuster post-#MeToo ne font en définitive rien de mieux que de transposer les pires stéréotypes, qu’ils soient féminins ou masculins, jusque dans les actes de l’Amazone, forcément douce, retenant les méchants afin d’éviter qu’ils ne se fassent trop mal en tombant. Au final, la dimension « woke » du long-métrage résulte ni plus ni moins que du calcul marketing ciblé, asséné tel une devise publicitaire boiteuse dans la veine de celles chères au grand méchant du récit, dévoilant ainsi en prime, un cynisme furieusement antipathique.

Copyright 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.
En effet, Maxwell Lord, entrepreneur sur le déclin refusant d’être un « loser », pensé comme un simili-Donald Trump (au moins aussi caricatural que son modèle), débite tout du long des formules toutes faites aux allures de pseudo mantras. Là encore, l’objectif est avant tout de s’attirer la sympathie des nombreux détracteurs du désormais ex-président Américain. Bien qu’ennemis, la lutte de Wonder Woman ne cesse de rejoindre une même logique binaire que ce dernier, à travers des slogans aussi naïfs que creux : « si tu fais le bien, le monde deviendra bon », « si vous en rêvez, vous pouvez l’avoir ». Cette lecture du monde consistant à renverser la « pensée » Trumpiste en se contentant de la décliner sous un angle prétendument positif, est doublement coupable. D’une part, elle ne remet pas fondamentalement en cause les raisonnements simplistes à l’origine du succès de l’homme d’affaires entré en politique, d’autre part, elle accouche de résolutions complètement hors des réalités, voire pire, purement scandaleuses d’un point de vue dramaturgique. En ce sens, la résolution du film a des airs de doigt d’honneur adressé au spectateur patient et en quête de climax afin de finir sur une note réjouissante, en plus d’être difficile à avaler sur le plan de la seule crédibilité. Pire encore, Lord en devient le seul personnage un tant soit peu consistant, tiraillé entre ses ambitions, sa volonté de sauver les apparences coûte que coûte et son rôle de père. Pathétique et foncièrement grotesque, le bad guy se démarque par le jeu excessif de son interprète, Pedro Pascal. Dans la représentation quasi constante, cabotinant comme un beau diable, le comédien se hisse au-dessus d’un casting transparent (seule Gal Gadot semble moins fade que dans le premier opus), à grands renforts de gesticulations et de grimaces dignes d’un Nicolas Cage sous ecstasy (source d’inspiration revendiquée par l’acteur de Mandalorian). Sans que l’on ne sache vraiment si l’on est en présence d’une prestation foncièrement à côté de la plaque ou d’une performance kamikaze et fascinante, ce one-man-show devient, par défaut, le seul motif de réjouissance du long-métrage. Au lieu de créer une antipathie et un rejet idéologique envers cet antagoniste outré, machiste et vulgaire, le film en fait une sorte de bouffon polarisant toute l’attention du spectateur, finissant par créer un relatif attachement envers cette figure clichée d’immigré voulant cacher ses origines sous une décoloration du plus bel effet (son vrai nom est Maxwell Lorenzado). Définitivement raté sur tous les tableaux, Wonder Woman 1984, non content d’incarner un point de non-retour dans le genre par son absence totale de cinéma, devient contre-productif tant son message superficiellement asséné se retrouve parasité, voire retourné, par l’absence de charisme de ses figures héroïques et la démesure de son méchant.

Copyright 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).