Les années 80 sont une période faste pour les adaptations de Stephen King au cinéma, l’auteur se retrouvant transposé sur grand écran à de nombreuses reprises, souvent par des réalisateurs talentueux, avec notamment Shining de Stanley Kubrick, Stand By Me de Rob Reiner, Creepshow de Georges Romero, Dead Zone de David Cronenberg (sans compter son seul passage derrière la caméra, l’oubliable Maximum Overdrive en 1986)… Si les 90’s seront plus enclins à se pencher sur le versant dramatique de son œuvre (Dolores Claiborne, Misery, Les Évadés, La Ligne verte…), confiant le fantastique à la production télévisuelle (Le Fléau, le téléfilm en deux parties Ça – Il est revenu…), la décennie 2000, quant à elle ne verra naître que des déceptions ou de terribles ratages (Fenêtre secrète, Chambre 1408, l’inénarrable Dreamcatcher) à l’exception notable du formidable The Mist en 2006. Alors que l’impressionnant score au box-office de Ça (dont le calamiteux deuxième volet ne saurait ternir la bonne surprise que fut le premier opus) semble confirmer l’amour du public pour le romancier (passons poliment sous silence la débâcle de La Tour sombre), il est temps de se pencher sur une franche réussite sortie en 1983, aujourd’hui disponible dans un superbe coffret collector édité par Carlotta : Christine. Petit flash-back, alors que John Carpenter peine à se remettre de l’échec (incompréhensible), tant critique que publique de son chef-d’œuvre The Thing, il se voit proposer par Columbia de prendre les rênes de l’adaptation d’un roman, considéré par beaucoup comme l’un des plus faibles de King. Il abandonne alors le projet Charlie (autre livre de l’auteur du Maine que le cinéaste devait porter à l’écran), pour se pencher sur les mésaventures d’Arnie (Keith Gordon qui remplaça au pied levé Kevin Bacon, comme évoqué dans le documentaire Ignition présent en bonus), jeune lycéen timide et mal dans sa peau qui trouve confiance en lui au contact d’une Plymouth Fury de 1958. Mais la machine maléfique douée de conscience le fait peu à peu basculer dans la folie à mesure que son amour pour Christine (comme elle est surnommée) grandit…

© Copyright Carlotta Films, 2019
Objet de fantasme par excellence, la voiture a toujours eu une place à part au sein du Septième Art. De la Ford Mustang de Steve « Bullit » McQueen en passant par la Dodge Challenger de Vanishing Point, Hollywood a su, tout au long des décennies, associer dans l’inconscient collectif l’automobile à un esprit de liberté, sortes de destriers modernes pilotés par des cow-boys modernes le long de routes désertiques ou de mégalopoles bondées. Mais chaque idéal à sa part d’ombre et des longs-métrages comme Enfer mécanique, la saga Mad Max, voire Duel (si l’on pousse jusqu’aux poids lourds) n’hésitent pas à montrer ces machines comme des instruments de mort (ce que la réalité vient souvent corroborer, en témoigne l’accident de James Dean au volant de sa funeste Porsche Spider), voire comme de véritables prédateurs. Christine se situe à mi-chemin entre ces deux visions. Dans un premier temps, la Plymouth représente pour Arnie, victime de tous les bullies du lycée, le rêve absolu, le moyen d’être enfin respecté par ses camarades de classe et, par-dessus tout, par les lycéennes qui ne lui prêtent aucune attention. En un mot, devenir quelqu’un grâce à une possession matérielle, le fleuron de la valeureuse industrie américaine perçu comme un « aimant à filles », permettant au jeune homme de conquérir la belle Leigh (Alexandra Paul). Le film semble alors, en apparences tout du moins, fidèle aux principes prosaïques illustrés par le grand penseur Michael Bay dans Transformers premier du nom à travers la relation Sam/Bumblebee (comme l’a souligné un estimé confère de Culturopoing). Mais John Carpenter n’est pas de la même trempe et cet éloge du matérialisme, montre très vite sa part sombre. Après une première « rencontre » s’apparentant à un véritable coup de foudre, l’adolescent étant prêt à s’endetter pour acquérir la Fury (le nom du modèle n’étant évidemment pas choisi au hasard), leur relation devient presque charnelle (voir cette incroyable scène où le garçon demande à la voiture de révéler son vrai visage dans ce qui ressemble fort à une scène de strip-tease). Le protagoniste ne tarde alors pas à basculer dans une passion aveugle et dévorante, s’opposant à sa famille (qui voit leur « flirt » d’un très mauvais œil), tournant le dos à son meilleur ami Dennis, garçon populaire et fidèle qu’il connaît depuis l’enfance (les scènes coupées visibles dans cette édition révélant une relation très forte entre les deux ados), l’objet tant désiré finissant par posséder son propriétaire, dans une inversion totale des valeurs consuméristes. En échange, Christine l’aide à prendre sa revanche tout en le surprotégeant, jalousant ses fréquentations, animée par une conscience malfaisante. Comme le souligne l’excellent générique accompagné du morceau culte de George Thorogood and The Destroyers, elle est « Bad To the Bones ».

© Copyright Carlotta Films, 2019
Un écran noir durant lequel résonne un bruit de moteur, comme si l’âme de la voiture s’éveillait, puis un simple plan sur une carrosserie neutre parmi des dizaines d’autres le long d’une chaîne de montage que des mains (masculines) modèlent à leur guise jusqu’à donner à la Plymouth son aspect définitif, sa couleur rouge sang, sa personnalité, cette dernière ne tardant pas à commettre son premier méfait. Dans son livre Plus Furieuse que l’Enfer, disponible dans le coffret collector, Lee Gambin revient en détails sur la symbolique misogyne de cette séquence et les sous-entendus féministes qui découlent de la poussée de violence qui s’ensuit. Comme à son habitude, John Carpenter pose en quelques plans les bases de ce qui deviendra un méchant iconique du cinéma. Chez le cinéaste, le Mal est protéiforme, prenant de multiples aspects, des plus classiques (le serial killer d’Halloween) aux plus inattendues (le liquide vert tournoyant de Prince of Darkness), jusqu’à ne plus avoir aucune forme propre, comme l’entité extraterrestre de son définitif The Thing. Ici, il revêt une apparence, banale, quotidienne, et le film ne plonge dans le surnaturel qu’au bout de quarante-cinq minutes, le caractère fantastique et le passif du véhicule n’étant jusqu’alors évoqués que par le vieux George, frère de son ancien propriétaire (Roland) et véritable gardien de sa mythologie. Contrairement au livre dont il est tiré, le scénario de Bill Phillips n’évoque pas le fantôme de Roland comme responsable de la possession infernale de Christine, c’est elle qui est maudite, chaque pièce de son moteur et de son châssis, semblent maléfiques. Big John la filme comme un véritable boogeyman, ne la cadrant que partiellement, un morceau d’aile ou de pare-chocs occupant une partie du plan, comme une menace silencieuse mais bien présente. Grâce au format Scope, aux longs mouvements de caméra de son chef opérateur Donald M. Morgan (déjà à l’œuvre sur le téléfilm Le Roman d’Elvis, remplaçant pour l’occasion Dean Cundey, après une fructueuse collaboration) et au thème angoissant composé au synthé par le maître himself et Alan Howarth, le réalisateur parvient à distiller un sentiment de malaise avant de prendre le spectateur par surprise lors de scènes de meurtre plus inventives les unes que les autres. L’horreur prend même une tournure graphique et explicite lorsque la Fury en flammes poursuit sa prochaine victime sur une route déserte ou qu’insidieusement, Arnie se met à s’identifier à son bolide en ne s’habillant plus qu’en rouge et dissimulant son regard derrière des lunettes de soleil, comme les vitres teintées de sa « chère et tendre » qui semble le contaminer peu à peu. Si la voiture semble aussi invincible que Michael Myers, le danger se retrouve ici logé dans un objet concret, matériel, il peut donc être détruit et vaincu si, comme Leigh et Dennis lors de l’affrontement final, les grands moyens sont utilisés.

© Copyright Carlotta Films, 2019
Au détour de cette ultime séquence d’action, un duel entre le bolide hanté et un bulldozer, Carpenter dévoile son vrai projet, faire de cette adaptation de Stephen King une sorte de récréation, un divertissement tour à tour angoissant et spectaculaire. Reprenant à son compte les codes du teen movie, avec ses problématiques habituelles (nerd souffre-douleur victime d’un gang de brutes, volonté de perdre sa virginité au plus vite…), le réalisateur y montre la banlieue américaine et ses lotissements comme un lieu morne et sans identité, exactement comme il l’a fait dans Halloween (Christine, le long-métrage tout comme le roman, se déroule d’ailleurs en 1978, année de sortie du slasher culte). Tout comme Myers, le Prince des Ténèbres ou les pirates fantômes de Fog, le véhicule est, lui aussi, une menace venue du passé pour hanter le présent. Elle a été fabriquée en 1957, « s’exprime » via sa radio à travers des morceaux de cette décennie et représente le fantasme de réussite et de virilisme véhiculé par l’industrie automobile de l’après-guerre. Pourtant, le cinéaste semble voir en cette période (qui furent ses années d’adolescence) un vent de liberté, guidé par l’émergence du rock et les diverses révolutions en gestation, qu’il oppose aux 80’s balbutiantes et réacs. Ainsi, contrairement au tueur d’Haddonfield qui symbolisait le retour violent du puritanisme en pleine libération des mœurs, la Plymouth, elle, semble punir une jeunesse trop sage et conservatrice, à l’image de Leigh et ses socquettes immaculées qu’Arnie, comme possédé par sa machine, accusera d’être « frustrée sexuellement ». Avec une ironie certaine, le réalisateur transforme donc son film d’épouvante automobile en charge punk contre une jeunesse sclérosée qui, en 1978, est sur le point de porter Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Les « rebels without a cause » ne sont plus, remplacés par de jeunes yuppies ambitieux. Il conclut son thriller par un explicite et ironique « I hate rock and roll » adressé par le très sage personnage interprété par Alexandra Paul à la carcasse encore fumante de la rutilante Christine.

© Copyright Carlotta Films, 2019
Disponible en DVD, Blu-Ray et Coffret Collector chez Carlotta Films.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).




















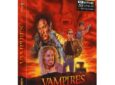



Olivier ROSSIGNOT
super article