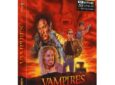Dès la fin des années 60, le cinéma d’épouvante trouve un nouveau souffle grâce à la mouvance réaliste et crue portée par La nuit des morts-vivants de George A. Romero (1968), son acte fondateur, mais aussi La dernière maison sur la gauche réalisé par Wes Craven en 1972 ou encore Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper (1974). Le genre se débarrasse peu à peu de ses oripeaux surnaturels et de ses figures folkloriques pour laisser l’horreur pénétrer le quotidien. C’est dans ce contexte qu’en 1978, les producteurs Mustapha Akkad et Irwin Yablans proposent à John Carpenter, alors tout juste auréolé du succès de son deuxième long-métrage Assaut (1976), un projet qui, après diverses réécritures, deviendra le cultissime Halloween. Co-écrit avec Debra Hill (avec qui il signera The Fog et Los Angeles 2013), le film suit le parcours de Michael Myers, dangereux psychopathe qui, quinze ans après avoir été interné pour le meurtre de sa sœur, s’évade et retourne à Haddonfield (du nom de la ville natale de la scénariste) où il s’attaque à un groupe d’adolescents. Quarante ans plus tard, et alors que David Gordon Green dévoile sa relecture du mythe (pensée comme sa suite), La nuit des masques (de son titre français) a droit à une ressortie en salles dans une version restaurée, démontrant, si besoin en était, l’importance du chef-d’œuvre de Big John.

© Halloween, copyright Splendor Films
Si le long-métrage a autant marqué l’histoire du septième art, c’est qu’il instaure les codes d’une sous-catégorie du cinéma d’horreur, digne descendant des thrillers d’Alfred Hitchcock (Psychose en tête) et du giallo italien : le slasher. Bien que La baie sanglante, réalisé par Mario Bava en 1971, et surtout Black Christmas de Bob Clark (1974) en aient posé les bases (un tueur masqué massacre des adolescent.e.s à l’arme blanche, si possible dans un contexte de fête traditionnelle), c’est le film de Carpenter qui en deviendra le mètre-étalon. Tout au long des années 1980, le genre vivra son heure de gloire, épuisant le filon en décimant des dizaines de jeunes filles, la plupart du temps dévêtues, lors de scènes gores post-coïtales dans des œuvres de qualité variable. Car, sous couvert de plaire à un public de jeunes adultes en manque de sensations fortes, accumulant les séquences violentes et érotiques, le slasher se révèle d’une pudibonderie hypocrite. Les « teenagers », majoritairement de sexe féminins, y sont punis par une figure adulte pour avoir commis le péché de chair, ou avoir consommé des drogues, en bref un violent retour à l’ordre moral venant remettre en cause l’utopie des années Flower Power. Halloween, bien qu’ayant inspiré ses successeurs, se révèle plus complexe et plus ambigu que ces derniers, n’hésitant pas à désigner les valeurs puritaines comme l’ennemi éternel à combattre inlassablement.

© Halloween, copyright Splendor Films
Dès son inoubliable plan-séquence d’introduction en vue subjective, le film nous plonge dans la peau du tueur, nous faisant voir à travers ses yeux lorsqu’il poignarde une jeune femme nue alors que son petit ami vient de quitter la maison. Puis la caméra sort du corps de l’assassin avant de révéler son identité et de s’éloigner en un long mouvement de grue, comme si elle le quittait pour en prendre ses distances. En quatre minutes et deux plans, John Carpenter expose toute sa virtuosité en faisant du spectateur/ voyeur un témoin impuissant de la terrible scène qui se déroule sous ses yeux, en somme, la « punition » d’une adolescente par son petit frère alors que leurs parents s’étaient absentés. Pour le jeune garçon, le sexe semble déjà être une faute à condamner et l’absence de structure (ici familiale) devient une source d’anarchie et d’horreur. C’est notamment lorsque les baby-sitters remplacent les pères et les mères pour une nuit, que le meurtrier sévira de nouveau. Ainsi, quand le personnage d’Annie abandonne son rôle et confie à Laurie (Jamie Lee Curtis) les enfants qu’elle devait garder afin de passer du bon temps avec son petit ami, Myers l’assassine brutalement avant qu’elle n’ait pu rejoindre ce dernier. Les amies de l’héroïne sont des cibles parfaites : délurées, libérées, fuyant leurs responsabilités (l’une d’entre elles est la fille du shérif, figure double d’autorité qu’elle remet en question à de nombreuses reprises), elles sont le cauchemar des conservateurs (le titre provisoire du script était d’ailleurs The Babysitters Murders). Pour Michael, la luxure est évidemment proscrite et châtiée, en témoigne ce massacre à la mise en scène proche du meurtre originel, où il transporte la pierre tombale de sa sœur jusque sur les lieux du crime, semblable à un souvenir, un rappel de ce qui attend quiconque transgresserait la morale. Loin de cautionner la violence punitive de son antagoniste, le réalisateur en fait la personnification du retour en force des valeurs traditionnelles mises à mal durant les années 60 (par le mouvement hippie et la révolution sexuelle), et la crainte que cette résurgence représente. Le docteur Loomis (son psychiatre, interprété par Donald Pleasence) déclare à son sujet « il n’a pas dit un mot depuis quinze ans », ce silence n’étant pour lui qu’un terrifiant mauvais présage. Le conservatisme, l’Amérique dans ce qu’elle a de plus réactionnaire, est perçu comme une menace qui avance littéralement masquée et qui est, au final, impossible à détruire. Face à cette figure cauchemardesque, se dresse donc Laurie Strode, jeune femme téméraire, véritable « final girl » (figure récurrente du slasher) qui semble être la seule parmi la jeunesse américaine représentée, à percevoir le danger, surmontant sa peur en le combattant dans un duel qui s’avérera sans fin (« On ne tue pas le croquemitaine » annonce-t-elle en fin de métrage).

© Halloween, copyright Splendor Films
Lors de ce dernier affrontement, l’adolescente terrorisée se réfugie dans un placard, une réaction qui peut paraître puérile mais qui résume à elle-seule la conception centrale de la peur développée par Halloween. Ici, elle est instinctive, presque enfantine, Tommy, le petit garçon que garde Laurie, parle de « boogeyman » pour désigner Myers, le film étant d’ailleurs le premier à utiliser ce terme candide pour évoquer son serial-killer. Le cinéaste rend la menace palpable, en faisant le choix de filmer la banlieue pavillonnaire comme un terrain de jeu idéal pour le tueur. Optant pour des plans larges filmés en scope sur les jardins et les maisons, et de longs travellings à la grande profondeur de champ, reléguant ses personnages bord cadres, noyés dans le décor. Le moindre élément présent (barrière, buisson, voiture…) devient alors un danger potentiel, une cachette de laquelle le croquemitaine peut surgir à tout moment. La terreur gangrène le quotidien, elle est susceptible de se loger dans le moindre recoin de ce lotissement tranquille, littéralement chez le voisin (en témoigne cette scène où le jeune enfant aperçoit la silhouette menaçante dans le jardin face à sa fenêtre). Voisinage qui, par ailleurs, se révèle totalement inactif et dénué d’empathie lorsque Laurie frappe aux portes afin de demander de l’aide, renforçant l’impression cauchemardesque d’être seule face au Mal. La ville paraît tout à coup déserte, seule demeure l’ombre du psychopathe décimant méthodiquement, calmement, ses victimes. Évitant les jump-scares faciles, Michael n’apparaît pas par surprise, même caché, il est la plupart du temps présent dès le départ dans le cadre, comme s’il ne l’avait en fait jamais quitté, la peur y est plus « lancinante ». Il est libre de circuler à sa guise, noyé dans la foule masquée fêtant Halloween, en liberté, anonyme, discret et invisible, la police, ne prenant pas conscience de la gravité de la menace, préfère ne pas informer la population qui risquerait de « le voir partout », et créer ainsi la paranoïa. Le film contient nombre d’images marquantes, de visions quasi surnaturelles, proches d’une « inquiétante étrangeté », notamment le meurtrier apparaissant à Laurie à travers la fenêtre de l’école ou encore cet adolescent poignardé et littéralement épinglé à une porte et dont le cadavre continue de se balancer. Au détour de quelques plans sur une télévision diffusant The Thing from Another World de Howard Hawkes (dont Carpenter signera un remake en 1982, The Thing, et son extraterrestre protéiforme) et Planète interdite (dans lequel les angoisses se matérialisent en une bête quasi-indestructible), le réalisateur renforce cette idée d’horreur omniprésente et pourtant sans forme, sans contours nets. Le choix du nom du psychiatre, et la présence de Jamie Lee Curtis au casting, renvoient à Psychose, Loomis étant le nom du personnage interprété par John Gavis dans le chef-d’oeuvre de Hitchcock, et la jeune actrice, la fille de Janet Leigh, inoubliable Marion Crane, victime de Norman Bates. À l’instar du personnage campé par Anthony Perkins, Michael Myers s’impose comme une figure iconique de l’épouvante. Mais là où le maître anglais créait un monstre humain, complexe et tourmenté, John Carpenter choisit de faire de son croquemitaine, une « chose », une allégorie, une abstraction.

© Halloween, copyright Splendor Films
Le docteur Loomis ne parle pas du tueur comme d’un Homme, il l’objectifie, employant « it » au lieu de « him » pour le désigner, lui conférant une dimension quasi mystique. Pour lui, il est le Mal incarné, implacable et indestructible, qu’il traque sans relâche depuis des années, faisant du psychiatre un chasseur obsessionnel digne de Van Helsing ou du Capitaine Achab. La plupart du temps Myers est réduit à sa simple silhouette (dans le scénario, il est d’ailleurs nommé The Shape, « la forme »), à son « visage » sans expression (au départ un masque de William Shatner, Kirk de la série Star Trek, modifié pour paraître le plus impersonnel possible), voire au simple bruit de sa respiration. Même absent de l’écran, le « boogeyman » est toujours là, tapi dans l’ombre, prêt à agir, comme dans cette scène d’horreur pure, où c’est la simple buée qu’il produit en respirant qui révèle sa présence à l’un des personnages. Dès la glaçante scène de son évasion et ses patients errant tels des spectres dans la cour de l’hôpital, il n’est qu’une ombre parmi les autres, rien ne le distingue. Lorsqu’il revêt une autre apparence, c’est enveloppé d’un drap blanc, comme un fantôme de cauchemar enfantin, image métaphorique de l’épouvante personnifiée. Si Nick Castle est crédité comme son interprète (en plus de Tony Moran qui lui prête ses traits lors du seul et unique plan où le cinéaste dévoile son visage), en réalité plusieurs personnes l’ont incarné (y compris Carpenter lui-même et Debra Hill), la plupart du temps pour des gros plans ou des images d’insert. Cette anecdote à priori anodine renforce pourtant cette déshumanisation, il n’est pas un personnage, il est un pur objet cinématographique. De la vue subjective de la scène d’introduction, où la caméra se substitue au petit garçon, au thème musical entêtant (composé, comme souvent, par le réalisateur lui-même), en passant par les nombreuses contre-plongées rendant Michael encore plus impressionnant, le concept d’angoisse se synthétise en une figure construite par toutes les composantes de la grammaire cinématographique. Si le cinéaste fait le choix d’une fin ouverte, c’est non seulement pour permettre une éventuelle suite (idée que les producteurs exploiteront jusqu’à en faire une saga, certes lucrative, mais trahissant l’esprit de ce film initial à grands coups de trucages gores et d’effets grand-guignolesques) mais aussi pour laisser le spectateur s’imprégner de cette terreur qu’évoquent les ultimes plans sur de simples rues en apparence désertes. Michael Myers n’est pas seulement un croquemitaine, il est la peur sur pellicule, l’une des plus grandes créatures issue d’un cauchemar cinématographique.

© Halloween, copyright Splendor Films
© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur/ayant droit. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).