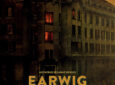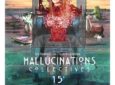C’est avec plaisir et honneur que nous avons pu converser avec la réalisatrice de l’un des tout meilleurs films français de cette année. Lucile Hadzihalilovic nous a offert de son temps pour parler de son rapport aux contes et au réalisme, de ses deux formidables actrices, ainsi que de son rapport aux films de vampires bien visible dans son nouveau film. (Cet entretien a été préparé en collaboration étroite avec Eléonore Vigier, que nous remercions vivement)
Avec La Tour de Glace, vous avez adapté un conte d’Andersen…
Il s’agit moins d’une adaptation que d’une inspiration. Le film ne raconte pas l’histoire de La Reine des Neiges. Nous y retrouvons les thèmes du conte mais c’est la figure la Reine des Neiges, un monde du froid et de miroirs qui m’intéressaient chez Andersen.
Mais pourquoi avoir spécifiquement choisi ce conte ?
A cause de la Reine des Neiges, justement. D’une certaine façon, cette figure-là se retrouve dans chacun de mes films, de façon plus ou moins cachée. Je l’aborde ici plus frontalement… Cette figure de reine froide mais attirante et fascinante, peut-être source de connaissance. On peut même dire que c’est une figure de la mort, si l’on veut. C’est ce qui m’a attiré en premier lieu. Ce qui m’a aussi intéressé dans ce conte, c’est que contrairement à la majorité d’entre eux, l’enfant, dont j’ai fait une jeune fille est le moteur, la protagoniste principale qui va aller à la rencontre de la Reine des Neiges et qui va se confronter à elle.
Après, de manière générale, Andersen est un auteur très inspirant. Il est poétique tout en étant complexe et cruel. La Reine des Neiges ne fait pas partie de ses contes les plus noirs, La Petite Sirène se trouve être bien plus terrible. Mais j’ai choisi de le rendre plus sombre.
Et pourquoi avoir changé le titre du conte pour en faire La Tour de Glace ?
Pour ne pas l’appeler La Reine des Neiges. (rires) Pendant longtemps, cette tour de glace a eu un rôle récurrent dans le scénario, elle revenait dans les rêves… C’était la métaphore de quelque chose, de façon indistincte. C’est peut-être presque la Reine elle-même, finalement. Ce n’est certainement pas un symbole sur lequel on projettera clairement quelque chose mais c’était une image qui revenait naturellement. Lors du tournage et dans le montage, on la voit finalement assez peu, j’ai donc un moment cherché un autre titre, mais je me suis dit que cette tour était évocatrice d’un monde à part. (silence) On peut se demander pourquoi une tour : représente-t-elle un lieu ? le personnage ? le royaume, même si cela aurait plutôt été un château ? Le titre aurait pu être « Le Château de Glace » mais c’était peut-être trop mignon. « La tour » est plus dramatique, plus strict, cela me correspondait mieux.

Des teintes réalistes (C. Pacini, A. Diehl) (©Metropolitan FilmExport)
La liberté de l’adaptation provient du fait que vous l’ancrez dans une forme de réalisme, que vous n’avez pas abordé depuis La Bouche de Jean-Pierre (1996).
Earwig [2021] s’ancrait cependant dans une forme de réalité, mais on s’installait très vite dans le cauchemar du personnage. Mais justement, après ce film-là, je me disais que cela me plairait d’aller vers quelque chose d’un peu plus réel, pour rendre plus facile l’entrée dans l’univers de La Tour de Glace. C’était en effet un peu comme dans mon tout premier film, La Bouche de Jean-Pierre, où la part de réel est importante. Cette envie de réalité se situe dans le foyer où vit la jeune fille du film ; alors c’est très stylisé, très minimaliste, on a peut-être peu l’impression de réel… Par ailleurs, la ville elle-même semble peu réelle… Les aspects de conte restent malgré tout majoritaires. Mais tout cela part néanmoins d’une envie de réalité. (silence) Je ne voulais pas adapter le conte en en faisant stricto sensu un film de fantasy ou un film fantastique. L’idée de « film dans le film » vient également de cette idée ; dans un « film dans le film », je pouvais approcher la dimension fantastique du récit, ou tout du moins son onirisme.
Au regard de La Bouche de Jean-Pierre et du reste de votre filmographie, quel serait alors votre rapport au réalisme ?
Le réalisme, je ne sais pas trop ce que cela veut dire. Le réel peut être plein de choses. Les mondes que j’ai créés sont réels, finalement… Ils sont certes imaginaires, que ce soit Evolution [2015] ou Innocence [2004], ils se déroulent dans des environnements métaphoriques, mais les émotions y sont réelles. J’aime bien dire que mes films sont autobiographiques. Ils ne le sont pas littéralement, évidemment : dans La Tour de Glace, je n’ai pas vécu ce que vit cette jeune fille, mais ce sont des ressentis réels. De même, j’aime tourner dans des lieux réels plutôt qu’en studio. Alors là, oui, nous avons tourné dans un studio parce que l’histoire le nécessitait… Mais c’est un vrai studio ! Nous ne l’avons pas fabriqué, l’endroit est naturellement artificiel, pour ainsi dire. Ce que j’aime particulièrement dans les décors réels, c’est jouer avec la lumière naturelle, ne pas mettre d’éclairage, parce que cela contre-balance le côté imaginaire. S’il y a un mur avec une tache sur laquelle un personnage va délirer, au moins, la tache existe et mène à l’imaginaire. Voilà mon rapport au réel.
Vous disiez que le studio, le « film dans le film », la dimension métafilmique apportaient une part de l’onirisme de La Tour de Glace. Le plateau de cinéma que vous filmez recèle-t-il d’autres enjeux ? Autrement dit, pourquoi enchâsser une adaptation de La Reine des Neiges au sein de votre propre « adaptation » ?
Je vouais cette dualité entre le réel et l’imaginaire qui se côtoient. Après, cela vient aussi du conte, qui contient le motif d’un miroir fabriqué par le Diable et qui reflète le monde de façon déformée. Je n’ai pas gardé cette image dans le film mais cela m’a fait penser aux écrans et à la salle de cinéma. J’ai alors eu l’idée que La Reine des Neiges pouvait être un film en train de se tourner dans le film. Pour le plateau, ce qui me plaisait aussi, c’est l’aspect artisanal de la fabrication d’un film, qu’on voit finalement assez peu dans mon long métrage, mais la démarche était de montrer de quelle manière on fabrique la fausse neige, comment on crée les bouts de décor. J’étais plus intéressé par cela que par les rapports de travail sur un tournage. Ce n’est pas La Nuit américaine, quoi ! J’étais vraiment intéressée par l’idée de montrer la fabrication d’un monde magique et faux.

Onirisme par le métafilm enneigé (©Metropolitan FilmExport)
La première apparition de Marion Cotillard dans La Tour de Glace montre une Reine des Neiges apparaissant majestueuse, ceci suivi d’un « Coupez ! » mélangeant de fait les atmosphères oniriques et réalistes…
Pour la première scène de plateau, on voit d’abord la Reine, avec ses allures fantasmagoriques… La promotion du film dit que cela se passe sur un tournage de film ; les gens qui ont vu le film la première fois et qui n’en savaient rien n’ont cependant pas tout de suite pensé qu’elle se trouvait sur un plateau de cinéma. La jeune fille se réveille, c’est comme un rêve, elle voit cette figure de la Reine des Neiges. Elle a lu le conte auparavant dans le récit, peut-être le rêve-t-elle. Et puis non, elle a l’air vrai, et puis non, c’est un tournage… Le faux, le vrai, le magique, le terre-à-terre se mélangent, en effet. Mais les éléments oniriques viennent tout à la fois du dispositif que du conte lui-même.
L’atmosphère d’Innocence était sylvestre, celle d’Evolution privilégiait les fonds marins et celle d’Earwig l’obscurité des maisons ; pour La Tour de Glace, vous le disiez plus tôt, vous vous attachez à la neige…
Oui, c’est un motif qui me plaisait beaucoup, je ne sais pas vraiment pourquoi mais cela me plaisait de filmer cette neige blanche… Je pensais à l’écran blanc, considérant que tout cela allait bien ensemble. C’était un élément visuel qui m’inspirait. C’est la montagne, la vraie au début du film, la fausse sur le plateau de tournage par la suite.
De fait, comment avez-vous travaillé les textures d’image pour filmer cette neige ?
Nous avons tourné en numérique mais nous avions dans l’idée de donner de la matière, de placer du grain dans l’image. Nous avons donc cherché un type d’image qui renvoyait à la qualité de la pellicule. C’est en effet travaillé, donc, mais… pas plus que le reste, finalement. Après, la neige nous permet de créer de la lumière au sein de l’image ; par exemple, pour les scènes de montagne du début du film, que nous avons tournées au crépuscule et que nous avons assombries, la neige nous a apportés une présence, une lumière naturelle. Le plus compliqué a été de filmer la fausse neige quand elle tombe, de parvenir à trouver le bon dosage. On n’en a pas beaucoup mais quelques séquences restent concernées par cela.
Ce motif de la neige ne pourrait-elle donc pas évoquer le grain de la pellicule que vous recherchiez ?
Cela crée de la matière, c’est sûr. Nous n’avons pas accentué le grain au point de de faire penser à la neige, du même genre que celle envahissant l’écran de télé… On n’a pas filmé d’écran de télé mais c’est vrai que si on avait eu cette idée, on aurait pu jouer sur cette neige des fins de programmes, ou celle des VHS… L’idée était vraiment de sentir de la matière, et nous avons cherché une façon de montrer quelque chose qui ne serait pas numérique, qui ne serait justement pas trop clair ou trop lumineux.
Le son est lui aussi prépondérant, très stylisé. Quels univers vouliez-vous aborder par le traitement sonore de La Tour de Glace ? Etiez-vous là encore guidée par une volonté d’onirisme ?
Le son, plus que l’image, est l’élément le plus intérieur, le plus intime, le plus à même de retranscrire les émotions profondes des personnages. Il agit souvent sur nous de façon inconsciente. Pour le film, l’idée première était d’utiliser des sons réels ; par exemple, au début, il était important que le son des pas de la jeune fille dans la neige donne une sensation de froid et, donc, trouver les bonnes prises de son qui permettraient cela, et non seulement par l’image. Ou encore le vent : il y avait beaucoup d’indications de vent dans le scénario, nous devions trouver des sonorités donnant une impression glaciale. On a beaucoup travaillé sur les sons réels avec le monteur-son qui a également mixé le film [Etienne Haug]. On a aussi pas mal travaillé sur les espaces, sur les résonances, sur les réverbérations, sur les acoustiques aussi bien pour les voix que pour les bruits, pour donner l’impression de la vacuité du studio ou de la grandeur des espaces.
Nous avions aussi l’idée de moments de musique, nous avons privilégié une musique de transe que sont les morceaux de Messiaen, avec les ondes Martenot qui sont un instrument très particulier donnant une sensation un peu trippante, mais aussi des moments plus dramatiques avec des cordes. L’idée générale était vraiment de rendre compte des émotions et des sensations des personnages par le son. On n’en a pas mis beaucoup, mais enlever des sons donnait aussi inconsciemment un effet très particulier à l’atmosphère du film. Jouer sur des silences et les attentes, être minimal en fin de compte, en allant chercher dans l’absence.

Clara Pacini, découverte majeure (©Metropolitan FilmExport)
Le choix des actrices est déterminant dans votre film. Vous aviez déjà filmé Marion Cotillard dans Innocence ; dans un premier temps, je vous demanderai pourquoi…
Pourquoi Marion encore ? (Rires)
… et dans un second temps, je voudrais aborder le cas de la jeune Clara Pacini, qui est absolument formidable. Comment l’avez-vous découverte ?
C’est une trouvaille merveilleuse ! Pour commencer par elle, tout simplement, la directrice de casting avec laquelle nous avons travaillé la connaissait. Clara était inscrite au Conservatoire de théâtre, dont elle vient de finir le cursus. Souvent, les directeurs de casting vont y voir les jeunes acteurs. Elle avait passé quelques castings et avait tourné un court-métrage. Notre directrice de casting avait tout de suite pensé à elle ; elle est venue très tôt dans le casting pour La Tour de Glace, peut-être même le premier jour. C’était compliqué car il était évident qu’elle avait un truc très fort, à la fois ce visage très gracieux et cette sihouette, cette façon de se déplacer plus fortes et déterminées mais qui se faisaient aussi assez adolescentes. Ce mélange était très intéressant pour moi, mais j’avais imaginé une fille de treize ans, et Clara ne faisait pas cette âge-là. On l’avait vue très tôt, on a donc cherché, on a vu plein d’autres filles et… c’était Clara, quoi ! C’était une évidence. Je me disais aussi qu’elle avait un regard très fort, que dans le film, elle n’allait pas beaucoup parler, qu’elle allait faire des tas de choses mais qu’elle allait surtout beaucoup regarder. Il fallait que nous eussions envie de regarder cette fille qui regarde. Et il fallait aussi que face à Marion Cotillard, elle fût à la hauteur
J’avais déjà Marion dans la distribution quand nous avons fait le casting de la jeune fille. Pour elle aussi, c’était une évidence. Il me fallait quelqu’un qui avait ce charisme, ce statut de star. Bien évidemment, elle ne joue pas son propre rôle, heureusement pour elle ! (Rires), mais il fallait quelqu’un dont on se dise d’emblée qu’elle pourrait être une star. Ce que je trouvais superbe avec Marion, c’est qu’elle est certes très belle, très attirante, charnelle mais que j’étais aussi persuadée qu’elle pouvait incarner quelque chose de très froid et dur, qu’on pouvait la voir presque à contre-emploi dans un rôle très noir et très cruel. J’aime également beaucoup le fait qu’elle ait aussi un côté actrice de muet. Elle a quand même un peu de dialogue, mais beaucoup de choses doivent passer par les regards, et elle a une telle maîtrise de son jeu qu’elle peut exprimer beaucoup sans parler… tout en restant moderne dans sa façon de jouer. Tout cela fait qu’elle était parfaite pour le rôle. Heureusement, elle a dit oui ! (Sourire)
Il semble qu’il y ait une relation vampirique entre les personnages : le personnage de Jeanne volant l’identité de Bianca, la relation d’emprise entre les deux personnages principaux…
Tout à fait. C’est une emprise double, en fait. Toute cette histoire est par ailleurs pleine de doubles : la Reine des Neiges a une emprise sur l’actrice qui l’interprète ; l’actrice a une emprise sur la jeune fille qui s’est glissée par effraction dans le studio comme « un petit rat » et qu’elle va repérer ; mais il y a aussi une forme d’emprise de la jeune fille sur l’actrice. Cette dernière ressent cette présence et ce regard très fort qui se pose sur elle, et l’emprise fonctionne dans les deux sens, je pense. Après, dans le film, cette actrice a du pouvoir et va en user ; mais le personnage de Jeanne a une force en elle, elle est victime mais elle n’est pas que victime. Personnellement, à la place de l’actrice, j’aurais un peu peur de cette fille qui se glisse dans mes placards pour m’épier. Il y a donc bien sûr en effet un aspect vampirique dans tout cela. J’aime beaucoup les histoires de vampires, cela doit donc revenir malgré moi. Et la dernière rencontre des deux personnages féminins… je ne veux pas trop en parler dans les articles mais… c’est comme si l’une aspirait la vie de l’autre. Comme si cette jeune fille était l’actrice au même âge, comme si cette dernière avait perdu tout ce que cette fille possède.

Vampirisme du regard (C. Pacini) (©Metropolitan FilmExport)
Votre amour des récits de vampires a-t-il influencé l’esthétique de votre film ? Je reviendrai par la suite sur quelque chose de précis…
Serait-ce Les Lèvres rouges, par hasard ?
Précisément ! (rires) Le costume de la Reine des Neiges semble évoquer celui de Delphine Seyrig chez Harry Kümel…
Oui, un petit peu. J’ai pensé aux Lèvres rouges, même pour ce qui concerne la coiffure de la Reine. On avait cherché des références pour voir comment nous allions coiffer ses cheveux blancs ou blonds… Oui, Delphine Seyrig chez Harry Kümel, c’était visuellement une référence. Après, je n’ai pas pensé à des films de vampires pour l’atmosphère de La Tour de Glace. Ceux qui m’ont beaucoup marqué, ce sont ceux de la Hammer, donc pas du tout le genre d’atmosphère qu’on trouve dans le studio de mon film. Ou alors peut-être un peu Nosferatu le Vampire (Freidrich Wilhelm Murnau, 1922), l’Expressionnisme allemand…
S’il y avait une référence, mais je ne pense pas qu’ils aient fait de films de vampires, ce serait Michaell Powell et Emeric Pressburger pour les décors du plateau, l’esthétique des montagnes peintes, l’artificialité du réel. Et l’autre référence peut-être, et on pourrait dire qu’il y a énormément de vampires dans ses films bien qu’il n’y en ait pas littéralement, c’est Rainer Werner Fassbinder. Il a peut-être été une inspiration quant aux types de personnages, et particulièrement Le Secret de Veronika Voss (1982), pour l’usage du théâtre et du huis clos. Dans mon film, le cinéma joue un peu comme le théâtre chez Fassbinder. Lui tournait aussi beaucoup en studio, avec des bouts de décors réels, il mélangeait tout.
Mais votre cinéma lui-même n’est-il pas envahi par les vampires sans qu’ils ne soient littéraux ?
Oui, il va falloir que j’en mette un pour de bon pour me débarrasser de cela !
La Tour de Glace, de ce point de vue, ne peut-il pas être considéré comme une version féminine de La Bouche de Jean-Pierre ?
On peut le dire, oui. Une version féminine et plutot placée dans l’imaginaire, cependant. Après, il y a quand même une chose qu’il n’y a pas dans La Bouche de Jean-Pierre, et qui sauve la jeune fille de mon nouveau film, qui sauve le monde peut-être, c’est le cinéma. Par lequel le personnage de la jeune fille pourrait se sauver, trouver quelque chose de positif. Ces mondes imaginaires que l’on construit par le cinéma, ces mondes d’évasion, on ne les trouve pas dans mon premier film. Justement, dans La Bouche de Jean-Pierre, je voulais mettre des rêves, je n’arrivais pas à les inclure et ce n’était peut-être pas plus mal, car je voulais un monde sans échappatoire. La réalité y est peut-être stylisée, mais il n’y a que la réalité. Dans La Tour de Glace, il y a tout de même autre chose… J’espère…
Quel est le rôle de la patineuse artistique ? Quelle symbolique y trouveriez-vous ?
C’est un modèle de fille, de femme. Elle est l’anti-Reine des Neiges. Jeanne est attirée par des figures, des modèles, et la patineuse Bianca, brune qu’on a habillée en jaune, est une figure plus chaleureuse, positive. Elle représente la grâce, répétant en boucle sa chorégraphie, comme les petites poupées qui tournent dans les boîtes à musique. Elle est une figure attirante, et je me dis que Jeanne voit cette figure plus moderne qu’elle, pas beaucoup plus âgée, à laquelle elle s’identifie. La fille ne fait que passer, ce n’est pas une vraie rencontre ; celle-ci n’aura lieu qu’ultérieurement avec l’actrice Cristina. La patineuse est une autre possibilité pour Jeanne qui est en cours de métamorphose.
Verriez-vous votre film comme un récit d’initiation ?
Oui, je pense, tout à fait. Jeanne est à la rencontre de son destin. Elle a besoin de se confronter à cette figure de la Reine des Neiges qui va se décliner en Cristina pour se « libérer, délivrer… » (Rires). Après, je ne sais pas, je n’ai pas vu le film d’animation…

Une Reine des Neiges sans édulcoration (M. Cotillard) (©Metropolitan FilmExport)
On en arrive à l’édulcoration des contes. Votre cinéma a-t-il pour enjeu de s’y opposer ?
Je ne me suis pas du tout préoccupé de cela. Ce n’est pas comme si je ne connaissais les contes que par les films. Je connais les contes directement par Andersen, y compris parce que j’ai découvert cela quand j’étais petite. J’ai retrouvé les versions qu’avait ma mère, ce n’était pas des versions pour enfants. Il y avait des histoires qu’elle devait ne pas me lire là-dedans (Rires). J’imagine que j’ai eu ensuite des versions plus édulcorées, en effet. Mais dans le cours de ma vie, je les ai lus souvent, parce que ce ne sont pas des récits pour enfants. Quand vous lisez ces histoires allemandes du XIXème siècle, par exemple celle de l’homme qui a perdu son ombre. Chez Andersen, c’est parfois très noir et très cruel. On l’a déjà dit mais La Petite Sirène, c’est terrible, et très masochiste ! Ou Le Compagnon de voyage, très sombre lui aussi. Donc non, je ne suis pas en réaction contre Disney.
Malgré la noirceur de votre vision cinématographique de ce genre…
La noirceur provient des contes eux-mêmes. Par exemple traverser les dangers de la forêt pour éventuellement s’en délivrer ou pas… Après, on va nuancer un peu : je suis de la génération qui a pu voir les Disney classiques en salle ; quand je pense à Merlin l’Enchanteur (Wolfgang Reitherman, 1963), qui est l’un de mes premiers souvenirs de cinéma, j’ai eu très peur ! C’était certainement édulcoré, mais les transformations, les personnages chassés par des forces, par des sorcières… Cela ne semblait pas édulcoré à mon regard… Mais je m’égare. (Rires)
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).