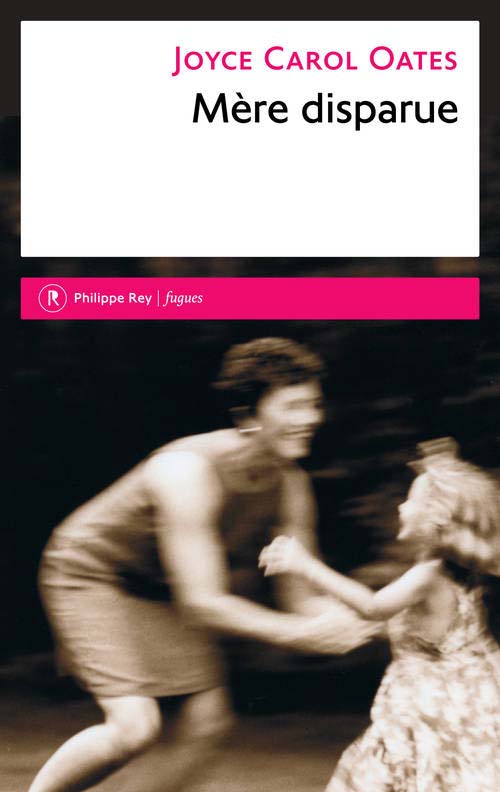Merci maman,… (Pierre Perret)
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes : Gwen Eaton, radieuse maman aimée de son quartier parfait célèbre une parfaite fête des mères avec ses amis parfaits et ses deux filles parfaites. Enfin, pour l’une d’entre elles du moins : Nikki, elle, a toujours été un peu rebelle. C’est dire si elle détonne avec sa coupe punk (qui excite passablement son beau-frère), son amant marié et ses exaspérations face aux fausses politesses et sourires convenus d’inconnus, dans ce décor si parfaitement conventionnel.
Cette scène d’ouverture, volontairement ampoulée, n’est là que pour masquer le vrai sujet du roman de Joyce Carol Oates, ressorti dans la collection « Fugues » chez Philippe Rey, et dont le titre « Mère disparue » sera brutalement révélé quelques pages plus loin : le meurtre de Gwen, absurde et violent , se vidant de son sang dans son garage. Trauma pour sa fille qui l’a découverte, entrainant l’impossible travail du deuil pour Nikki, obsédée par l’absence et qui, tentant de redécouvrir une mère dont le vernis n’était que politesse du désespoir, finira se mettre en chemin pour se découvrir elle-même.
Dans ce vrai faux-polar dont la résolution se trouve dès le troisième chapitre (c’est un fait divers absurde, et le meurtrier, drogué, sera écroué dès le lendemain), toutes les étapes du deuil sont bien là, prêtes à se révéler dans les détails d’une écriture du banal : de la vente possible de la maison à une photo froissée, d’un pain resté dans le congélateur vide, du déni à l’acception.
On pense alors à Un homme, de Philip Roth, pour son ode crépusculaire au temps passé, où l’approche de la mort laissait au héros le temps de relire sa vie, et de constater les dégâts.
Car le roman, débarrassé de sa narration (dès la capture du meurtrier, il atteint finalement sa « résolution ») lorgne du côté de la chronique d’un quotidien qui tente de se recréer alors qu’affleurent sans cesse les souvenirs : successions de scènes parfois justes, quand on vient à trier les cartons et les souvenirs à coup de post-it, en se battant entre sœurs si différentes dans leurs expressions du chagrin, ou lorsqu’on visite une vieille tante acariâtre dans sa grande maison vide et que les souvenirs du disparu créent un possible terrain de tendresse.
Il sait même être bouleversant quand dans son versant le plus touchant, Nikki « s’installe » chez la mère, pour en humer le fantôme : prendre possession de la maison, topographiquement et mentalement, pour réduire le fossé de l’absence. Devenir « mère » : la retrouver tout en devenant elle.
L’horizon littéraire est aussi un horizon intime, pour Joyce Carol Oates, dont le roman se place dès ses premières lignes comme une manière de conjurer la perte de sa propre mère. Comment ? En bâtissant ce qu’elle sait faire de mieux : une fiction. Mettre à distance la douleur en se la réappropriant par un pas de côté. « Je raconte ici comment ma mère me manque. Un jour, d’une façon qui ne sera qu’à vous, ce sera aussi votre histoire » (p.11).
Un pas après l’autre, jusqu’à la dernière phrase, sans doute la plus poignante.
Toutes les étapes sont alors là, et, voudrait-on dire, trop là : précises, mécaniques. Quelque chose résiste bizarrement, laissant cette drôle de sensation que rien ne dépasse, et que les révolutions intimes elles-mêmes sont préparées et logiques : de la punk qui devient doppelganger maternel, de la sœur trop sage devenant la fille revivant sa jeunesse, de Nikki qui abandonne son amant à Clare qui fuit son mari ; destins croisés et douleurs jouées, méticuleusement avancés, comme des pions sur un jeu d’échec ou les étapes d’une « recette » du roman de deuil, étouffant tout à la fois les personnages (trop cliché) et notre parcours de lecteur (trop balisé).
Peut-être le sujet était-il trop brûlant et trop proche, la douleur trop vive. Et que dans un dernier geste de protection, l’auteur l’a-t-il repoussé trop loin de soi. Trop « facile », trop « précis », trop « bien écrit » et admirablement disposé : c’est dans le fond cette précision d’écriture si souvent louée chez elle qui finalement achève cette tentative, cherchant à réduire au maitrisable ce qui est de l’ordre de l’accident et de l’inconcevable. Impossible résilience : dommage pour l’émotion.
Editions Philippe Rey, Collection Fugues, 496 pages, 11,5 euros. En librairie depuis le 7 avril 2016.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).