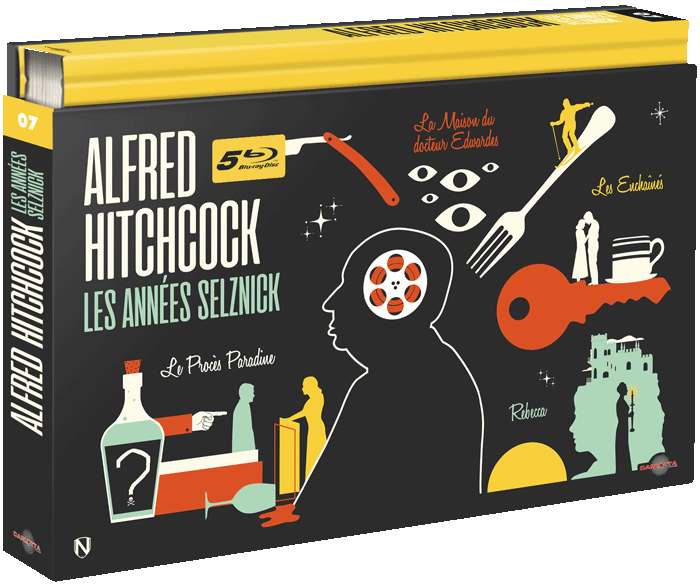En 1939, quelques mois avant que n’éclate la Seconde Guerre mondiale, Alfred Hitchcock vient – accompagné de sa famille – s’installer aux États-Unis. À presque 40 ans, le cinéaste britannique a déjà réalisé plus d’une trentaine de films (muets et sonores), dont certains ont été de véritables succès : Chantage (1929), L’Homme qui en savait trop (1934) ou Une Femme disparaît (1938). Il commence à faire parler de lui outre-Atlantique au point d’attirer l’attention de l’un des producteurs les plus puissants et plus ambitieux de l’époque : David O.Selznick. Après avoir œuvré au sein de diverses majors (MGM, Paramount, RKO), travaillé sur des films tels que Les Invités de huit heures (George Cukor), King Kong (Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack) ou encore Les Chasses du comte Zaroff (Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel), David O.Selznick crée sa propre société de production en 1935 : la Selznick International Pictures.

David O.Selznick
David O.Selznick est notamment connu pour exercer un contrôle extrêmement rigoureux sur ses productions – du scénario au casting, de la réalisation à la sortie du film en passant par le montage – il ne lésine pas sur les « mémos » très fouillés indiquant (imposant) avec précision la marche à suivre conformément à sa propre vision. On peut d’une certaine manière le considérer comme un auteur à part entière. Alfred Hitchcock, est lui aussi réputé pour être un « maniaque » du détail, cinéaste méthodique et exigeant, du temps passé à l’écriture du scénario jusqu’à la conception chirurgicale du storyboard : rien ne doit être laissé au hasard. « Le scénariste et moi planifions la totalité du scénario jusqu’au moindre détail et, quand nous avons terminé, tout ce qui reste à faire c’est tourner le film. […] C’est seulement quand on entre en studio, qu’on entre dans la zone des compromis. » dira-t’il lors d’une interview.

Alfred Hitchcock, Joan Fontaine et Laurence Olivier sur le tournage de « Rebecca »
Entre les deux hommes, la collaboration accouchera de quatre films entre 1940 et 1947 et si de nombreux témoignages évoqueront des divergences de visions, des conflits, des tensions…c’est en partie au contact de David O.Selznick qu’Alfred Hitchcock franchira un nouveau palier dans sa carrière devenant alors aux yeux du monde le géant du cinéma que l’on connaît. Au moment de revenir sur ces films, nous faisons le choix d’évoquer autant leur contenu que le contexte qui les entourent : celui d’un rapport de force et de pouvoir entre deux légendes du cinéma. Après tout, revenir sur le travail de ces deux figures, est aussi l’occasion de replonger dans une période passionnante et révolue : celle de l’âge d’or Hollywoodien.
Rebecca (1940)

Rebecca (Copyright David O.Selznick / ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Lorsque David O.Selznick approche Alfred Hitchcock, c’est initialement pour lui proposer un projet de film autour du naufrage du Titanic. L’idée sera finalement abandonnée et remplacée par Rebecca, adaptation du roman de Daphné du Maurier, considéré comme le chef d’œuvre de l’auteure anglaise. Alfred Hitchcock est déjà familier du travail de sa compatriote puisqu’il vient d’adapter L’auberge de la Jamaïque pour ce qui est provisoirement son dernier film Anglais : La Taverne de la Jamaïque. À noter qu’une vingtaine d’années plus tard, une nouvelle de Daphné du Maurier sera la base d’un autre grand classique du maître du suspense : Les Oiseaux. Histoire de ne pas être dépaysé, l’intrigue de Rebecca se déroule en Europe, elle commence à Monte-Carlo où Maxim de Winter (Laurence Olivier) un riche veuf, s’éprend d’une jeune domestique (Joan Fontaine) qu’il décide d’épouser. Ils se marient et retournent habiter au manoir de Manderlay, la demeure familiale de Winter, au sud de l’Angleterre. Dans cet endroit lugubre et froid, la nouvelle Mme. de Winter est rapidement confrontée à des domestiques qui ne semblent guère l’apprécier, en particulier Mme. Danvers (Judith Anderson), la gouvernante. Le château semble hanté par le souvenir de Rebecca, l’ex-femme de Maxim, décédée un an plus tôt dans un accident…

Rebecca (Copyright David O.Selznick / ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Comédie satirique, thriller gothique, mélodrame amoureux, enquête judiciaire… Rebecca impressionne par sa propension à basculer d’un registre à l’autre maintes fois en cours de récit, à dévoiler progressivement plusieurs facettes sans perdre un instant en fluidité, ni diminuer la force des mystères et suspenses qui se mettent en place. Construit sur un ensemble de dualités – noir/blanc, rêve/réalité, passé/présent, morts/vivants, construction/destruction – et de motifs symboliques (l’eau et le feu), le film bénéficie des talents de grand conteur d’Alfred Hitchcock mais également de sa maîtrise souveraine du langage cinématographique. Il réussit ici un double tour de force, celui de faire du théâtre principal de l’action, le château de Manderlay, un personnage à part entière et dans le même temps celui de faire vivre en ce lieu, le personnage d’une morte ou plutôt son souvenir, son image, son fantôme. Manderlay est présenté dès le prologue qui suit le générique d’ouverture par le récit d’un rêve de la seconde Mme. de Winter (elle ne sera jamais nommée) introduisant le film sous la forme d’un long flash-back. Un travelling en vue subjective accompagné par la voix-off de l’héroïne traverse le lieu tel un fantôme : la propriété est gigantesque, isolée, énigmatique. Il se murmure qu’Orson Welles a pris Manderlay pour modèle architectural au moment de concevoir Xanadu dans Citizen Kane. Plus tard, la découverte de l’intérieur du château n’éclaircit pas le trouble suscité lors de la première visite : Hitchcock adopte le point de vue de son l’héroïne en alternant plans en vue subjective et jeu sur les échelles de valeurs de cadre : elle parait tour à tour étouffée dans le décor puis isolée dans son immensité voire perdue dans ce labyrinthe. Manderlay « vit » à travers le regard innocent de Joan Fontaine, lequel se confond rapidement avec le notre. Illustration du célèbre adage « Less is more » ce que l’on ne voit pas, ce que l’on ne sait pas stimule l’imaginaire. C’est également sur un principe minimaliste que la première Mme. de Winter, Rebecca imprègne sa présence : de l’omniprésence de ses initiales « RdW » brodées sur une serviette, de grands « R » apposé sur les fournitures de bureau aux recoins de la propriété qui lui étaient jadis alloués désormais « interdits ». Évoquée par allusions succinctes – et parfois contradictoires – dans les dialogues de divers protagonistes, elle apparaît telle une chimère dont l’image évolue régulièrement au gré de nos propres interrogations. Le plus fascinant réside dans la façon, dont Hitchcock suggère une tension sexuelle morbide, teintée de masochisme entre la défunte et la gouvernante Mme. Danvers.

Rebecca (Copyright David O.Selznick / ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Œuvre dense, captivante et émouvante, Rebecca peut aussi se lire sous un angle plus inconscient, dressant en creux le portrait du metteur en scène par l’intermédiaire de la seconde Mme. de Winter. La trajectoire de cette femme inadaptée à son monde originel – la bourgeoisie Anglaise – débarquant dans un nouvel environnement dont elle doit appréhender les codes pour parvenir à trouver ses marques, crée un écho troublant avec la situation d’un cinéaste changeant de continent et découvrant un nouveau mode de fonctionnement, l’obligeant à composer avec de nouvelles règles pour parvenir à imposer sa vision.
En 1941, Rebecca recevra l’oscar du meilleur film, le seul de la carrière d’Alfred Hitchcock, c’est pourtant David O.Selznick qui se chargera de récupérer la récompense, il s’agira du deuxième oscar du meilleur film consécutif pour le producteur, un an après l’avènement de la plus triomphale de ses productions : Autant en emporte le Vent.
La Maison du docteur Edwardes / Spellbound (1945)

La Maison du Docteur Edwardes (Copyright ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Cinq années séparent les sorties respectives de Rebecca et de La Maison du docteur Edwardes (Spellbound), cinq années pendant lesquelles Alfred Hitchcock tournera une dizaine de films dont Soupçons (1941), L’ombre d’un doute (1943) et Lifeboat (1944). En 1940, malgré ses multiples succès, et la rentabilité de la Selznick International Pictures, David O. Selznick doit faire face à d’importants problèmes d’impôts. Le nabab est contraint de fermer sa compagnie de production et de prêter certains de ses artistes avec lesquels il est sous contrat – Alfred Hitchcock, Ingrid Bergman, Vivien Leigh, Joan Fontaine,… – à d’autres studios avant de pouvoir retourner aux affaires en 1944. Spellbound – le titre original signifiant « envoûté » est l’adaptation d’un roman datant de 1927, The House of doctor Edwardes de Francis Beeding. On découvre le docteur Constance Petersen (Ingrid Bergman) travaillant dans un établissement psychiatrique du nom de Green Manors, dirigé par le docteur Murchison (Leo G.Carroll). Ce dernier est sur le point de partir en retraite (anticipée) et doit être remplacé par le jeune et talentueux docteur Anthony Edwardes (Gregory Peck). Une fois installé, le nouveau directeur s’avère être un amnésique du nom de J. B., soupçonné d’avoir fait disparaître le véritable docteur Edwardes. Tombée amoureuse de lui, Constance Petersen va tout faire pour l’aider à retrouver son identité…

La Maison du Docteur Edwardes (Copyright ABC, Inc. Tous droits réservés.)
D’un point de vue purement factuel il convient de rappeler que La Maison du docteur Edwardes est le premier film situé dans l’univers de la psychanalyse, dans un contexte où le sujet est encore « tabou » même si la pratique se développe et prend une importance croissante dans la société Américaine. Le film propose une vision très documentée de ce milieu – la psychiatre de David O.Selznick a travaillée comme consultante sur le film – laquelle peut paradoxalement apparaître simpliste ou du moins un brin naïve aujourd’hui : en atteste par exemple, la citation écrite qui ponctue le générique. Davantage que son scénario, une quête identitaire détournant efficacement les codes du film policier en transformant la figure classique du détective en celle d’une psychanalyste, c’est la mise en scène qui exerce un vrai pouvoir de fascination. La confrontation entre ce qui relève du domaine du conscient et de l’inconscient étant au cœur même du sujet, Alfred Hitchcock utilise cette frontière indicible pour faire de ce territoire mental un vecteur de suspense et d’émotion. On pense à la séquence du premier baiser échangé entre Constance et le faux Anthony Edwardes soit un simple champ/contrechamp rapprochant les protagonistes par un resserrement successif des cadres mêlé de visions subjectives avant que Constance ne ferme les yeux laissant alors apparaître la vision d’un long couloir dont les portes s’ouvrent les unes après les autres avant de conclure par la fin du baiser. Illustration par l’inconscient du lâcher prise d’une héroïne présentée auparavant comme plutôt froide et méthodique : en un infime détail, le regard sur le personnage en ressort complètement bouleversé. Avec méticulosité et volonté d’économie d’effets, Alfred Hitchcock tend à transformer la dimension très psychologique du script qu’il met en scène vers quelque chose de beaucoup plus concret, presque de l’ordre de l’expérience physique ou onirique selon les séquences. Paradoxalement, les passages les plus célèbres du film ont tendance à être aussi ceux qui sont visuellement les plus « voyants » comme la fameuse séquence de rêve conçue par Salvador Dali – selon les témoignages elle aurait été drastiquement raccourcie au montage par David O.Selznick qui la détestait – ou encore la subliminale incursion d’une touche de couleur au milieu du noir et blanc lors de la résolution de l’intrigue.

La Maison du Docteur Edwardes (Copyright ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Enfin, il y a Ingrid Bergman – déjà formidable un an avant Les Enchaînés – qui tourne pour la première fois sous la direction d’Alfred Hitchcock, son rôle de femme déterminée évoluant dans un univers très majoritairement dominé par les hommes rappelle à quel point le cinéaste fut à l’avant-garde sur la condition féminine au cinéma. Elle livrera une anecdote savoureuse sur le tournage du film éclairant sur la relation « délicate » entre le metteur en scène et son producteur : « Quand Selznick arrivait, la caméra s’arrêtait subitement de tourner. Hitchcock disait que le caméraman n’arrivait pas à la remettre en marche. « Je ne sais pas ce qu’elle a, disait-il, mais on s’en occupe, on s ’en occupe. » En fin de compte, Selznick se retirait. Alors, comme par magie, la caméra se remettait à fonctionner. »
Les Enchaînés / Notorious (1946)

Les Enchaînés (Copyright 1946 RKO / ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Pièce maîtresse de la collaboration Hitchcock/Selznick, Les Enchaînés a été, par la conjoncture des événements, le film sur lequel le cinéaste anglais a été le « moins contraint » par son producteur. En effet, David O.Selznick finança uniquement la pré-production avant de devoir revendre le projet à la RKO pour pouvoir compenser les dépassements de budget sur Duel au Soleil de King Vidor. Contrairement aux deux films précédents, il ne s’agit pas d’une adaptation de roman, mais d’un scénario basé sur une histoire originale d’Alfred Hitchcock. L’écriture est confiée à une pointure, en la personne de Ben Hecht. Scénariste de renom, rebaptisé par David O.Selznick « le Shakespeare d’Hollywood », Ben Hecht travaillera durant sa carrière avec des cinéastes de premier plan comme Howard Hawks, Otto Preminger, Joseph L.Mankiewicz, Billy Wilder… Collaborateur récurrent de David O.Selznick, ayant œuvré notamment sur Autant en Emporte Le Vent ou La Maison du Docteur Edwardes, il est également le complice d’Alfred Hitchcock à plusieurs reprises : Correspondant 17 (1940), Lifeboat (1944), La Corde (1948), L’Inconnu du Nord-Express (1951)… Récit d’espionnage situé en 1946 soit peu après la fin de la seconde Guerre Mondiale, Les Enchaînés commence par le procès de John Huberman, un espion d’origine allemande accusé de crime de haute trahison contre les États-Unis et condamné à vingt ans de prison. Sa fille, Alicia (Ingrid Bergman), loin de partager ses motivations, mène sa vie entre ivresse et débauche. Lors d’une soirée, elle fait la rencontre de Devlin (Cary Grant), un agent des services secrets qui lui propose de travailler pour les Etats-Unis afin de réhabiliter son nom. Elle est chargée de renouer le contact avec un ancien ami de son père, Alexander Stan (Claude Rains), qui avait autrefois un faible pour elle et est désormais à la tête d’un réseau de nazis réfugiés au Brésil…

Les Enchaînés (Copyright 1946 RKO / ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Les Enchaînés marque le retour d’Alfred Hitchcock dans un registre qu’il a grandement contribué à populariser au cours de la décennie précédente : le film d’espionnage. « Quintessence d’Hitchcock » selon les mots de François Truffaut, Notorious (son titre original) s’articule autour d’un scénario construit sur une logique d’épuration maximale où chaque (courte) séquence est ramenée à une forme de « simplicité » – dialogues ordinaires, situations quasi quotidiennes – rendant l’intrigue aussi intelligible qu’immédiatement immersive. Dans le climat brûlant de l’après-guerre, le film s’attache à dépeindre des individualités complexes aux motivations contradictoires. Il se refuse autant à une quelconque forme d’héroïsme patriotique d’un côté, qu’à diaboliser le désigné « camp du mal » en face. La partie espionnage de l’intrigue repose sur un principe cher à Alfred Hitchcock : le « MacGuffin », un prétexte enrobé de zones de flous – à quoi sert cette poudre d’uranium cachée dans des bouteilles de vin ? – à l’inverse d’un versant sentimental aussi dépouillé que limpide – deux hommes amoureux de la même femme – d’où naîtra suspense, intensité et émotion. Au risque de troubler, la figure du nazi Alexander Stan (très belle composition de Claude Rains, vulnérable et sincère) paraît longtemps beaucoup plus respectueuse, attentionnée et osons le terme : charmante, que l’agent américain Devlin (et, accessoirement, ses supérieurs hiérarchiques) souvent empreint de cynisme et de mépris à l’égard d’Alicia.

Les Enchaînés (Copyright 1946 RKO / ABC, Inc. Tous droits réservés.)
La mise en scène s’attache à traduire ce vertige des sentiments en exploitant pleinement le potentiel dramaturgique de chaque instant, de chaque détail, avec un souci palpable de discrétion rendant l’apparement anodin totalement essentiel. Par exemple, l’écoute d’une conversation passée entre Alicia et son père devient bouleversante lorsqu’une discrète larme apparaît sur le visage de la jeune femme. Ou encore, plus tard, une scène de couple entre Alexander et Alicia se transforme en véritable pic de tension lorsqu’il s’agit, en parallèle, de garder cachée une clé dérobée : le moindre regard, le moindre geste, le moindre son, prend l’allure d’une menace potentielle susceptible d’attirer l’attention et révéler la véritable identité d’Alicia. Enfin, Alfred Hitchcock n’hésite pas à façonner des moments de grâce pour les déformer ensuite avec jubilation, à l’image de cette mythique séquence sur le balcon où Alicia et Devlin – doit-on dire un mot sur l’alchimie miraculeuse qui règne tout du long entre Ingrid Bergman et Cary Grant ? – « s’enchainent » le temps d’un baiser de plusieurs minutes – le plus long de l’histoire du cinéma disaient les publicitaires de l’époque – suivi en travelling. Ce même décor sera réinvesti peu après, pour un instant beaucoup plus cruel entre les deux amants, le cadre idyllique devenant subitement le théâtre d’une déchirure. Cette propension à retourner une situation, charger un même lieu de plusieurs histoires, d’humeurs diamétralement opposées, bousculer les attentes, contribue à rendre le film sans cesse imprévisible par-dessus tout : irrésistible !
Le Procès Paradine / The Paradine Case (1947)

Le Procès Paradine (Copyright ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Contexte – à plus d’un titre – bien différent pour Le Procès Paradine : Les Enchaînés vient d’être un triomphe critique et commercial et si Alfred Hitchcock est désireux d’honorer jusqu’au bout le contrat qui le lie – pour un dernier film – à David O.Selznick, il ne souhaite pas prolonger au-delà avec le producteur. Alfred Hitchcock est déjà tourné vers la suite, soucieux d’acquérir davantage d’indépendance, il a crée sa propre société de production la Transtlantic Pictures avec la complicité de Sidney Bernstein et planche déjà sur ce qui sera leur premier projet : La Corde. Conséquence directe de cet « échec » à garder dans ses rangs le cinéaste ou simple volonté de reprendre les pleins pouvoirs, David O.Selznick se montre plus omniprésent que jamais en cumulant la double casquette de producteur et de scénariste : il est crédité seul à ce poste après avoir largement réécrit un scénario initial de Ben Hecht, Alma Reville (l’épouse d’Alfred Hitchcock) et James Bridie. De plus, si Alfred Hitchcock avait par exemple pu imposer Cary Grant sur Les Enchaînés, cette fois-ci ses suggestions de casting ne seront pas retenues, le producteur lui imposant ses acteurs et actrices sous contrat. Ainsi, Gregory Peck, Alida Valli et Louis Jourdan occupent des rôles pour lesquels Hitchcock envisageait au départ Laurence Olivier, Greta Garbo (il avait pensé dans un premier temps à Ingrid Bergman mais elle ne voulait plus faire de film pour le compte de Selznick) et Robert Newton. Adaptation d’un roman de Robert Smythe Hichens, le film appartient au genre du thriller judiciaire. L’histoire se déroule à Londres où Madame Paradine (Alida Valli) est accusée d’avoir assassiné son mari aveugle, Richard-Patrick Paradine. L’avocat Anthony Keane (Gregory Peck) est chargé de la défendre. Marié à la jeune Gay (Ann Todd), Anthony tombe pourtant peu à peu sous le charme de sa cliente dont il est persuadé de l’innocence…

Le Procès Paradine (Copyright ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Le Procès Paradine est un film en trompe l’œil, le procès du titre ne démarre que très tardivement dans le récit et son issue s’avère quasiment secondaire voire anecdotique. Le cœur de l’intrigue est sentimental – l’amour naissant d’Anthony Keane pour Anna Paradine, le délitement des sentiments entre Anthony Keane et son épouse Gay et l’amour « inavouable » d’Anna Paradine pour son valet André Latour (Louis Jourdan) – avec en arrière-plan une charge sans pitié sur la société anglaise. En effet, en réinvestissant son pays natal, Alfred Hitchcock fait montre d’une misanthropie assez féroce à l’encontre de la bourgeoisie anglaise qu’il dépeint (à titre de comparaison il se contentait de la railler dans Rebecca). Ce regard acerbe se double d’un désamour manifeste pour les personnages, au point de se demander s’il ne s’agit pas aussi d’une forme de réponse de la part du cinéaste aux choix de casting qui lui ont été imposés. Aux yeux de cette bourgeoisie incarnée par les différents jurés gravitant autour d’Anthony Keane, Anna Paradine est avant tout coupable de ne pas appartenir à leur rang social – elle s’y est seulement hissée par son mariage – et d’être une étrangère, ce qui fait d’elle une suspecte idéale, quand l’avocat ne la croit innocente qu’en raison des sentiments qu’il développe à son égard. Cet aveuglement d’Anthony fait ressurgir chez lui le même réflexe de mépris de classe lorsqu’il cherche à orienter sa défense en faisant porter le chapeau de la mort de Richard-Patrick Paradine à André Latour. Longtemps, Anthony ne comprend pas pourquoi Anna Paradine le somme d’épargner Latour, incapable d’accepter qu’une « femme de son rang » puisse éventuellement éprouver des sentiments pour un individu de basse condition. Ces dysfonctionnements éclatent au grand jour dans la seconde partie centrée sur le procès : le tribunal devient le théâtre d’expression de sentiments violents. Dans la mise en scène de cette seconde partie, en testant le tournage à caméras simultanées et en multipliant les points de vue, Hitchcock isole ses protagonistes comme pour rééquilibrer la teneur d’un procès qui semble inéquitable et joué d’avance. Longtemps figée – quitte à maintenir extérieur au récit -, l’émotion est alors palpable, offrant au film quelques unes de ses séquences les plus marquantes.

Le Procès Paradine (Copyright ABC, Inc. Tous droits réservés.)
Concluons par ce qui constitue peut-être la dimension la plus troublante du long-métrage, celle qui laisse se dessiner le spectre de Rebecca, le personnage fantôme du film éponyme, à travers la figure d’Anna Paradine et le jeu distant mais envoûtant d’Alida Valli. Outre l’aspect physique – coiffure, couleur de cheveux, stature,…- rappelant un tableau visible à Manderlay, les deux personnages ont en commun de peser par leurs absences (l’une emprisonnée, l’autre décédée), d’exercer une forme d’emprise sur un protagoniste principal qu’elles tentent d’attirer à elles, de faire plonger. De plus, la séquence où Anthony Keane découvre la chambre de Mme. Paradine à la propriété d’Hindley hall, une pièce « personnifiée » à l’image de l’héroïne rappelant immédiatement la séquence où la seconde Mme. de Winter (Joan Fontaine) découvrait la chambre de Rebecca. Enfin, on retrouve au générique de ces deux films le même compositeur Franz Waxman, avec en prime la réutilisation de certaines pistes de la bande originale de Rebecca pour Le Procès Paradine faisant germer l’idée que le film peut s’appréhender comme une relecture masculine, pessimiste et désespérée de ce dernier. Un peu comme si avant de dire adieu au producteur qui l’avait fait venir à Hollywood, Alfred Hitchcock avait souhaité revisiter leur histoire commune et à sa manière empêcher David O.Selznick d’avoir le dernier mot artistique…
Bonus

« Selznick était le grand producteur. […] Le producteur était le roi. La chose la plus flatteuse que Mr Selznick ait jamais dite à mon sujet — et cela montre le degré de contrôle —…il a dit que j’étais le « seul réalisateur » à qui « il confierait un film ». Alfred Hitchcock
Les noces entre David O.Selznick et Alfred Hitchcock laissent derrière elles quatre films, parmi lesquels deux œuvres essentielles : Rebecca et Les Enchaînés. Qu’il soit majeur ou plus mineur – à l’aune de la monstrueuse filmographie d’Alfred Hitchcock bien sûr -, chaque film appartient à un registre différent et témoigne de la capacité du metteur en scène à s’emparer de matériaux plus ou moins proches de lui pour en faire une œuvre personnelle. Ces quatre films sont réunis pour la première fois dans un superbe coffret concocté par Carlotta. Ils ont tous fait l’objet d’une restauration en haute-définition assez remarquable : stupéfiante netteté des contrastes, sublimes photographies en noir et blanc où on l’on redécouvre avec excitation une multitude de détails nichés dans les plans.
Un livre de 300 pages contenant divers articles d’époque ainsi que des entretiens et plus de 120 photos inédites accompagne les films. Le coffret présente plus de 5h30 de suppléments répartis sur les 5 Blu-ray (ou 5 DVD). Des bonus divers, allant d’images d’essais du casting de Rebecca à une compilation d’archives familiales d’Alfred Hitchcock et sa famille en passant par un documentaire sur Daphné du Maurier diffusé il y a quelques années sur Arte. On recommande tout particulièrement les enregistrements audio – datés d’août 1962 – entre Alfred Hitchcock et François Truffaut – base du mythique ouvrage d’entretiens Hitchcock/Truffaut – où les deux hommes décryptent les quatre films sans une once de langue de bois : voir la sévérité de Truffaut à l’égard de Gregory Peck ou encore Hitchcock pointant du doigt des invraisemblances de scénario sur Rebecca. Ces enregistrements sont agrémentés de réflexions souvent captivantes de Nicolas Saada (ancien journaliste aux Cahiers du cinéma, ayant également travaillé comme scénariste avec Pierre Salvadori ou Arnaud Desplechin avant de réaliser deux films : Espion(s) et Taj Mahal) recueillies en Juillet 2017. Intéressant également, un entretien avec Daniel Selznick, le fils de David O.Selznick qui revient sur la collaboration entre Alfred Hitchcock et son père.
Daniel Selznick conclue en relatant un échange qu’il a eu dans les années 60 avec un Hitchcock sans rancœur ni hostilité à l’égard de son père : « Quand je repense à ma collaboration avec ton père, je n’ai que des bons souvenirs… ».
Coffret disponible en Blu-ray et DVD chez Carlotta.
© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur/ayant droit. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).