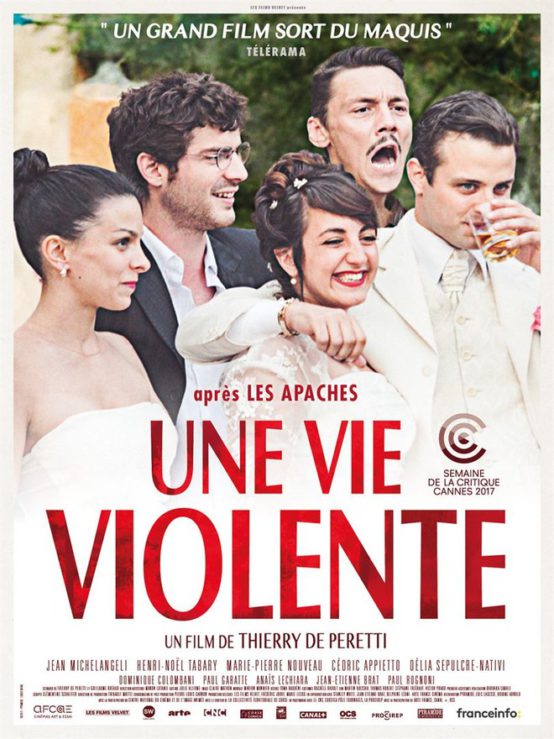Quatre ans se sont écoulés entre la sortie de votre film Les Apaches et votre dernier long métrage, Une Vie violente. Qu’avez-vous fait durant ce temps ? Êtes-vous revenu vers le théâtre ou la préparation de votre dernier film a-t-elle nécessité ce laps de temps ?
J’ai accompagné le film dans de nombreux festivals où il était invité, à l’étranger notamment. J’ai mis en scène Les Larmes Amères de Petra Von Kant de R.W. Fassbinder au Théâtre de l’Oeuvre, à Paris. Les répétitions, qui se prolongent toujours chez moi durant la période des représentations, se sont mélangées à l’écriture d’Une Vie violente. La construction du scénario (écrit avec Guillaume Bréaud) a été menée conjointement au long travail de casting (dirigé par Julie Allione) et à des résidences organisées avec une partie des acteurs du film. Je ne sais pas si je suis lent, mais j’ai besoin que tout mûrisse, que les idées se déposent à l’intérieur de moi. Qu’elles s’incarnent dans mon cerveau. Ça prend du temps.
Votre film s’inspire librement de l’histoire éphémère d’Armata Corsa et de la destinée funeste d’un jeune étudiant. A partir de quels éléments (témoignages, enquêtes…) avez-vous recueilli les informations nécessaires pour constituer votre histoire ?
Tout au long de l’écriture du film, j’ai pu avoir beaucoup de discussions, en Corse essentiellement, qui portaient sur les événements que le film rappelle et évoque. J’ai aussi beaucoup lu (d’articles, de documents, essais et thèses…) Ça a été un travail de collecte en quelque sorte. Mais au delà de cette recherche-là, il y a aussi la façon libre et anarchique dont je procède à chaque fois que je suis en train d’écrire un film: j’en parle tout le temps, je cherche, je regarde des films qui me semblent résonner avec mon histoire… Tout ça au bout d’un moment, la documentation et les références, ça constitue une sorte de corpus, comme dit Arnaud Desplechin, qui nourrit le récit, le circonscrit et dans lequel je replonge régulièrement. Une Vie violente est un film très personnel. Peut-être pas dans un sens autobiographique, mais c’est le film le plus intime que j’ai jamais fait. Les éléments, sur lesquels je m’appuie et que j’essaye d’articuler, sont avant tout mes propres souvenirs et mes propres sensations. Le film, agrège ce dont je me souviens, y compris de manière très elliptique, à cette collection d’éléments hétéroclites : conversations menées, documents, articles, textes, etc…
Vous êtes le premier à vous emparer par le cinéma de l’histoire contemporaine de la Corse. A travers vos acteurs « locaux », votre film rend hommage à cette île dont le particularisme fascine et intrigue. Comment analysez-vous cette violence prégnante (je pense notamment à l’article récent d’Antoine Albertini dans Le Monde) alors même que la conflictualité du mouvement nationaliste semble s’estomper ? Y a-t-il un climat insulaire propice à ce climat ?
Je ne l’analyse pas. Je ne suis pas sociologue, ni anthropologue, même si j’espère qu’il y a dans le film des éléments qui relèvent de la sociologie et de l’anthropologie. J’espère que le film dresse une cartographie, propose de montrer comment on se parle, comment on vit, quelles sont les types de relation qu’on peut avoir… Mais en même temps, je ne peux nier que le rapport au langage m’importe infiniment, j’y suis très attentif. Après ne peux parler de ces questions-là qu’au travers du film et des désirs des personnages. Il y a un rapport à la violence problématique, enseveli, à peine conscient. Il y a une violence des rapports. Une certaine forme d’engourdissement aussi, qui bloque l’empathie, qui m’effraye et me révolte. Mais la violence qui court et circule dans le film n’est qu’un des éléments du récit. Bien sûr, elle semble constitutive de nombreux comportements, de relations et sans doute que je cherche à la débusquer ; à montrer son a-normalité, ce qu’elle contribue à détruire, la liberté qu’elle enlève. Après les raisons de cette violence ne sont pas endémiques, attention. Mais il faut bien se rendre compte de ce qu’elle implique pour imaginer un jour la contenir ou éradiquer son pouvoir, son influence.
Vous dîtes avoir une profonde admiration pour l’œuvre de Pasolini (le titre du film d’ailleurs reprend le titre d’un de ses romans). Dans La disparition des lucioles, il condamne, sans même connaître notre présent, le monde mercantile et ses conséquences. Ne voyez-vous pas dans l’affirmation d’un particularisme corse une résistance à s’abandonner à ce nouveau monde ?
Non. Définitivement. Je ne crois pas que la Corse ne cède pas au consumérisme, ne se jette dans ses bras, pas moins qu’ailleurs en tous les cas… C’est même le contraire. La culture est un combat. À Ajaccio, on peut célébrer l’ouverture d’un Décathlon ou d’un nouveau hypermarché, comme s’il s’agissait d’une galerie d’art. Alors qu’il faut se battre pour faire venir les spectateurs dans les salles de cinéma et qu’il n’y a plus un seul théâtre, même si les artistes eux, sont bien présents. (je me permets de dramatiser un peu, car la situation du cinéma, à Ajaccio justement, s’est améliorée depuis l’ouverture d’un complexe cinématographique en dehors du centre). Pour ma part, les questions identitaires, le « particularisme » sont pour moi davantage des slogans : nos valeurs, nos anciens, nos traditions, etc… ne correspond pas tout à fait à une idée de contestation, ou à une forme de résistance, mais plutôt à un conservatisme creux et mortifère. Les questions liées à la conservation d’une identité, supposément en danger, mutent au contact du consumérisme et là c’est vraiment la catastrophe. On parle de perte dans nos traditions, on rejette l’étranger souvent, tout en allant se gaver au Burger King ou au Quick. Mais je ne veux pas juger les comportements des individus, plutôt ce qui les induit. Je crois qu’en Corse, comme en Catalogne, la lutte, la résistance ne se font pas contre le matérialisme. La gauche a abandonné le terrain, je veux dire les idées de gauche, les idées de progrès social, d’égalité, d’entraide. À la place nous avons des questions de défense d’identité… Ça me préoccupe beaucoup personnellement. Le particularisme à défendre, c’est l’art et la culture d’aujourd’hui et ce sont les artistes qui le portent. Le reste, l’art de vivre tout ça… C’est autre chose. Il y a l’histoire et la mémoire. Ce que Pasolini conteste du contemporain (même si c’est bien sur le masque que revêt le consumérisme qu’il fustige et révèle au grand jour) n’est pas sans ambiguïté et ce n’est peut-être pas ce que je partage le plus de sa pensée. Tout simplement parce que je ne suis pas nostalgique d’une époque passée qui serait un âge d’or. Disons en tous cas que je ne l’ai pas connue. Et peut-être que malgré la violence du consumérisme, je cherche toujours à déceler ce que l’époque peut produire comme nouveaux récits… Les nouveaux lieux m’inspirent. Je ne les juge pas, même si j’en vois là aussi la violence… Je suis sans doute moins responsable que Pasolini et ne peux m’empêcher de chercher ce qu’il y a de poétique ici. J’aime l’anticonformisme de la pensée de Pasolini, de ses idées, sans les partager toutes. Pasolini aide à reformuler le monde, et il le fait de son point de vue de poète. Il le fait par le langage, il le fait en convoquant les mythes, ou bien en filmant. La contestation, celle qui compte pour moi, c’est celle qui fait qu’on se révolte pour ses semblables, qu’on est capable d’être en empathie, qu’on n’a pas abandonné toute empathie pour les autres.
Cet esprit communautaire (au sens positif) s’oppose à la tendance ambiante du « tout s’achète et tout se vend ». Un des passages forts de votre film a lieu dans le bureau de l’entrepreneur qui voit dans l’arrivée du groupe une énième tentative de racket alors que Stéphane lui répond « Ça ne peut plus t’échapper qu’ici c’est une zone de combat ». Interprétez-vous cette affirmation comme une résurgence identitaire (tribale) ou l’affirmation d’une « proposition » politique nouvelle?
C’est vrai que cette phrase que prononce Stéphane est importante pour moi, car elle permet de changer en un instant le point de vue que l’on a sur la scène. On doit peut-être pouvoir se dire à ce moment-là: « Ah oui, c’est vrai je n’avais pas envisagé les choses sous cet angle-là »… Là, ça m’amuse beaucoup, parce que c’est le point du vue du personnage principal, qui se confond ou semble épouser le point de vue du film et qui devient peut-être celui du spectateur. J’aime beaucoup cette impression au cinéma, où en instant, en une phrase ou une réaction d’un personnage, on a changé notre rapport aux choses sans s’en rendre compte. Mais ça n’est pas la vérité pour autant: un racket reste un racket. Je peux comprendre ce qu’il dit, car bien sur, il y a quelque chose de très discutable à venir faire des affaires dans des zones politiquement troublées. Je ne suis pas très loin de partager cette idée. Stéphane dramatise peut-être un peu ou surjoue la crise que traverse la Corse à ce moment-là, mais j’aime cette idée, cette façon de prendre au sérieux les choses. C’est dans cet espace là que quelque chose de la Corse se dit dans le film: il y a une vraie intensité des enjeux pour ceux qui les vivent, une violence certaine, mais on peut discuter de leur réalité. La communauté, c’est l’expérience commune qui la fonde selon moi. Ce n’est pas la terre, pas le sang, pas je ne sais quelles valeurs. Effectivement Stéphane oppose à l’exigence d’une supposée excellence vantée par l’entrepreneur en opposition à l’incompétence du cousin de Lionel (pour lequel Stéphane et sa bande sont supposés rendre la justice, puisqu’il a été dit-il injustement évincé du travail pour lequel il avait déjà investit beaucoup) la justice: « Je m’en fiche d’où ils viennent, ce n’est pas leur nom que je regarde, mais la façon dont ils travaillent », une sorte de discrimination positive… Il est du côté de Bourdieu d’une certaine façon, je dis ça avec ironie bien sur. Il ne s’agit en fait que d’un racket déguisé en rétablissement de la justice à la Robin des Bois. Mais quand même, tout ça c’est quand même pour rendre service au cousin de son ami… Quant à cette phrase que Stéphane balance en partant à l’entrepreneur, il faudrait lui demander ce qu’il a en tête. Mais, peut-être, est-ce une façon pour lui de justifier ce qu’ils viennent de faire : » D’une manière ou d’une autre, tu n’as rien à faire ici et certainement pas à t’enrichir. Donc tu payes, c’est normal ».

La bande-originale du film est également une réussite amplifiant la puissance des images. Comment avez-vous réussi à constituer cette alliage entre modernité (The Streets) et musique plutôt traditionnelle ( I muvrini ou « so elli » au mariage) ?
On a cherché, écouté énormément de choses, discuté très longtemps avec Frédéric Junqua (qui est le superviseur musical du film) dès l’écriture du scénario. Les questions de style, les questions formelles sont celles auxquelles j’attache plus d’importance. Elles sont totalement liées au choix de raconter cette histoire. Ce qui compte c’est qu’esthétiquement quelque chose de neuf soit associé à cette histoire, neuve elle aussi, même si elle prend sa source dans des événements réels. En même temps, le film est très personnel et à ce titre j’ai besoin que le son, soit aussi le mien. Celui qui me touche et que j’écoute. Je l’associe à celui qu’écoute Stéphane, car même s’il est très différent ce que je suis ou du jeune homme de presque trente ans que j’étais, je le connais comme un frère. Les Muvrini, ce ne sont pas les Canta, ce ne sont pas les Chjami (Canta u populu Corsu, Chjami Aghjalesi) que l’on retrouve aussi à différents moments dans le film. Il y a quelque chose de plus familial chez eux, de plus œcuménique, que j’aime bien. Ça rassemble, c’est doux. Quant au morceau des Streets qui est arrivé à la dernière minute car j’ai perdu le morceau de Tricky qui j’avais choisi pour le générique (« Piano » dans Premilenium Tension), il n’est pas tout à fait d’époque (2005), mais c’est le flow d’un rappeur blanc anglais (Mike Skinner), c’est un peu un hip-hop de hooligan, ça me parait juste. Stéphane écouterait ça, c’est certain. Sans parler de la voix féminine qui rend cette fin plus sensuelle, plus envoûtante, moins religieuse que ce qui se dégageait du son de Tricky. C’est ce qu’il fallait.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).