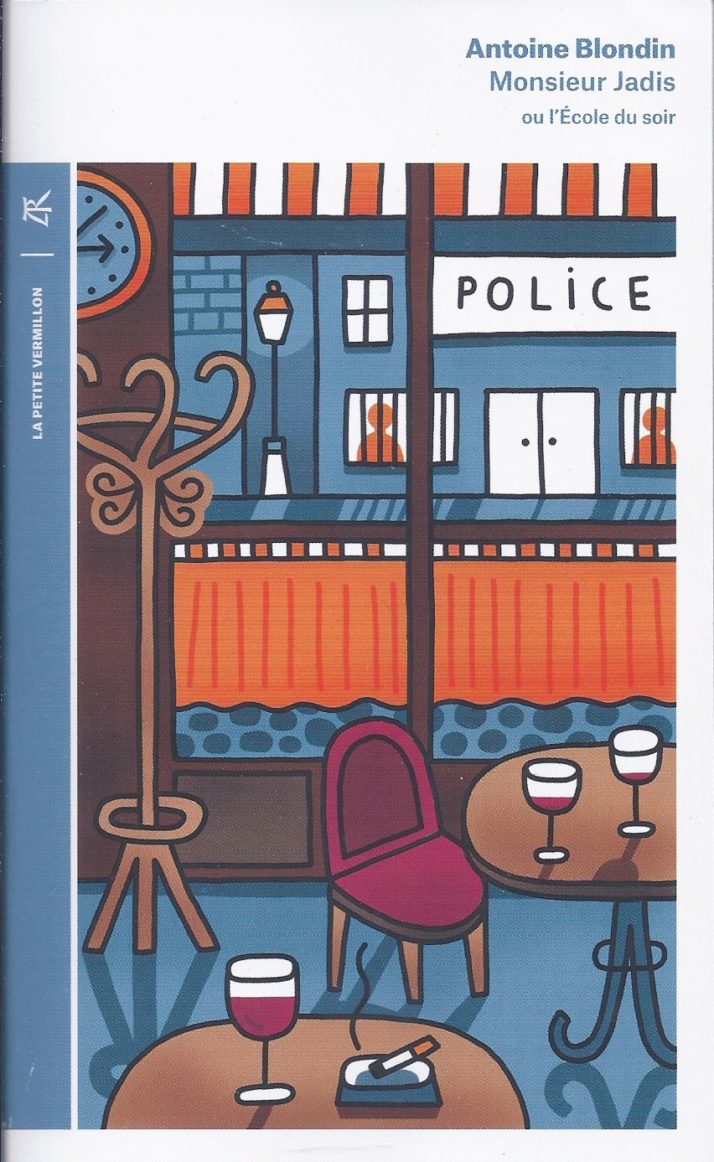Comme le souligne Christian Authier dans sa préface, Antoine Blondin a souvent été catalogué un peu rapidement dans des cases d’où il peine désormais à s’extirper : les Hussards (alors qu’il a toujours nié l’existence d’une telle école), l’amateur de sport, le collectionneur de bons mots et de formules à l’emporte-pièce dont la réputation fut parachevée grâce à l’adaptation cinématographique de son Singe en hiver…
Monsieur Jadis ou l’école du soir permet à la fois de constater que tous ces lieux communs ne sont pas entièrement faux (entre les dérives alcoolisées et le séjour à Londres pour assister à un match de rugby, le territoire paraît assez familier) et, en même temps, que l’écriture de Blondin est infiniment plus ample et riche que les contours d’un univers où l’on persiste à l’assigner.
Le récit s’ouvre sur une scène contemporaine. L’auteur assiste à l’arrestation d’un jeune révolté (la France vient d’être secouée par le séisme de mai 68) et fait croire aux flics qui l’interrogent, par esprit de bravade, qu’il connaît le fuyard. Alors qu’il est embarqué dans le panier à salade, lui reviennent en mémoire ses souvenirs de jeunesse et les nombreux séjours au poste qu’il effectua. L’œuvre autobiographique qui va en découler apparaît alors comme une sorte de bilan (même si ce mot, relevant de la comptabilité, est atroce) et va permettre à Blondin de se livrer à une sorte d’introspection mélancolique :
« Aux approches de la cinquantaine, je ne porte pas de cravate. Je suis resté mince, mon œuvre aussi. J’envisage la rive droite de loin. Je ne traverse jamais le boulevard Saint-Germain, sauf pour me rendre à Tokyo. Mon univers se borne à deux cents mètres carrés de bitume, une plantation de café-tabacs. Je continue d’habiter les ruines d’un palais sur le quai Voltaire où j’ai connu autrefois un bonheur baroque entre mes parents et mes amis. »
C’est au cœur de cet univers circonscrit à quelques bistrots et aux commissariats où semblent toujours le conduire ses frasques avinées que nous plonge Blondin. Au-delà du plaisir immédiat que procure le déroulé des anecdotes, à l’instar de cet épique moment où l’écrivain et scénariste Albert Vidalie rejoue avec quelques touristes et autres piliers de comptoir la bataille d’Austerlitz, cet autoportrait touche par un style éblouissant qui parvient à mettre des mots sur les sentiments et sensations les plus évanescents : l’inéluctable passage du temps, le souvenir des êtres aimés, les difficultés pour trouver sa place dans l’existence… Antoine Blondin semble toujours dans un entre-deux dont il peine à sortir : entre l’enfance, la figure primordiale d’une mère exubérante et un âge adulte dont il convient de refuser les servitudes (« Sous ma défroque du Jockey-Club, je viens de le décider : je serai un de ces vieux messieurs qui ont gardé le cœur jeune. »), entre une vie de famille avortée (le déchirant passage où l’auteur doit retrouver ses filles pour Noël) et un amour compliqué (avec sa maîtresse Odile), entre ses amis, les beuveries et le sentiment d’une infinie solitude :
« Monsieur Jadis, comme Cadet-Roussel, avait trois maisons : l’une où ses enfants dormaient avec leur mère, l’une où sa compagne dormait avec son mari ; la troisième où sa mère dormait avec son accordéon. Mais il en habitait, le plus souvent, une quatrième où tout le monde dormait avec tout le monde, car celle-ci, la seule où il disposât d’une clef, généralement pendue au tableau, était un hôtel sur le quai Voltaire, où il lui arrivait de s’enfermer à double tour pour mieux poser sur les paysages de son enfance le regard d’un homme libre. »
Alors que « l’autofiction » est aujourd’hui très à la mode, l’écriture de Blondin nous console de tous ces témoignages pleurnichards et revanchards qui tiennent lieu de littérature. Aucune complaisance chez l’écrivain qui brouille d’ailleurs les pistes en adoptant de temps à autre, comme Joyce (cité au début du livre), la troisième personne du singulier. Le « je » devient parfois « Monsieur Jadis », patronyme qu’il donne au « brigadier penché sur la main courante de ce commissariat dont je ne soupçonnais pas l’existence. ». Il ne s’agit en aucun cas de se dévoiler impudiquement mais de se remémorer quelques moments privilégiés pour retrouver une jeunesse perdue, humer le parfum d’une époque révolue, rendre hommage aux amis parfois disparus.
Ne s’arrêtant ni à ses échecs, ni au bonheur de certains moments savoureux (le livre est gorgé d’un humour ravageur), Blondin parvient à saisir quelque chose d’à la fois très intime et très universel en se penchant sur son propre cas. Le lecteur, avec un bonheur constant, le suit sur un fil ténu entre bonheurs éphémères et le sentiment permanent d’un équilibre précaire :
« Presque dix ans après avoir quitté le foyer que j’avais fondé, je n’avais toujours pas déballé mes cantines, dont les étiquette (et le pêle-mêle) racontaient des campagnes sentimentales mitigées. J’avais refusé qu’on m’installât une table de travail ; mes vêtements épars sur des sièges branlants confirmaient un sentiment de provisoire, que je me flattais d’ériger en discipline, craignant que mon île d’Elbe ne devînt Sainte-Hélène pour de bon. »
Par petites touches pudiques, Antoine Blondin parvient également à faire revivre de manière extraordinaire les « personnages » qui peuplent son univers. Outre Albert Vidalie, il rend un hommage à la fois drôle et bouleversant à sa mère, toujours présente pour tenter de le tirer d’embarras et lui venir en aide. Ou encore, bien évidemment, à son ami Roger Nimier qui apparaît à la fois comme un sauveur (la scène où il le tire de prison) et comme un mystère insondable : « Bien souvent, nos rencontres, où nous n’échangions rien que de léger, tiraient leur poids et leur prix du secret. Cela n’est pas sans gravité que de se cacher sans raison. Il nous arrivait de nous asseoir au détour de l’existence, comme deux blessés dans un jardin public, que le soleil rapproche. Peut-être étions-nous vraiment blessés sans le savoir ? Et peut-être le secret était-il notre soleil ? »
Le voyage organisé en Angleterre pour assister à un match de rugby se transforme en épopée aussi burlesque que mélancolique lorsque tombe le couperet final : « Ensuite, le dépliant ne prévoyait plus rien pour lui, qui n’allait plus jamais ressortir de cette nuit, au bord de laquelle nous n’aurions peut-être pas dû le laisser. »
Tout Monsieur Jadis ou l’école du soir tient dans cette phrase bouleversante : un style étincelant mais jamais ostentatoire, une infinie pudeur qui refuse de lever le voile sur ce qui fait la part la plus secrète et intime des individus tout en laissant entrevoir les douleurs indicibles et les regrets déchirants. Jamais le livre ne se complait dans le malheur ou le chagrin : sa mélancolie est joyeuse et son humour aussi irrésistible que triste.
Il faut donc se précipiter sur ce joyau littéraire : c’est un enchantement permanent.
***
Monsieur Jadis ou l’école du soir (1970) d’Antoine Blondin
Editions La Table Ronde, collection La Petite Vermillon, 2020
257 pages, 7,30 €
Sortie le 15 octobre 2020
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).