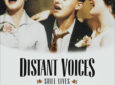Le temps retrouvé. C’est le nom choisi par le Centre Pompidou pour la rétrospective consacrée à Terence Davies, qui s’est éteint le 7 octobre dernier. Nul doute que ce titre aurait également pu s’appliquer au dernier film du réalisateur, sorti à titre posthume le 6 mars. Car ce récit non-linéaire de l’existence du poète anglais Siegfried Sassoon, construit sur une série d’allers-retours entre passé et présent, est tout entier porté par une recherche. Celle de ce temps perdu qui ne saurait être défini ou daté précisément mais qui se reconnaît immédiatement en tant qu’émotion, gravée en nous par la confluence des rêves et des souvenirs.
Cette quête se déploie à partir d’un moteur narratif – en l’occurrence, le traumatisme originel de la Première Guerre mondiale qui ouvre la narration – et d’un principe esthétique – celui consistant à laisser poindre la poésie de Sassoon à la surface du film, par une voix off narrant ses vers, parfois accolés à des images d’archives du conflit. Au commencement était donc la perte, celle d’une forme de candeur et d’idéalisme qui se lit, durant les premières scènes, sur le visage de Jack Lowden, interprète habile du poète par son oscillation entre un air amusé et un regard doté de gravité. Lui ôtant d’abord son insouciance, la guerre de 14-18, uniquement visible à travers ces films en noir et blanc qui fonctionnent comme autant de rappels de la réalité, finit par dépouiller le personnage de toute croyance en la possibilité de cette recherche. D’où sa conversion au catholicisme révélée dès le début du film par ce flashforward qui glisse des images du champ de bataille au visage vieilli et désormais austère de Sassoon sur les bancs d’une église, à la poursuite de quelque chose de « permanent, d’inaltérable », selon ses propres mots. La plus grande défaite provoquée par la guerre se situe sans doute ici, dans cet abandon de l’art comme expression recherchée de la vérité au profit de la religion.

© 2024, Condor Distribution
Ce passage d’un âge à un autre est amené par un travelling circulaire qui revient tout au long des Carnets de Siegfried comme un leitmotiv conduisant au mélange des temporalités et des différents régimes de réalité – les incartades poétiques se superposant à l’assise du présent. Par ce motif et par les rencontres opérées entre le verbe de Sassoon et la mise en scène, Davies parvient à trouver une forme qui n’apparaît pas comme une simple illustration de la poésie – projet vain qui ne peut conduire qu’à un appauvrissement des deux médiums – mais qui en constitue une expression proprement cinématographique. Forme d’autant plus fondamentale qu’elle renvoie à la recherche poursuivie par le poète – point nodal du film – et qu’elle assoit encore davantage le récit dans son flux de conscience. Cet ancrage dans l’intimité est également renforcé par le choix de ces décors épurés, habillés par un nombre toujours réduit d’individus, qui semblent effacer le monde extérieur, laissant Sassoon à son microcosme artistique et à ses seules images mentales. L’ambiance y est comme assourdie, baignée par un éclairage de fin de journée, traduisant ainsi la pudeur des sentiments du héros – et, sans doute, leur impossible plénitude.
On ne peut alors que regretter que cette esthétique de la recherche soit écartée dans la deuxième partie par une narration qui se concentre sur les différentes relations amoureuses du personnage, sans en approfondir les enjeux ni les impacts émotionnels. Il faut alors attendre un dernier mouvement consacré à sa vieillesse pour que reviennent, par surimpressions, les visions d’un homme assailli par sa mélancolie. Le choix de recourir à deux acteurs différents pour interpréter les deux âges de Sassoon prend ici tout son sens car, à travers ce passage du visage, plein de malice et aux joues dessinées, de Jack Lowden, à celui, sévère et aux traits creusés, de Peter Capaldi, se dessine l’insupportable défaite de la jeunesse, l’inexorable métamorphose de l’existence. En renforçant le contraste entre les printemps optimistes et les crépuscules amers, Les Carnets de Siegfried laisse transparaître une profonde nostalgie jusqu’à son dénouement, sur lequel se referme toute l’œuvre de Davies. Et qui rappelle que la recherche, aussi élégante soit-elle dans sa forme, sera toujours insatisfaite.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).