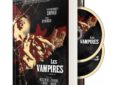Disponible dans d’horribles copies délavées et floues depuis des années et restauré sous l’égide de Severin Films à partir de pellicules très abîmées, Le Spectre du Professeur Hichcock de Riccardo Freda (Lo Spettro, 1963) se révèle enfin dans toute sa splendeur aux regards des cinéphiles aguerris lors de cette trente-et-unième édition de l’Etrange Festival. Longtemps considéré comme une fausse suite un peu mineure du joyau nécrophile L’Effroyable secret du Professeur Hichcock du même Freda (1962), Le Spectre… réintègre la place qu’il mérite, celle d’un chef d’oeuvre qui bouleverse tout autant pour la maîtrise de sa mise en scène impressionnante et la puissance gothique de ses éclairages et de sa photographie que pour les aspects vénéneux d’un récit envahi par la cruelle amertume du désamour, plongeant le long métrage dans une profonde mélancolie. Sans compter sur la présence au sommet de la distribution d’une Barbara Steele au faîte de son talent et de son charme aussi toxique qu’irradiant.
Le Professeur Hichcock du titre, interprété par Elio Jotta, est dans un sale état : partiellement paralysé, son esprit louvoie entre la volonté de survivre et le souhait d’en finir, s’injectant lors de ces élans-ci de belles doses de curare desquelles le sauve le Docteur Livingstone (Peter Baldwin), déontologiquement attaché à soigner ce corps douloureux. Amant de l’épouse du Professeur, Margaret (Barbara Steele), et influencé par cette femme fatiguée par sa condition de garde-malade et quelque peu vénale, le médecin se trouve cependant toujours sur le fil de l’euthanasie, jusqu’à finir par passer à l’acte. De cette situation macabre naît le malaise amoureux entre les deux amants, culpabilisant de manière différente. D’autant plus lorsque le fantôme d’Hichcock revient hanter les deux assassins…

Sculpture des ombres et de la lumière (E. Jotta (©Tous droits réservés)
Le récit du film semble classique comme la littérature, évoquant une sorte d’adaptation tacite de Thérèse Raquin passée sous le prisme de la sensibilité gothique du cinéma de Riccardo Freda, et qui prendrait alors conscience de toute la dimension fantastique laissée au second plan à l’avantage de ses données naturalistes dans le roman de Zola alors même qu’elle permettait le déploiement total de sa puissance traumatique. L’effroi dans Le Spectre du Professeur Hichcock se trouve de façon évidente dans la virtuosité de la mise en scène de la lumière, sophistiquée bien qu’appliquant les recettes les plus simples, qui ont auparavant fait leurs preuves tant chez les Expressionnistes allemands que dans le film noir américain ou les quelques films fantastiques de Jacques Tourneur (simples exemples). Comme dans ces précédents, que ce soit par style assumé ou par souci d’économie, la vie et la mort dansent ensemble dans les ombres mobiles sculptant et modelant la lumière, portant en elles toutes les menaces et se faisant point de bascule entre le monde et l’outremonde, celui-ci visitant les vivants pour mieux les emporter. De ce point de vue, le film de Freda exhale la cruelle odeur du caveau duquel les personnages de Margaret et de son amant Livingstone ne font que se rapprocher au gré de leurs actions pour faire main basse sur la fortune du défunt mari, ceci encore renforcé par la photographie dont les couleurs un peu passées font du manoir des époux Hichcock une sorte de pot-pourri gigantesque.

Film-caveau (B. Steele) (©Tous droits réservés)
Par cette mise en scène se révèle la violence psychologique d’une œuvre sans pitié, faisant de chaque personnage le coupable des actions néfastes provoquées envers celles et ceux qui l’entourent et, comme une sorte de retour de manivelle du Mal, la victime de la méchanceté des autres. Car il y a bien quelque chose qui ressemble à de la méchanceté dans Le Spectre du Professeur Hichcock, prenant dans un premier temps des allures de bonté (les soins du médecin ; les attentions de l’épouse que l’on découvrira rapidement infidèle, certes nuancées par les regards aussi expressifs qu’ambigus de l’actrice l’interprétant) avant de dévoiler toutes ses saveurs amères, poison envahissant peu à peu le corps du film (redoublant ainsi les absorptions de curare du malade), aboutissant à un final implacable d’une brutalité morale assez inouïe, acte de décès généralisé de la notion de Bien et de Mal, du récit voire du film lui-même.

Le regard de Barbara Steele, ou l’annonce du plan suivant (©Tous droits réservés)
Dans cette cohérence spectaculairement dépressive, l’actrice Barbara Steele fait merveille, comme rarement. Présence obsédante et toxique comme la cigüe, dont l’expressivité du regard, s’ouvrant et se refermant comme la pupille d’un oeil face à l’ombre ou à la lumière, rythme le récit et ses évolutions, faisant subrepticement apparaître par anticipation le plan à suivre à travers les yeux de chat de l’actrice. Paysage changeant, son visage est lui-même un élément de mise en scène, participe de la puissance esthétique d’un film qui serait vraisemblablement moins fort sans elle. Si besoin était de le prouver, Le Spectre du Professeur Hichcock fait montre du talent de Barbara Steele, actrice au visage de cinéma muet, comme sortie d’un autre temps, mais en même temps si atemporel. L’actrice a fait à l’Etrange Festival l’honneur de sa présence pour une double programmation (Le Spectre…, donc, ainsi que Frissons de David Cronenberg [1975]) lors de la soirée qui lui fut consacrée, ponctuée par un entretien en public d’environ une heure mené par Olivier Rossignot. A quatre-vingt-sept ans, Barbara Steele n’a pas perdu grand-chose de sa superbe, femme encore plutôt alerte eu égard à son âge, et au caractère très affirmé. Plus important : son regard n’a rien perdu de sa force fascinatoire. Ou quand la majesté d’une actrice enflamme tout autant l’écran de cinéma dans le film de Freda qu’elle impose le respect une fois sorti du cadre. Car en effet, Barbara Steele est de manière générale toujours un peu sortie du cadre. Moment marquant de cet Etrange Festival !
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).