Depuis la première partie de ce long entretien qui revient sur 23 ans de carrière dans le cinéma radical, son nouveau long-métrage Zaman dark a été (et est toujours) présenté en salles ou au festival Zones portuaires de St Nazaire. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’a jamais été aussi vu par la presse et certains commencent à s’y intéresser sérieusement. Ce nouvel entretien est l’occasion de revenir sur les débuts (d’autant que les liens sont fournis pour en visionner certains), à l’époque où Christophe Karabache était un jeune cinéaste reconnu dans un milieu expérimental qu’il n’allait pas tarder à bousculer dans un insatiable besoin de recherche et d’affirmation.
Quels sont les cinéastes libanais, quelque soit leur style de films, qui te parlent, les films que tu apprécies ?
Presque aucun film libanais ne me touche, ne me parle, de ce que j’ai vu. En tout cas c’est le cas des fictions. Mais je trouve beaucoup plus intéressant quand il s’agit des essais, ou les documentaires-expérimentaux libanais. Là c’est plus fort. Je pense aux films de Mohamed Soueid à titre d’exemple que j’ai découvert il n’y a pas longtemps. Ce qui m’a le plus touché, c’est la poésie qui plane, une certaine mélancolie à la fois légère et profonde, du minimalisme pas conceptuel mais vivant, une présence dans l’absence.
Tu as grandi pendant la guerre civile libanaise. Quel a été ton premier rapport au cinéma ?
Je n’ai pas du tout grandi dans une famille cinéphile ou bourgeoise où quelque fois on trouve un accès plus direct et facile à la culture artistique. Je ne connaissais rien des grands films, pour moi le cinéma c’était les Bruce Willis, les Rambo et les Jackie Chan visionnés sur cassettes VHS. Je trouvais cependant un plaisir oisif dans le visionnage des films. Je regardais en cachette, à l’aube alors que tout le monde dormait encore, des cassettes érotiques qu’avait ma tante dans sa mince bibliothèque, de type Vanessa (Hubert Frank, 1977) ou Emmanuelle (Just Jaeckin, 1974). J’avais 7 ou 8 ans. Quelque chose me stimulait. Je voulais voir encore. Les premiers désirs et le voyeurisme. C’est le cinéma qui se forme en moi. J’étais un enfant assez sauvage qui jouait seul, je refusais d’être avec les autres enfants de mon âge, car je me considérais adulte. Je me faisais des histoires que je jouais et mettais en scène moi-même tout seul, donc un certain imaginaire cinématographique se développait dans mon cerveau, c’était assez théâtral mais avec des visions spatio-temporelles filmiques, donc du montage, mental. Un trip dans ma tête alors que je suis sur place dans ma chambre, ou dans l’abri, quand on se cachait des bombes qui éclataient autour de nous pendant la guerre. Quant à l’expérience du grand écran, c’était un événement en soi la première fois.
J’avais 9 ans. J’étais attiré par une affiche d’un film de guerre, je voulais absolument le voir, pour moi c’était un film de guerre de plus ressemblant à ce que je matais déjà en VHS à la maison. Mais ce fut un choc. Je ne comprenais pas mais j’ai su que ce film est bien différent des autres. Le temps a passé, bien plus tard, j’ai su que ce film c’était Full Metal Jacket de Kubrick ! A mes 13 ans, toujours pas cinéphile, j’ai fait, accidentellement, mon premier « découpage technique » avant l’heure. J’ai décrit une scène d’un réveil d’une femme, seule, dans un appartement, enfilant sa mince culotte, cigarette entre ses lèvres. C’était écrit et découpé en images et sons, sans rien savoir du cinéma. J’ignorais bien sûr le vocabulaire technique du langage cinématographique, j’écrivais « vue » au lieu de « plan » pour décrire la scène. Étonnante feuille que je garde toujours. Autour de 15, 16 ans, je commence à collectionner les affiches des films en petits formats…
Serais-tu d’accord pour dire que c’est la violence de la mort de tes parents dans un attentat quand tu n’as qu’un an, puis ton enfance dans un contexte de guerre qui a influencé ta perception et t’a porté ainsi que beaucoup d’autres cinéastes libanais vers un cinéma du fragment plutôt que du récit, plus sensoriel et plastique que dramatique ?
C’est ce que disent certains critiques qui se sont penchés sur ma filmographie ou même ce que pensent certains de mes amis et entourage. Je ne saurais m’auto-analyser, ni psychanalytiquement, ni existentiellement. Sans doute, si je n’avais pas eu le même vécu je serais une autre personne, peut-être même pas cinéaste, ou réalisateur mais d’autres types de films, plus académiques, conformistes et traditionnels. Mais oui, en tout cas, je sais que ma révolte vient de l’enfance, peut-être pas directement du vide des parents pas connus, mais surtout des événements qui se sont produits post-attentat, durant les années 80 et même adolescent dans les années 90. La guerre à l’extérieur et à l’intérieur de la maison, un conflit agressif, des disputes et bagarres violentes entre les membres de la famille de mon père, l’école francophone disciplinaire et rude des Lazaristes (proche des Jésuites) ont naturellement influencé mes idées que j’exprime à travers un cinéma fragmentaire et de fracture.

Christophe Karabache sur le tournage de Sarcophage. Droits réservés.
Quand as-tu découvert le cinéma expérimental ?
J’ai réalisé mon tout premier essai, Sarcophage, entre 2000 et 2001, et une fois terminé, lors de sa diffusion, on m’a dit que c’est du cinéma expérimental. C’était presque la première fois que j’entendais ce terme. Je connaissais bien sûr, très bien même, les avant-gardes historiques, des années 20, vu que j’étais déjà étudiant en cinéma à la fac. Puis un jour, vers le quartier de République à Paris, j’ai marché sur un flyer noir, qui était jeté sur le sol, sur lequel je perçois l’image de L’homme à la caméra de Vertov et en-dessous c’était écrit L’ETNA ! Intrigué, je me renseigne vite et je découvre ce magnifique atelier et j’adhère rapidement à l’association, ce fut ma seconde résidence, mon laboratoire de création. Une euphorie. La belle époque !
Connaissais tu les films de Lionel Soukaz comme Ixe ?
Je l’ai découvert pendant mes premières années d’adhésion à l’ETNA où j’ai rencontré Soukaz. Ce que je retiens de ce film, c’est son énergie accélérée du montage et sa pulsion rythmique.
Quels sont les cinéastes de l’ETNA avec qui tu as collaboré et qui t’ont influencé sur le plan des pratiques, de la technique ?
Je discutais beaucoup avec Philippe Cote, Xavier Baert, Othello Vilgard au début et plus tard avec Mauricio Hernandez. J’ai appris beaucoup de choses techniques d’Hugo Verlinde. J’aimais quand je croisais Maurice Lemaître à quelques assemblées visuelles. Mais je ne peux pas vraiment dire influence ou véritable amitié avec les membres du collectif. Mes films ont tout de suite divisé, scandalisé même. Je distribuais aussi des tracts-manifestes virulents pour défendre les idées que je me faisais du cinéma. C’était des débats vifs. Il y avait une discorde idéologico-esthétique entre nous. La plupart des cinéastes de l’ETNA à l’époque réalisaient un cinéma « beau » et abstrait. Je trouvais cela vide, et j’étais à la recherche d’autres sens révolutionnaires. Je citais L’Âge d’or de Buñuel et les Situationnistes. Ils avaient d’autres, magnifiques références, comme Brakhage ou Kubelka, que je peux aussi admirer par ailleurs.
Tu disais aussi avoir été influencé par Jean Rouch. Quelles traces en gardes-tu ?
Inoubliables et cultes séances de Jean Rouch suivies à la Cinémathèque dans les années 2000 dans le cadre de mes cours. Je garde de grandes leçons comme le filmage avec liberté et enthousiasme, avec des moyens réduits, avec uniquement quelques personnes devant et derrière la caméra, cassant la barrière entre réel et imaginaire. Il nous racontait qu’il filmait avec la caméra mécanique 16mm Bell & Howell, dont le moteur bloque toutes les 30 secondes si on tourne avec la vitesse 24i/s ; alors qu’à chaque fois qu’il rembobine la mallette du moteur, il réfléchissait en direct, spontanément, au plan suivant. A l’époque je tournais avec une caméra similaire, la Bolex, donc cette démarche m’a énormément influencé.
Au départ tu travailles les images des autres, le found footage. Pourtant il me semble au vu de l’unique extrait de Sarcophage (2001) encore disponible que c’est bien toi qui filme pour la première fois un coin de désert au Liban où tu retourneras par la suite à de nombreuses reprises et que dans l’épisode que t’ont consacré Cinexpérimentaux, tu nommes « espace obsessionnel et lieu fatal ». Pour cette première fois (?), l’esprit du plan rappelle à la fois Simon du désert de Buñuel et l’esprit du Pasolini de L’évangile selon St Mathieu et de ses films africains.
Mes premiers films sont entièrement tournés en prise de vues réelles. La pratique du recyclage ou du found footage est venue un peu plus tard. A l’époque je faisais 3 à 4 courts essais par an. Sarcophage était tourné dans une montagne aride désertique où je suis retourné plus tard sur le même lieu pour filmer une partie de Wadi Khaled en 2008, puis pour Beirut Kamikaze en 2010. Quand j’ai filmé Sarcophage en 2001, je ne connais pas encore les films que tu cites. Mais d’autres films de Buñuel comme L’Âge d’Or, Los Olvidados ou Viridiana. J’ai découvert les films de Pasolini plus tardivement.

Sarcophage (Christophe Karabache, 2001)
Contrairement à ce que peuvent penser les français et leur vision uniquement confessionnaliste du conflit libanais, la religion n’est pas si présente dans ton cinéma (une croix par ci par là, une cérémonie à la vierge, un tapis et une prière musulmane). De quelle communauté es-tu issu et quel fut ton rapport à la religion et à la culture qui en découle durant ton enfance et ton adolescence ?
Le confessionnalisme, avec la consommation, restent tout de même les deux conséquences directes de la guerre. Deux composantes dangereuses de l’après-guerre. Je suis issu d’un milieu culturel chrétien et vu que je suis moitié français on m’a mis dans une école francophone très proche des Jésuites avec un enseignement du programme français. C’était l’horreur pour moi cette école. C’est là qu’ont grandi en moi l’esprit de révolte et de rébellion tellement le système était pour moi disciplinaire et angoissant. C’était la terreur exercée sur nous, élèves, enfants et adolescents. Le refus de toute forme d’autorité que j’ai en moi vient aussi de là, c’est l’aspect positif que j’en tire. La première chose que j’ai subverti c’était un symbole christique : le fameux plan de la fille vêtue d’un peignoir masculin et crucifiée dans le désert dans Sarcophage.
Était-ce justement un des sujets de Sarcophage, annoncé à la fois comme une parabole et un documentaire ?
Pas directement. Sarcophage est tourné avec une caméra Super 8 que j’ai acheté aux enchères à Paris. En tout cas il y a beaucoup d’éléments intimes et autobiographiques dans ce premier essai. Des thèmes même qu’on peut retrouver dans les futurs films. Ou quelques obsessions métaphoriques tel le filmage dans les abattoirs et dans les ruines de la guerre.
Continuant la tradition documentaire libanaise des Bagdadi, Chamoun et Masri, Saab et bien d’autres, tes premiers films et Luttes (2003) en premier lieu sont bâtis à partir des images de la guerre civile libanaise dans une dialectique entre les combattants, la population civile et les victimes, des associations ruines/milices qui laissent des traces jusqu’à la pellicule. L’idée de révolution y est aussi critiquée. Quel était ton état d’esprit alors et ta vision politique a-t-elle évolué depuis sur la nécessité ou non des luttes ?
C’est l’aspect communautariste qui me gêne dans toute lutte ou tendance révolutionnaire. Et je n’arrive jamais à accepter qu’une organisation, même avec les idées les plus belles et nobles, puisse me diriger, me commander ou me dire ce que je dois faire. Toute forme d’ordre m’est insupportable. J’ai eu ma longue période tragique concernant ma perception des luttes en général. Je n’y participe pas parce que je mets mon combat dans les films. Mais depuis quelques petits mois l’enthousiasme revient dû naturellement à l’actualité…
Dans Luttes, c’est comme si la culture, à travers l’écriture, entraînait la lutte et par extension la guerre, alors qu’on aurait plutôt tendance à l’associer à la nature humaine. En travaillant la répétition, tu questionnes aussi la notion même d’engagement. Comment a été perçu le film à l’époque ?
Je me souviens d’une projection à la Cinémathèque française où les gens sortaient perplexes du film. Ils me disaient qu’ils avaient apprécié l’esthétique, la technique du collage employée mais il me questionnaient sur ma position politique, et à quel mouvement j’appartenais. Je pouffais de rire à l’époque et évidemment j’envoyais balader tout le monde.
D’où viennent les images de manifestations ?
C’était pendant le sommet du G8 en 2003, à Évian puis à Genève.
Tu disais que tu pouvais alors projeter le film avec n’importe quelle bande son de bombardements…
Oui, c’est très ouvert et libre comme association audio-visuelle vu que c’est un film silencieux. Pour la version numérique j’ai gardé par exemple le bruit du projecteur pendant le transfert de la pellicule à la vidéo.

Luttes (Christophe Karabache, 2003)
Tu travailles dès le départ autant le son que l’image, l’image tournée et l’archive, le côté épileptique donné par la croix de malte, la flamme en surimpression, motifs tirés de la matière-pellicule. Le procédé de tournage est aussi plus complexe qu’il n’y paraît. Tu expliquais toujours dans Cinexpérimentaux que tu les filmais image par image à la Bolex et les photos au banc titre, mais aussi que les effets étaient conçus au tournage et pas en post prod, ce qui est très surprenant…
Oui beaucoup d’expérimentations se faisaient en direct avec la caméra pour ce film. Le filmage intermittent d’image après image par exemple, à chaque photogramme presque je changeais de filtres ou j’enlevais carrément l’objectif ce qui donne une image blanche captée par l’obturateur. Donc la technique du flicker, du montage stroboscopique à la caméra. Ou encore tourner en extérieur avec une pellicule conçue d’une température de couleur pour la lumière Tungstène (pour les intérieurs) sans filtre de conversion. Mais pas que, en plus du refilmage des photographies venant de la guerre du Liban sur un banc-titre à l’ETNA. il y a eu un travail aussi après le développement de la pellicule, comme foutre de la javel sur la bande pour effacer les images, les griffer et en ne laissant que des traces. Des interventions agressives sur la pellicule. Puis le collage de quelque pellicules S8 directement superposées sur la bande 16mm.
Dans Distorsions (2003), tu y mêles justement des photos de famille, comme un exorcisme. Qu’en était-il du reste de ta famille et comment a-t-elle vécu la guerre ?
Toute la famille de mon père a vécu la guerre entre cachette et confinement dans les abris et des moments de trêves en maison. Je me souviens des moments et des années de l’abri, même si la guerre explosait à l’extérieur, l’enfant que j’étais, était heureux qu’il n’y aie pas classe, croyant que je me suis enfin débarrassé de l’école. C’est pendant ces moments là que j’ai développé le sens créatif, entre dessins, écritures et d’autres imaginaires de mise en scène. Il y avait beaucoup de monde du quartier et des voisins qui venaient se cachaient chez nous, histoire que tout le monde se rassemble, aux coupures d’électricité, pour mieux passer le temps, avec les jeux de cartes. Moi j’observais les belles filles plus âgées que moi…
C’est-ici qu’apparaît ton premier insert vraiment pornographique, vitaliste et primal. Tu es plus à l’aise avec le sexe qu’avec la pornographie de l’image de guerre…
Associer guerre et sexe pornographique étaient et sont toujours de grands projets et soucis pour moi. J’y travaille et je m’interroge encore sur cette question.
Quel est ton rapport au cinéma pornographique ? En regardes-tu ? Y trouves-tu parfois un intérêt artistique ou politique ?
Uniquement un intérêt politique et critique. A une certaine époque, peut-être artistique quand j’ai fait Suxion-propaganda en 2004.
Tu as d’ailleurs été programmé au Porn film festival de Vienne en Autriche, une référence dans le genre « cul politisé et féministe ».
Ils avaient programmé Vortex alors que ce n’est pas du porno. Le film avait fait avant un autre festival du même type, le Hacker porn film festival à Rome. Une programmation bien transgressive. Ces festivals, devenus une franchise, se développent dans plusieurs villes du monde, sont les événements underground punk de nos jours. C’est axé sur la représentation du corps, sexué-sexuel, à l’image. Bien politiques et anti-conformistes. Mais communautaires tout de même, c’est là où je prends mes distances.

Suxion propaganda (Christophe Karabache, 2004) Capture d’écran
Aujourd’hui c’est devenu marginal et donc souvent une revendication, un terrain à défendre face au retour de l’ordre moral. Mais peut-on vraiment moraliser le travail sur un plateau X, conscientiser les acteurs masculins, contrôler les financeurs, orienter l’addiction des spectateurs ?
Aucune idée du cinéma X.
Quelle était ton influence en matière de montage au début des années 2000?
Le montage soviétique de l’avant-garde des années 20 ! Entre les collisions d’Eisenstein et les intervalles de Vertov, c’était le comble. Et leurs influences, comme le montage par juxtaposition et opposition dans À propos de Nice de Jean Vigo.
Avec Suxion propaganda (2004) c’est le début de la distorsion entre commentaire et représentation. De qui était le texte d’accompagnement ? Marx ?
J’ai écrit ce texte avec des inspirations de quelques textes anarchistes de Ni Dieu ni maître : anthologie de l’anarchisme de Daniel Guérin. J’ai ciblé le politique, l’économie et le religieux. Un résumé libertaire. Puis on a éructé au micro, sarcastiquement, le chant Frère Jacques, avec mon ami Benoît Foucher.
Ta méfiance du langage de l’image, tout autant au niveau documentaire que fiction, te fait dire alors qu’on boit la propagande comme l’urine et que seule la vérité est révolutionnaire…
Oui, une critique acide et punk de nos sociétés de consommations, pas que des produits d’alimentation ou vestimentaires, mais aussi de sexe et de guerre. À l’époque c’était la guerre en Irak de 2003, les médias commençaient à diffuser l’actualité presque 24/24. Mais ça avait déjà débuté avec le 11 septembre.
Les scènes de sexe sont-elles tournées ou recyclées ?
Tout est recyclé et refilmé. Et pas que pour ce film, je n’ai jamais tourné du pornographique en prises de vues réelles.
Peux-tu revenir sur les conditions de tournage de tous ces premiers films, la durée notamment car ces films qui ont l’air d’être très élaborés, avec des couches, ont pour certains été tournés très vite ?
C’était des tournages très courts et rapides. 2 à 3 jours. Des films hyper fauchés tournés en pellicule, soit en Super 8 soit en 16mm, et vu que le coût était très cher, et de l’achat, et du développement, j’avais 3 à 4 bobines pour chaque film, à savoir qu’une bobine c’est environ 3 minutes de prise de vues si on est à 24i/s.

Christophe Karabache au travail à l’ETNA. Droits réservés.
Connais-tu les films de Dominique Noguez et qu’en penses-tu ?
Non, je ne connais pas et je ne l’ai jamais rencontré. Par contre, son livre Éloge du cinéma expérimental, c’était une grande référence pour moi à l’époque. Je l’ai dévoré avec joie.
En 2005, c’est (pour moi) ton premier très grand « petit » film : Kinoptik : transit Beyrouth-Paris. Il en appelle à Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu. Un texte particulièrement important pour moi à titre personnel. « POUR VIVRE, IL FAUT ÊTRE CACA. l’homme, si c’est un être, c’est de la merde ». Que représente pour toi Artaud ?
Artaud est le grand choc artistique de ma vie, après la découverte du Surréalisme. J’ai découvert tout cela à mon arrivée à Paris début des années 2000. Comme je te disais, je n’étais pas cinéphile, ni issu d’un milieu social accessible à la culture au Liban. La majorité des thèmes qu’on trouve chez Artaud me parlaient énormément, organiquement et viscéralement. La cruauté, le chaos de la vie, la fièvre du monde… Ça me donnait le vertige tellement je me sentais proche et concerné, et dans le vécu des sensations et dans ma chair.
Pour lui, il est question de dépasser le corps pour atteindre le CSO, le corps sans organe, éthérique. Dans Zaman dark, au contraire de Khattar, Anaïs devenant présence fantomatique, accède alors à une forme de liberté et elle peut se moquer de son ancien compagnon, encore enfermé dans la matérialité.
Je n’y vois pas un rapport avec Artaud et je ne l’ai pas conçu en me référant au corps sans organe.
Dans Kinoptik, tu testes une prosodie toute personnelle, qui fait écho à la démesure des images, à leur travail en négatif aussi. Hormis Wadi khaled et son commentaire extraordinaire, qui sonne comme une parodie du Jean Rouch des débuts, tu n’as plus souhaité utiliser cet outil par la suite…
Car j’ai commencé à faire d’autres types de films, où on retrouve des commentaires en voix off mais très différents bien entendu. Même dans mon nouveau film Zombie Cortex (2024), j’utilise un commentaire tout au long du film, que je lis ou vis moi-même, là encore c’est avec un ton rauque et grave mais loin d’Artaud. L’envie reviendra un jour.
Réapparaît ton goût des paysages et pour la première fois, des montagnes enneigées du Liban.
J’ai filmé des bribes de la vie, que ce soit en montagne ou en bord de mer. Mais c’est aussi la spécificité du Liban, la proximité de ces espaces. Kinoptik était filmé avec des pellicules 16mm périmés et que j’ai laissé en négatif pour les noirs et blancs.

Christophe Karabache à l’œuvre à l’ETNA. Droits réservés.
L’abstraction n’est pas loin, on penserait presque à du Peter Kubelka (le point qui danse).
Là encore un filmage image après image pour obtenir un effet de scintillement saccadé et assaillant.
« Nul besoin de respecter la violence pour l’exprimer » : un axiome que toi tu as respecté durant toute ton œuvre…
Je fais un cinéma dans lequel j’exprime mes sensations, mes idées du monde et surtout les choses que j’ai pu ressentir dans ma vie. Donc le vécu. Et dans ce vécu, depuis l’enfance, j’étais confronté à la violence. La violence de la guerre, la violence de la famille à la maison, la violence de l’école et de la société.
À Florac, le festival a été marqué par ce long moment de larsen terrifiant qui vrille les têtes des spectateurs, collés à leur siège. Tu as vraiment cherché à rendre malades ou complètement fous les spectateurs de tes films. On a presque l’impression d’être un membre de la bande à Baader enfermé dans les cellules de Stammheim !
J’adore et c’est la force de l’image en général et l’impact du grand écran ! Par ailleurs, concernant la représentation de la violence à l’écran, des fois je me demande si j’étais plutôt écrivain et m’exprimais à travers la littérature, si ces idées là passaient mieux à travers le livre plutôt que les films, le cinéma étant d’abord une industrie de divertissement obéissant aux lois du marché et un art qui se veut populaire. Je ne sais pas…
À cette époque, tu suis en parallèle des études? Retournes-tu aussi plus fréquemment à Beyrouth ?
Dans les années 2000 voire 2010, j’étais plutôt basé à Paris et j’allais l’été au Liban ou quand j’ai un tournage là bas. En 2015, suite au décès de mon oncle, ça m’a énormément affecté et j’ai coupé court. Je ne suis plus retourné, de 2015 à 2020. J’ai fait donc des films en France et un en Belgique. Puis l’inspiration libanaise et l’envie sont revenues, sans doute aussi suite aux multiples événements récents dans la région : l’explosion du port de Beyrouth en 2020, l’effondrement après la crise économique, le crash bancaire, la menace en boucle du retour de la guerre, l’instabilité permanente, etc. Depuis 2020 je passe plus de temps au Liban qu’à Paris.
Zone frontalière (2007) est dédié à la première femme avec qui tu as fait l’amour quand tu avais 15 ans, une prostituée. Tu en reparleras à plusieurs reprises. Pour toi, était-il vital de combler le vide de la maman par l’image maternante de la putain ?
Pas du tout. Enfin je ne sais pas. Et là encore une fois, il est très délicat pour moi de s’auto-analyser psychologiquement. Ce n’est pas à moi de le dire ni de le savoir d’ailleurs. Ma première expérience sexuelle, dans les années 90 au Liban, était avec une prostituée. Il était difficile à l’époque de faire des relations avec les filles de mon entourage qui demeure très conservateur, traditionnel et religieux. Les choses ont carrément changé de nos jours, enfin cela dépend des milieux familiaux et communautaires. Pour la dédicace, c’était pour deux raisons : c’est un film à la première personne sur l’état du pays et mon corps dans ses ruines et son chaos, il me semblait vital d’insérer cette notion. La deuxième raison est par pure provocation, je savais que ça allait déranger beaucoup de personnes y compris les festivals institutionnalisés et moralisés de dédier un documentaire sur la guerre à une telle anecdote.

Zone frontalière (Christophe Karabache, 2007- Capture d’écran
Zone frontalière nous fait vraiment entrer dans une seconde époque de ton travail, marquée par une approche totalement chaotique du documentaire. Ce n’est pas seulement l’esthétique des ruines, mais le refus du beau ou des effets genre shaky cam pour une caméra emballée, démentielle, un montage heurté aussi et des musiques envahissantes (requiem), un traitement qui correspond à l’état du pays au moment de la nouvelle guerre avec Israël.
Exactement, La forme rejoint le fond chaotique. Je voulais décadrer plutôt que cadrer, décentrer plutôt que centrer, défaire plutôt que faire, déconstruire plutôt que construire. C’est un film hybride aussi par l’emploi à la fois de la pellicule 16mm et le filmage en caméra numérique utilisant des cassettes mini-DV de faible qualité. Quant au montage, j’optais volontairement à des hiatus, à des syncopes et à des contre-points audiovisuels assez bruts.
Là tu fais du trash et du gore avec des figurines au martyre et c’est tout aussi efficace que les images de guerre. C’est aussi plus fort que dans de nombreux documentaires qui généraliseront leur emploi, exemple Rithy Panh et L’image manquante. De même que la mort en direct peut être exprimée de façon toute aussi révoltante par celle d’un animal…
Oui et bien avant Zone frontalière, ça remonte à mon tout premier essai, où je mettais en parallèle les ruines de la guerre et la mort d’un animal découpé en direct ou la trace de sa carcasse. Des métaphores et des allégories de la cruauté de la vie.
Tu filmes ce qu’on ne voit jamais dans les guerres, les à côté, la vie qui continue, le type en fauteuil roulant au milieu d’un trafic routier dense, ce qui tranche avec le misérabilisme obligé dans ce type de documentaires.
C’était l’approche de ce film. De filmer le quotidien du pays de l’après-attaque de l’armée de Tsahal contre le Hezbollah en juillet-août 2006 mais qui s’est manifestée dans plusieurs régions libanaises et pas qu’au sud ou dans la banlieue-sud de Beyrouth où réside la majorité des partisans du parti. J’étais là bas pendant ces événements, l’aéroport était bloqué. Je me souviens que quelques collectifs militants et même des programmateurs de films ont lancé des appels pour que les cinéastes filment la guerre ou leurs expériences en direct. Je n’étais pas intéressé par cette démarche, moi qui critiquais aussi la surabondance des images autour de nous, on est entouré d’écrans consuméristes, on bouffe les images d’actualité etc, donc je n’étais pas excité par l’idée, même si je comprends la nécessité aussi du témoignage mais après tout je ne suis pas un reporter de guerre et je ne dois pas forcément réagir à l’actualité rapidement ! J’ai vécu les événements, j’ai observé, j’ai senti et 6 mois plus tard j’étais prêt à l’attaque ! Zone frontalière est tourné en janvier 2007.
Ici commence la présence de ta corpulence, l’exposition de sa nudité et une obsession pour la viande qui t’amène de plus en plus à la mettre en jeu jusqu’à aujourd’hui, comme le végétarien que tu n’es pas.
Mettre mon corps est comme une participation totale à l’œuvre. Surtout dans des films organiques et viandeurs.
De qui sont les textes récités en off ?
J’ai co-écrit les textes Off avec mon ami Benoît Foucher qui était l’assistant sur ce film et a séjourné quelques petites semaines au Liban pour réaliser le film. Des textes à la fois surréalistes et sarcastiques, dont un qui était plutôt mélancolique, contemplatif.

Beirut Kamikaze (Christophe Karabache, 2010) Capture d’écran
Les images de répression policière sont impressionnantes et ces plans reviendront ultérieurement dans tes autres films. De quelle lutte politique ou mouvement social s’agit-il exactement ?
Aucune lutte. Là je suis tombé sur des protestataires des deux grands partis chrétiens, qui se battent et s’opposent depuis la guerre. Et au centre, le Pouvoir a envoyé les militaires pour les séparer et d’un coup ça dégénère et la violence surgit. Dans ces cas là, bien sûr la nature du filmage change, on est plus dans la captation brute du réel et dans la spontanéité. J’essaie tout de même de chercher un point de vue dans la vitesse et l’urgence. C’est toujours une opération difficile – mais pas impossible – dans l’action et le chaos.
Le film s’achève sur une chanson sublime qui parle de ce pays où le bruit règne en maître et qui tranche avec le chaos visuel total. Qu’est devenue l’autrice interprète Rana Keserwany ?
Je ne la connais pas. C’est une amie du compositeur Charbel Khoueiry. On a enregistré la chanson à distance. Je n’étais pas présent. Selon les dernières nouvelles, elle se soignait dans un internat suite à une overdose.
Charbel Khoueiry sera un de tes complices à plusieurs reprises…
C’est un ami d’école. On a collaboré dans trois films : Zone frontalière, Wadi Khaled et Beirut Kamikaze.
Comment s’est déroulé le montage avec Manu Bodin, avez vous du déconstruire beaucoup et quel fil suiviez-vous ?
Manu Bodin est un vieux compagnon de route chez qui je faisais le montage numérique de Mondanités en 2005 jusqu’à Lamia en 2014. 11 films montés avec Bodin en ma présence bien entendu. Ce que j’appréciais avec lui, c’est qu’il un bon technicien et il trouvait rapidement des solutions techniques. On discutait peu voire pas du tout, sauf quand j’avais quelques hésitations. Je disais où il fallait couper et comment raccorder. Un travail presque mécanique et très efficace. Pour Zone frontalière et d’autres films dans ce style où l’association image-son reste libre, le fil qu’on suit c’est la sensation du rythme plutôt qu’une trame continue et homogène.
Je vois Wadi Khaled (2008) un peu comme un film hors du temps, un espace mental, hétérotopique, qui en fait, te définit. Le ton est satirique, la diction violente, le tout étrange mais profondément beau. Et pourtant il conserve un lien fut-il ténu avec la réalité, manière de dire que tout est toujours plus complexe. « Ces gens en bordure » ne vivent pas que sauvagement, ils sont de merveilleux sujets de film, qui est comme illuminé, par leur nécessité de vivre et leur plaisir d’être filmés. Est-ce que tu peux revenir sur le travail avec ces non-acteurs et sur comment tu les as approchés ?
Le modèle de Wadi Khaled est Las Hurdes de Buñuel. Je peux citer d’autres références bien sûr comme le ton du commentaire à la Rouch ou le texte L’esthétique de la faim de Glauber Rocha. C’est avant tout un « documenteur » (mockumentary) dans la tradition surréaliste. Toutes les scènes ne sont pas tournées dans la région de Wadi Khaled (une région au nord du Liban à la frontière syrienne). C’est un montage qui crée un espace imaginaire composé et fictionnalisé. Mais toujours à partir du réel et des éléments tirés de la réalité rude du pays. Ce n’est pas un reportage journalistique sur les conditions pauvres des habitants de la région, loin de là. Le film est une pure mise en scène tourné comme si c’était un vieux documentaire. J’ai utilisé des pellicules périmées, tamisées et bien délavées en Super 8 développées artisanalement à L’ETNA en évitant de passer par un laboratoire professionnel justement pour obtenir cet effet hors du temps. Sans techniciens ni assistants pro pendant les prises de vues. Mon oncle conduisait la voiture et moi j’effectuais les travellings, caméra au poing. Pour les enfants, je les croisais dans la rue et je les filmais assez naturellement. Je suis à l’aise en général quand il s’agit de filmer sauvagement des enfants. Ce sont les meilleurs, j’adore ces moments ! Un jeu s’installe rapidement entre eux et la caméra. Et ils sont assez généreux et créatifs. Concernant les adolescents dans la brouette, là on revient au fameux désert. Ce sont les amis de mon cousin et on les voit aussi plus tard dans Too much love will kill you dans la scène nocturne de dispute et de rixe.

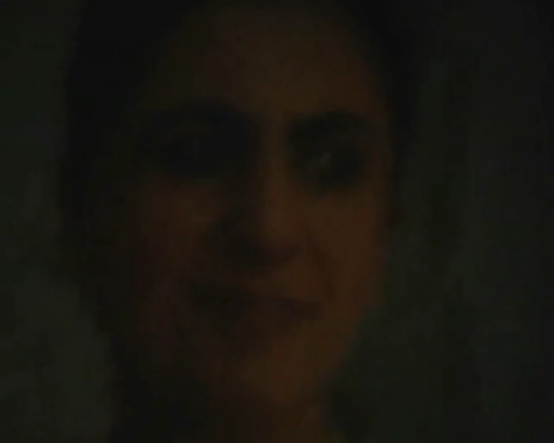

Wadi Khaled (Christophe Karabache, 2008) Captures d’écran
Ces personnes ont-elles vu le film un jour ?
Surtout les amis du cousin. Ils ont beaucoup ri. Mais jusqu’à aujourd’hui, je reçois des commentaires d’insultes, ou des injures très offensives sur le net, là où le film est disponible en visionnage libre, surtout des habitants du nord en me reprochant agressivement que je suis un tricheur, que tous les plans ne sont pas originaires de la région Wadi Khaled et que je suis en train d’insulter toutes ces personnes en diffusant une image négative et hallucinante. Ce qui est quasiment vrai mais c’est la démarche créative du film. Là on peut poser la problématique de la morale dans la création artistique notamment dans l’approche du documentaire. A quel point l’artiste doit la respecter et quelle est la limite ? Dans quelle mesure la vérité au cinéma est-elle liée à la réalité ?
Peux-tu préciser ta collaboration au long cours avec Benoît Foucher, l’homme derrière la voix ?
C’est un autre compagnon de longue date. Un grand ami avec qui j’échange énormément sur mes films, notamment à leur finition du montage. Je les teste sur lui. Je fais mes previews avec lui.
Plus que par le commentaire malicieux et dont l’arrêt provoque la mélancolie, c’est finalement dans la transe créée par les percussions de Charbel Khoueiry que tu retrouves ton mentor, Jean Rouch.
Oui aussi dans les mélodies musicales. A noter que le morceau mélancolique à la guitare est de Roy Abboud, un musicien libanais qui a également collaboré pour Too much love will kill you en 2012.
Le travelling final sur les baraquements témoigne-t il d’une réalité sociale ? Qui y vit ? Des déplacés de guerre ?
Ce sont des bédouins kurdes de la Syrie. Des réfugiés depuis la fin des années 90. Des agriculteurs, marchands de légumes et de bagnoles. Mais ça peut aussi trafiquer d’autres choses aussi (sic)…
J’y vois un écho et un prélude à Je veux voir (Joreige et Hadjitjomas) qui s’achève lui sur un travelling sur des grues qui rebâtissent.
Aucun lien avec le film que tu cites.
De Tout va mieux (2008), on ne peut voir que quelques scènes et plans épars, une d’incommunicabilité dans un salon et qui annonce les films à venir et traduit ton envie grandissante de travailler avec des acteurs.
C’est mon tout premier travail avec les acteurs et avec une équipe technique réduite. C’est effectivement une matrice qui annonce les films qui viendront par la suite. Surtout pour les plans longs très composés et les cadrages fixes insistants.
Le paradoxe qui te va bien, c’est que tu les utilises pour jouer du « rien » ou presque. En réalité quelle indication de jeu leur avais tu donné ici? « Faites ce qui vous passe par la tête » comme Gérard Courant pour ses Cinématons ?
Non, tout était dirigé. Certes ils ont une liberté dans la rythmique, je leur laissais le temps d’agir mais la majorité des gestes et actes étaient organisés à l’avance et répétés même. Cela n’empêche pas quelques élans libres d’improvisations et des gestes imprévus ou venant des acteurs, et je les validais si cela m’intéressais. Les moments qu’on ne contrôle pas restent les plus forts et les plus gracieux. On tournait très peu de prises. 2 ou 3 prises pour chaque plan au grand maximum, des fois un seul plan suffisait. Tout va mieux (40 minutes montées) est tourné en 2 jours en région parisienne.

Tout va mieux (Christophe Karabache, 2009) Capture d’écran
L’autre, c’est ce travelling arrière incroyable sur une femme au fusil agenouillée dans une brouette puis d’autres visions : une femme seins nus tentant de gober un poisson, un homme avançant avec la carcasse d’un animal en étendard et qui nous ramène à Jodorowsky et à La montagne sacrée, un cinéaste que je t’imagine bien apprécier.
J’apprécie Jodorowsky et encore plus Arrabal (Viva la muerte) du même mouvement Panique. J’ai eu l’idée de la crucifixion du lapin cru après la découverte du film complètement déjanté de Werner Herzog, Les nains aussi ont commencé petits avec cette scène démente de la voiture qui tourne en rond avec un cygne crucifié.
Son cheminement avec deux autres personnes est aussi très pasolinien, encore une fois. Plus que jamais, tes courts sont des études, des expérimentations libres pour tester des idées…
Je considère que tout film doit être conçu comme une expérimentation, un laboratoire d’essai. Je déplore les courts-métrages formatés, normés conformistes du cinéma d’auteur et les très conventionnels films de genre, qu’on voit dans les festivals ou sur les plateformes, jouant la carte de visite pour montrer leurs prouesses technico-industriels. Ainsi que leur soumission institutionnelle. C’est lamentable tellement ces films sont privés de singularité. Ces réalisateurs, jeunes ou vieux, passent plus de temps à monter des dossiers de demande de subventions qu’à faire des films.
À quelle époque as-tu vécu aux États-Unis ? Quelles images en as-tu gardé ?
La première fois, c’était en 2006 lorsque j’ai obtenu une bourse universitaire pour compléter mon master en cinéma. Je suis parti à l’Université de l’Iowa dans l’Amérique profonde. Magnifique et très enrichissante expérience. J’ai survécu même à une tornade qui a détruit le studio dans lequel je résidais. J’étais au centre du cyclone qui me frappait dans tous les sens mais j’étais plus fort (sic) et par chance j’ai échappé belle à cette catastrophe. Depuis je retourne de temps à autre aux États-Unis pour projeter mes films dans des divers festivals. Je suis même devenu ami avec quelques programmateurs là-bas.
Il doit être difficile pour toi, politiquement, de t’y rendre… Toi qui dira plus tard dans Beirut Kamikaze « je viens pour abolir votre stupide mentalité de soldat ». Il y a des choses là bas qui résonnaient avec ta colère ?
On trouve de tout, et contrairement aux idées reçues il y a des gens librement ouverts d’esprits, subversifs et anti-hollywodiens, anti-netflixiens très engagés et intéressants aux States, encore plus qu’en France. La France dérive à droite, à la droite extrême même, avec des tendances conservatrices et patriotiques. On trouve cela partout maintenant, dans cette période particulièrement dangereuse.
Trans society (2008) paraît justement être une étape vers Beirut kamikaze.
Je pense que c’est plutôt Zone frontalière qui est l’ancêtre de Beirut Kamikaze, en tout cas le plus proche dans l’esthétique fragmentaire de la brisure. Dans Trans society, j’ai suivi une déambulation en région parisienne, entre fiction mise en scène et captation réelle, de mon ami Ali Gül Donmez, un kurde de Turquie. C’est un film accidentel si j’ose dire, car j’ai filmé ces images sans vraiment savoir comment j’allais monter ce film ou comment ça sera comme résultat final. Puis au montage, j’ai associé cette partie française à mes rushes du Liban tournés pour Zone frontalière et assembler ces deux parties à une troisième, mon passage à New York pendant mon séjour étudiant à l’Iowa. Un film très urbain.





Tu as dit que Beirut kamikaze était influencé par les Écrits corsaires de Pasolini ; « Je sais tout des faits ». Il est difficile d’oublier que Le roman du massacre a été écrit presque un an avant son assassinat. Toi tu dis : « tous les hommes politiques libanais sont des assassins ». As-tu déjà eu peur des représailles de ceux que tu vitupères dans tes films ?
Je prends toujours le risque de dire et de faire ce que je veux. Sans mesures. Et il n’y a pas un producteur garde-fou pour m’alerter. Tant mieux d’une certaine façon, alors j’y fonce frontalement avec des films offensifs, instinctifs et provocateurs. Je règle des comptes également. Je les mets dans les films vu que c’est mon moyen d’expression. Si ça peut remuer quelques uns dans la société je serais ravi. Pour l’instant les menaces que je peux recevoir ce sont des formes d’insultes de la part des spectateurs, pas encore des politiques, des miliciens ou des partisans ou des hommes du Pouvoir. Peux-être ça viendra un jour avec un film qui touchera plus de monde. Pour le moment, la position underground est confortable.
« Dans la vie publique, il y a des moments tragiques ou pire encore, sérieux, dans lesquels il faut trouver la force de jouer. Il n’y a pas d’autre solution ». (« Ouvrons un débat sur l’affaire Panella »). Tu traduis ça littéralement par ces enfants qui jouent à la guerre et que tu filmes dans un style de cinéma de combat qui ne ressemble pas pour autant aux vues en go-pro des Gi’S américains en Irak, parce que même dans le chaos, il y a un point de vue, le tien, comme celui de Pasolini.
C’est un moment totalement mis en scène. Bien sûr une allégorie de la guerre. J’ai croisé ces deux gamins, que je ne connaissais pas, dans un parking de voitures. Après une discussion entre nous, ils étaient d’accord de jouer cette scène, et c’est vraiment un jeu amusant pour eux. Alors on a acheté les armes en plastique et on est passé à l’action ! J’ai constaté de suite qu’ils imitaient à leur tour quelques gestes des films d’action. Dans ce type de situation cinématographique, je suis assez à l’aise pour à la fois capter les moments intuitifs proposés par les enfants et d’autres instants que je peux inventer rapidement, installer une mise en scène dans l’urgence, choisir dynamiquement des axes et des cadrages.
Tu es parfois pris à parti par les habitants. N’est-ce pas dangereux de filmer dans la rue à Beyrouth sans une négociation avec les habitants du quartier ou les organisations qui contrôlent ces zones comme le Hezbollah à Beyrouth sud ainsi qu’on le comprend dans Je veux voir de Joreige et Hadjithomas ?
Brandir une caméra, et peu importe sa taille, est un geste suspect, immédiatement dangereux et signalé au Liban. Alors soit je négocie soit j’arrête si je constate une réelle menace pesante. Une fois, pour Zone frontalière, j’ai été durement interpellé dans les rues de Beyrouth par des partisans de la milice Amal (des chiites alliés du Hezbollah). J’étais seul entouré d’une dizaine de mecs agressifs et hostiles à ma présence. J’ai été amené à un interrogatoire dans une pièce sombre, ils ont visionné les images, sans les effacer, et puis m’ont relâché une fois qu’ils ont pris la certitude que je ne suis pas un espion pour Israël. C’est surtout ce qu’ils craignent car il y en a plein. La deuxième fois, c’était en 2020, en filmant après l’explosion du port de Beyrouth, des images que j’ai utilisé à la fois dans Kamaloca (2021) et Kalashnikov Society (2021), j’étais en face d’une usine d’électricité et j’ai été interpellé par les services secrets de l’armée. Là aussi un interrogatoire pénible de plusieurs heures.
Dans un geste situationniste, tu t’y livres à des détournements. On entend Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah sur l’image d’une femme en maillot de bain. Le film a t-il été montré à Beyrouth et auquel cas n’a-t-il pas été vu par certain.e.s comme un blasphème ?
Beirut Kamikaze a été montré au Liban, sans ma présence, dans un lieu culturel de la capitale, qui n’existe plus par ailleurs. Devant un public averti cela ne cause pas de problème. Aucune autre programmation de ce film dans le pays alors que c’est avec ce film que j’ai commencé mes sorties en salles parisiennes, c’est avec ce film que j’ai commencé à atteindre des festivals de plus en plus importants mondialement. Une fois, après une projection du film en 2018 au cinéma Nova à Bruxelles, le film bien sûr a divisé, entre un public occidental qui a bien apprécié, à part quelques dames qui ont été dérangées et qui me questionnaient sur la représentation de la femme dans le film, et les quelques libanais qui étaient choqués à la fois de la forme et du fond. Il y a un réalisateur libanais qui est venu me proposer un stabilisateur pour que mes images soient équilibrées car il avait le vertige et eu envie de vomir pendant la projection. Une autre spectatrice me demandait si vraiment « j’aime le Liban » et pourquoi « je suis comme ça » pour reprendre ses termes. Puis un autre, qui est venu me prendre dans mes bras et serré fort en me disant : « C’est de la bombe ce film. Merci ! ».
C’est un film qui pue le rance et certes tout le monde n’accepte pas l’auto-critique ni la subversion formelle radicale. C’est ce qui me différencie je pense des autres réalisateurs libanais, c’est que ma cible est profonde, se tourne vers l’intérieur, et va beaucoup plus loin que simplement désigner le mal par Israël et évoquer les quelques hommes politiques corrupteurs. Je vais citer une phrase du manifeste Vers un cinéma social de Vigo : « Se diriger vers le cinéma social, ce serait consentir simplement à dire quelque chose et à éveiller d’autres échos que les rots de ces messieurs-dames, qui viennent au cinéma pour digérer ». J’aime bien également cette citation de Seijun Suzuki : « Le cinéma est déjà en soi anti-social. Par l’intermédiaire du cinéma, il faut mettre du poison dans cette rivière qu’on appelle société. ».

Christophe Karabache tournant Fragments d’une vie anéantie en 2003. Droits réservés.
Gaza devient un symbole de résistance, bien au-delà du Hamas ou du Hezbollah qui en revendiquent le terme. Cette résistance au pire s’exprime aujourd’hui de façon exemplaire, ultime. Comment parviens-tu à dépasser ces événements ?
En tant qu’individu anarchiste-libertaire, j’ai mes propres convictions de contre-pouvoirs. Je peux rejeter à la fois les forces destructrices dominantes tout comme les mouvements de propagande des petits qui jouent au service et pour les intérêts des grandes puissances impériales ou autres. Mais je suis d’abord cinéaste, et je sais prendre la distance critique nécessaire pour tenter toujours de voir clair ce monde brouillé. La résistance, la mienne, passe par les films, donc mon moyen d’expression. Par exemple, quand la récente attaque sur Gaza et le sud-Liban s’est déclenchée en octobre dernier, j’allais me rendre dans un festival en novembre en Italie, pour présenter Zaman Dark. Alors que l’aéroport commençait à dysfonctionner, les vols interrompus et annulés, j’étais déterminé coûte que coûte à me rendre au festival pour projeter mon film, ce que j’ai fait par un détour via Paris. Une forme de résistance se déclenche en tant que cinéaste. Là j’ai envie de citer cette phrase de Fassbinder : « Je ne mets pas de bombes, je fais des films ». Faire donc une œuvre libre de déconstruction sans adhérer à aucun courant artistique ou politique.
La charogne terminale et le lit bétonné de la rivière reviendront au moins deux fois dans tes films ultérieurs, même si ce plan initial reste le plus beau et le plus beaudelairien, la caméra tournant autour plus comme une caresse que comme un charognard. Ça donne l’impression d’une régénération possible…
C’est par pur hasard que j’ai croisé ce mouton égorgé jeté en plein fleuve asséché et crade de Beyrouth. Certes je tournais pas loin du grand abattoir situé dans la périphérie de la capitale. Une zone qu’on appelle La Quarantaine. Je faisais mon travelling avant, caméra portée à main, en filmant les immondices puis je vois soudainement cette charogne, je ne m’arrête pas, et je tourne autour. J’étais excité, agité et vif après cette découverte. Je sais que je tenais, cinématographiquement quelque chose. Puis je décide de faire un filmage dans le sens inverse, ce qui a donné le long travelling final de Beirut Kamikaze. Pendant l’exécution de ce plan, au dessus du tunnel, sur le trottoir de l’autoroute, il y avait une personne qui m’insultait et pestait contre moi, me voyant filmer cette charogne. Pour lui, j’étais en train de diffuser une image négative du pays. Je n’ai pas répondu aux injures (alors que si je n’étais pas en cours de filmage je l’aurais fait avec enthousiasme et férocité), je suis resté concentré sur l’exécution de mon plan en mouvement, je n’ai pas regardé derrière moi et j’ai foncé tout droit, continuant mon long travelling à pieds traduisant le rythme haché de ma respiration saccadée.
Que symbolise pour toi ce contrôle humain du cours d’eau ?
Une forme d’aliénation et d’oppression. On voit de multiples dispositifs de contrôle et de surveillance qui utilisent la technologie de l’époque – le numérique – pour réprimer de plus en plus. Comme si le Pouvoir avait peur. Je réfléchis beaucoup à cette question, je la vis car c’est notre période. À suivre dans un film…
En 2015, Michel Amarger et Frédérique Devaux, suite à leurs découvertes des avant-gardes beyrouthines, te font l’invité de leur manifestation à l’Entrepôt. Quels films y étaient présentés et est-ce que ça a quand même augmenté ta visibilité sur Paris, attiré un peu de presse ou de critiques ciné un peu plus ouverts que d’habitude ?
Mes films Zone Frontalière et Dodgem ont été projetés pendant cet événement à l’Entrepôt organisé par Amarger et Devaux. Il y a la journaliste Mona Makki qui m’a contacté de la part de l’émission ‘Espace Francophone’ qui passait à l’époque à France 3 télévision. Ils ont fait une interview filmée dans le cadre d’un épisode consacré au cinéma contemporain libanais. Par la suite c’est le critique Jean-Français Rauger qui a commencé à chroniquer mes films, trois fois de suite, dans Le Monde, lors de leurs sorties en salles.
Prochainement, troisième et dernière partie de cet entretien.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).




















