Je t’ai dérangé, tu me pardonnes
Ici quand tout vous abandonne
On se fabrique une famille
Maxime Le Forestier
C’est l’histoire d’une vie. De Jacques Bauchot, né à Versailles, d’une mère dévorante et grandiose, et d’un père banquier absent au monde, revenu des camps avec un vide abyssal, qu’il comble comme il peut en essayer d’aimer. C’est l’histoire de Jacques, de son enfance au milieu d’une famille aisée mais complexe (nous allions écrire dysfonctionnelle, mais quelle famille ne l’est pas), blessée, puis cherchant à s’en sortir, dans les limons de ses complexes, douleurs, héritages, naviguant entre les joies, l’amour et les absences. Il grandira avec ses frères, entre brimades et tendresse, dans la grande maison de Versailles où veille la mère comme un oiseau de proie jusqu’à provoquer le départ du père, puis seul, portant la maladie et la judéité du père comme d’autres portent une croix, aimant, perdant des gens, en découvrant d’autres, quelque part à Paris, Marseille, Versailles, New York ou Kongoussi.
C’est l’histoire de Jacques Bauchot, mais c’est aussi, un peu, nous le verrons, celle de Richard Morgiève, auteur prolifique et ô combien précieux pour la littérature française, mais dont les œuvres sont (pour le moment) encore trop peu célébrées à leur juste valeur majeure. L’histoire d’un auteur qui voit un jour un ami lointain, Jacques Bauchot, donc, le « vrai », lui demander de raconter son histoire. Autant dire que la proposition fut accueillie plus ou moins avec gêne, d’autant que se glisser dans une vie n’est pas la moindre des gageures. Et pourtant, quelque chose là dedans le fascine, alors il cherche, hésite. Jusqu’au jour du déclic : en fouillant dans la boite à souvenirs de Jacques, Richard s’illumine. Il voit le petit jardin, il voit la fontaine, il se trouve chez Jacques. Il est Jacques. Le deal est donc acté : une biographie, oui, mais d’une liberté totale, qui peut être, aussi et surtout, un roman.
Ainsi débuta donc « La fête des mères », publié en cette rentrée chez les magnifiques editions Joëlle Losfeld, après une première vie sur laquelle nous reviendrons, et dont il nous faut, à présent, tenter de dire avec maladresse l’éblouissante beauté.
- Ombre et lumières.
Après un grand silence qui m’a fait battre le cœur pour toute la vie, je me suis éveillé. J’ai touché mon visage, mon crâne, pour me rassurer. Vérifier si j’étais moi. J’étais perdu dans mon pyjama, perdu de partout. Comme si je venais d’essayer de photographier l’instant d’avant la création du monde. Je suis resté comme ça je ne sais combien de temps. Je suis sorti de la chambre. Par la fenêtre, la clarté de la nuit éclairait l’escalier aux marches peintes en blanc, je n’ai plus bougé. Je ne voyais que le palier, le tapis bleu qui recouvrait en partie les marches, les appliques en bronze doré imitant des torchères, mon ombre sans trop d’ambition d’enfant. Je n’étais pas vieux, ça se lisait sur le mur. Je ne pouvais pas regagner mon lit, ça m’était interdit par une force inconnue. J’ai traversé le palier, découvert mon père, assis, plus bas. Je voyais ses épaules voûtées, sa nuque. Je l’ai rejoint et me suis assis à côté de lui, écrasé par un poids qui venait je ne sais d’où.
Dès ces premiers mots qui ouvrent le récit, pour ceux qui le côtoient comme pour les nouveaux, tout Morgiève est là : la puissance de la langue, l’explosion au monde à partir du vide, ce sentiment de ne pas être, ni soi, ni personne. Le besoin de rassurer son existence dans les ombres d’un monde incertain, sans trop savoir où se mouvoir. Et l’amour, futile, fragile, celle d’un père, d’un ou d’une autre, qui brille au cœur de la solitude absolue d’être né.
De cette étincelle initiale, de cette arrivée au monde romanesque autant qu’à la vie, naitra donc, nous l’avons dit, un bouleversant Bildungsroman qui contera l’intimité d’un enfant, puis d’un jeune homme et enfin d’un jeune adulte, son rapport à ses frères, entre violence et amour, son évolution sentimentale, sexuelle et par lui, la France des années 60 à aujourd’hui), son rapport à ce père souillé (il est revenu des camps avec une maladie handicapante), à son plus grand amour aussi, une mère qui plane sur l’ensemble du texte comme une ombre menaçant de le dévorer tout entier, même et surtout lorsqu’elle est absente, mais dont tous recherchent l’amour, même dans la colère.
Jacques, très vite, tombera malade. Une faiblesse, comme son père. Il en portera la trace, comme la judéité du père. Il aimera une jeune juive, se convertira par amour. Il fuira, un instant, aux USA. Il voudra devenir père. Il poursuivra sa vie, enterrera des frères et des parents. Il cherchera sa place.
Comment est-ce que l’on se construit au milieu de cela ? Comment faire d’un amour qu’on sent ne jamais pouvoir se déployer ? Comment est-ce que l’on peut même espérer devenir adulte, si tant est que ce mot dit quelque chose ? comment faire avec ce dont on hérite, même quand il s’agit de l’absence ou de la souillure ? Comment peut-on dire adieu à soi, sa maison, pour vivre, enfin, un peu, et être soi, quitte à disparaitre ?
« La fête des mères » est un roman des limons de l’origine, récit de l’autopsie d’amours absolus (la mère, le père, les frères), mais un roman de mue, où la rage initiale fait peu à peu place à la vie : comment on devient homme, même imparfait, et, qui sait, père possible ou impossible père à son tour. Histoire de cristallisation progressive d’un « je ».
- Vers la tendresse.
Que l’impressionnante densité thématique déroulée ici n’effraye pas le lecteur.
Le tour de force de Morgiève est justement de traverser chacun de ces versants avec une simplicité et une maestria absolue, dans une langue à la fois vive et légère, moderne et classique, sans jamais laisser place à l’ennui (si on osait, on dirait presque que c’est un page turner, ou un page Turner, vu sa mélancolie).
Mimant la ductilité de son héros qui ne cesse de lutter contre le limon, le roman surprend à chaque chapitre en se réinventant comme son personnage, tour à tour rieur, dramatique, halluciné ou d’une noirceur absolue, glauque ou lumineux (souvent lumineux, étonnamment, Morgiève croit profondément en la lumière), offrant des détours incroyables comme lors d’une fugue aux Etats-Unis (devenant durant un chapitre un pur road movie), abordant les limites du conte et du fantastique avec le personnage de Roch Dambert, quand il ne navigue pas plus régulièrement sur les rives des très grands naturalistes comme Flaubert ou Maupassant, le rendant d’une fluidité impressionnante et pour ainsi dire difficile à lâcher.
On songe bien sûr aussi forcément à Bazin (même si la mère est bien plus séduisante qu’une Folcoche), Mauriac, l’Antoine Doinel de Truffaut ou plus directement au Louis Malle du Souffle au cœur, quand ne surgit pas de lointains echos du chef d’œuvre de Calafarte, « Requiem des innocents ».
« — Oui, papa.Je comprenais comme le fils comprend le père, pas très bien. »
Mais comme toujours, chez Morgiève, ce qui reste, ce sont des images, d’une force ahurissante, dans leur métonymie comme leur explosion : un simple miroir réglé volontairement trop haut (pour que les enfants ne puissent pas se voir et s’admirer), une omelette partagée dans le creux de la nuit qui deviendra plus tard la raison d’une rupture, un parking désert, une tache de vin sur un visage, un paquet de cigarettes partagé entre frères ou une mère qui gifle un médecin, digne et belle, tandis qu’un célèbre acteur francais ne cesse de passer en bas de la rue, une canne à pêche ou une auberge pour se cacher, un voyage en Afrique, l’homosexualité d’un frère, la disparition d’une fratrie, un coupe papier sur un bureau, une canne à pêche, un téléphone qui sonne pour un drame, le parfum d’une mère, sa robe et sa voiture, une…
- Se souvenir
« Arrivé à l’étage des mousquetaires, j’ai hésité, puis j’ai poussé la porte de sa chambre, elle était vide. Il ne restait plus rien de lui, j’ai ouvert la fenêtre pour respirer, sinon je me serais évanoui. Je voulais un souvenir… Je ne l’aurais pas. C’était si cruel que je ne parvenais pas à me faire à cette idée. »
On se gardera bien ici d’aller plus loin que ces images, tant la traversée de ce grand livre humble et tendre bouleverse et mérite d’être éprouvée dans ses mutations successives. Mais des images et des souvenirs, réels ou fantasmés : on se plait parfois à rêver que c’est le projet secret de ce roman qui traverse une vie, mais qui semble en écrire deux.
Dans son déroulé, en premier lieu, où tout semble fonctionner de manière double ou duelle, que ça soit sous forme d’annonce et paiement, échos visuels (le fœtus/le haricot) ou thématiques (la pisse/le sang), corolles multiples avec au sommet l’unique mère quietesauxcieuxquetonnomsoitsanctifié et tout en bas le père en un enfer qui lui ne cesse jamais de se dédoubler (la souille double, mentale et physique avec l’urine, la double vie, le réel et les camps, etc), et dont les déploiements semblent contaminer jusqu’aux noms, comme ce frère nommé pierre-Henri qu’on appelle tour à tour Pierre ou Henri.
« — Ce n’est pas lui, ai-je bafouillé… Ce n’est pas lui !
Je riais. M. Rakoto a refermé le couvercle, il riait lui aussi.
— Vous êtes sûr ? a insisté l’adjudant.
— Mon frère était tatoué au-dessus du sein.
J’étais tellement heureux, tellement. M. Rakoto nous a servi deux doigts de Pastis, la lumière s’est éteinte. J’ai liquidé mon Pastis. M. Rakoto a juré, il a parlé en je ne sais quelle langue, a traduit pour moi : « C’est le singe. Il n’en fait qu’à sa tête. » Les singes… On a quitté la pièce. La foule nous attendait, bizarrement silencieuse, l’adjudant a déclaré fort que ce n’était pas lui.
— C’est un autre, a-t-il précisé.
— Un autre ? ont répété en chœur plusieurs femmes, comme si c’était un refrain. »
Mais cette double partition d’incertitude est, à un niveau plus vastes, l’un des rouages de l’œuvre en train de s’écrire. On le sait (et on se permet avec pudeur de le rappeler ici, puisque l’auteur lui-même en parle), Richard Morgiève a perdu, dans son enfance, ses deux parents, sa mère d’un cancer alors qu’il n’avait que 7 ans, et son père, suicidé alors que Richard atteignait l’âge de 13 ans.
« Je ne suis pas mort », si j’avais écrit, ç’aurait pu être un titre pour une autobiographie.
Cette note bleue et profonde n’est pas l’unique clef du roman, qui peut magnifiquement se lire sans cela, mais on ne peut qu’y détecter une déchirante dualité : celui qui avait trop d’histoire parentale, celui qui n’en avait pas. Qui raconte et qui est raconté ? Qui est véritablement le « je » qui se construit tout au long de ces centaines de pages et cherche à vivre ?
Le passé était encore là mais pour combien de temps ?
Et, nous le disions, le roman a connu une première vie, sous le nom, déjà, de « La fête des mères ». Mais Morgiève l’avait signé Bauchot. Vertige du sujet. On ne saura jamais, au fond, ce qui est de Bauchot, ce qui est de Morgiève. « Vérifier si j’étais moi » disait avec malice l’incipit. Tant pis, tant mieux : « Je souffrais d’être vivant, mais il fallait des vivants pour fêter les morts. Je leur ai parlé ».
- Nos souvenirs. Nos célébrations.
On laissera ici nos possibles exégèses qui ne feraient que salir la force d’un récit si facile à aimer sans eux, et il nous faut, à présent que tout a été dit, trop mal, trop injustement, dans le désordre, tant ce livre mériterait plus, faire une confession.
A la manière du silence qui nous a accompagné presque une année lors de la lecture de son précédent ouvrage avant d’oser écrire dessus, la lecture de « La fête des mères » date à présent de près de trois mois, sous la chaleur accablante de l’été.
Mais il ne faudrait pas prendre ce silence pour un aveu de culpabilité ou un manque d’intérêt : il n’existe pas un jour, pas un instant où ne se réactualise depuis lors au présent ses êtres, ses scènes, ses images, à la faveur d’un élément de vie ou d’un echo d’image, de gestes. « La fête des mères » un livre qui ne cesse de grandir, semaines après semaines. De devenir souvenir. Et, derrière tous ces mots, c’est peut-être avec humilité le plus beau et le plus simple des compliments que nous pouvons lui faire : grâce à Morgiève, Bauchot existe. Il est. Et grâce à « La fête des mères », dans ce bel espace que l’on appelle le roman ou la mémoire, Richard et Jacques demeurent. Chef d’œuvre.
« L’amour, que l’amour, nos yeux, ma vie et la tienne… Nos souffles et nos rêves, nos beaux espoirs, l’amour, que l’amour. Il n’y a pas d’éternité pour l’amour mais des romans pour le raconter. »
Editions Joelle Losfeld, 432 pages, 22 euros. En librairie.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).













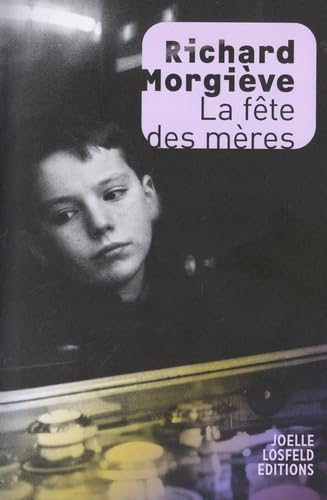

Morgiève
Je voudrais, s’il vous plaît, l’adresse mail de Jean-Nicolas Schoeser.
RM