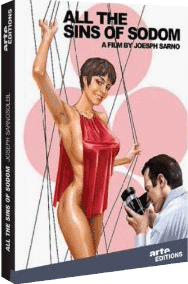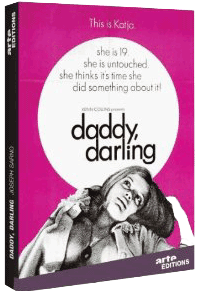L’évolution de l’érotisme dans le cinéma de Joseph Sarno a de quoi surprendre tant ses choix esthétiques semblent quasiment se contredire, entre ses œuvres du début des années 60 et celles de la fin des années 70, suivies par son immersion dans le X, comme émergeant de deux modes d’expression et d’inspiration différentes. Sarno devant s’adapter aux lois du marché, le réalisateur de All the sins of sodom n’est pas le même que celui Abigail Leslie is back in town, offrant un cinéma mouvant, évoluant vers de nouveaux horizons. Ses premières œuvres rappellent en cela celles d’autres « débutant », comme un Borowczyck avec Goto L’ïle d’amour ou Metzger avec Dirty Girls. Mais si ces cinéastes déjà fascinés par la femme vont s’affirmer très rapidement comme de véritables auteurs aux multiples références littéraires et picturales, poursuivant l’intellectualisation du corps, la recherche de l’abstraction, le cadrage élaboré et une certaine poétisation de la chair, Sarno reste un cinéaste définitivement populaire. Contraint à aller dans le sens du vent – comprendre qu’avec l’émergence de la pornographie l’érotisme n’intéresse plus les producteurs – le tournant radical l’entraine vers une matière toujours plus brute, crue, froide, ancrée dans le réel, inaugurée avec Abigail Leslie is back in town pour déboucher ensuite sur le hardcore. Avec Daddy, Darling et All the sins of sodom, le cinéma érotique est encore un champ d’expérimentation qui, s’il s’attache déjà aux dérèglements sociaux, aux éclatements de cellules familiales ou communautaires, reste avant tout préoccupé par la forme et l’expression d’un Art érotique qui fait dans la sugestion, la sensualité, dans des tonalités très arty, proche de l’univers de la photographie.

On ne sera donc pas étonné qu’All the sins of Sodom prenne comme arrière plan le milieu de la mode et du nu artistique à travers l’aventure de Jenning, photographe ambitieux plongeant tête la première dans le piège tendu par la mystérieuse Joyce au charme quasi surnaturel, cette inconnue qui s’installe chez lui du jour au lendemain et opère progressivement une fascination hypnotique sur lui. Avec son unité de lieu, qui enferme son protagoniste dans son appartement et studio qui voient défiler ses modèles et maitresses pour mieux confondre vie et œuvre ; All The Sins of Sodom s’apparente à un huis-clos. Difficile de ne pas identifier le regard du photographe face au plaisir féminin, à son avidité à saisir l’instant précis en elle qui les immortalisera sur la photo à celui de Sarno lui-même, recherchant lui-même à retranscrire une même alchimie. Sarno aime à créer des personnages de femmes dominantes et les mettre en contraste avec une autre héroïne plus douce, plus victimisée, situations propice au schéma triangulaire (cf Abigail Leslie) auquel obéit parfaitement le trio Henning, Joyce, Leslie. Si Sarno, choisit exceptionnellement un héros, c’est pour mieux mettre en place une fable morale dans laquelle la femme sera une nouvelle fois victorieuse, et s’attaquer aux tares masculines, aux dangers des rêves d’ascension, aux pièges de la séduction et à la chute abrupte qui en résulte. C’est non sans ironie que Joe Sarno manie des citations bibliques avec en filigrane la destruction de la cité pécheresse de Sodome et l’identification de Joyce à une nouvelle Lilith, même si le symbolisme, répétitif, manque de subtilité.

All the sins of sodom doit moins à son sujet ou une prétendue finesse psychologique qu’à la qualité de sa mise en scène et une direction artistique beaucoup plus proche du cinéma indépendant US de l’époque que du pur cinéma d’exploitation. Même s’il serait exagéré de pousser trop loin la comparaison, réalisé la même année que Faces, All the sins of Sodom, partage avec le cinéma de Cassavetes un grain de photo tout à fait particulier, une approche quasi documentaire, la prise de son direct, et cette façon de filmer près de la peau. Ne cessant de jouer sur les contrastes, filmant la beauté des corps enlacés, il capte la montée du désir dans des séquences photos d’anthologie glissant progressivement vers l’acte amoureux, que vient sublimer cette omniprésence du fond blanc. Le Radley Metzger de Thérèse et Isabelle n’est pas loin.
Ode au corps féminin et à la peau, particulièrement sensoriel, All the sins of Sodom capte l’émotion, la fièvre et la fébrilité de la peau dans un noir et blanc hypnotique. Qu’il s’agisse d’une saisissante séquence d’onanisme dans l’obscurité ou les mises en scènes saphiques pendant lesquelles Jenning demande à Joyce de se carresser pour pouvoir capter l’étincelle extatique sur son visage – ce qui n’est pas sans rappeler, par cette mise en abime de l’Art par l’entremise d’un héros, l’obsession de Brisseau pour la montée du plaisir féminin dans Choses secrètes ou Les Anges exterminateurs. Aussi provocateur dans ses thèmes qu’elliptique dans leur représentation All the sins of Sodom n’en est que plus stimulant. Ici, l’érotisme de Sarno n’aura peut-être jamais été aussi … érotique.

Des Etats-Unis, passons à la Suède et à Katja l’héroïne de Daddy, Darling voyant sa vie voler en éclats le jour où elle apprend que son papa chéri va se remarier, bousculant ainsi l’équilibre installé de ce duo père/fille. Chez Sarno, entre le roman photo et l’étude sociologique il n’y a qu’un pas que Daddy, Darling franchit allégrement, naviguant du début à la fin de la bluette à la subversion, de l’intrigue à l’eau de rose à l’attaque en règle du poids des conventions et du confort bourgeois. Katja vit seule avec son père veuf auquel elle voue une admiration névrotique, dans une sorte de vie idéale, un cocon familial. La nouvelle de l’arrivée d’une belle mère résonne en elle comme une trahison, une infidélité. Elle se lance alors dans une escalade, entre désir de provocation et nécessité de se chercher. Daddy, Darling – et c’est peut-être son aspect le plus curieux – suscite des sentiments contradictoires, un va-et-vient permanent entre la conviction que ce drame intérieur n’est qu’un prétexte opportuniste à servir les archétypes du cinéma d’exploitation (le remariage du père peut-il susciter un tel cataclysme au sein d’une jeune femme, est-ce bien raisonnable ? ) et une réelle empathie vis-à-vis de sa protagoniste. Sarno manie l’ironie derrière son sérieux imperturbable. Il prend plaisir à faire éclater la cellule familiale de ce petit pavillon cossu, si sécuritaire, si idéale, pour mieux faire émerger la vérité derrière les apparences. Katja, entre nymphomanie vengeresse et naïveté, découvre l’amour saphique, séduit sa belle mère et pense à son père quand elle couche avec un autre homme…

Le film de Sarno a beau être très soft niveau érotisme, il provoque le trouble par son climat incestueux sous jacent au point qu’on se demande parfois si une telle « passion » – véritable complexe d’Œdipe au féminin – n’est pas née d’un trauma plus profond. Joseph Sarno se jette donc la tête la première dans les interdits et n’hésite pas à les représenter – même en pur fantasme. A ce titre les scènes érotiques portées par la beauté juvénile d’Elle Louise (qui ressemble à s’y méprendre à la Virna Lisi des années 70) s’apparentent à des chorégraphies animales, dans la sensualité des chairs orangées, baignées dans une photo qui tient à la fois de la pénombre et du coucher de soleil, et soutenues par des rythmes tribaux pulsionnels. Daddy, Darling est un beau film érotique sentimental, qui, derrière l’éveil sensuel et sexuel de son héroïne enferme de manière insoupçonnée le charme vénéneux de la transgression.
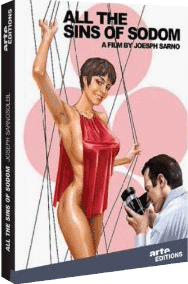
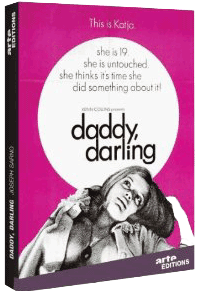
Les suppléments présentés par Arte, constitués essentiellement d’entretiens avec Joe Sarno, accompagné de sa femme (et actrice dans plusieurs de ses films) Peggy sur le dvd All the sins of sodom, sont des annexes indispensables aux œuvres et permettent de saisir le parcours de ce cinéaste soumis pendant toute sa carrière aux fluctuations du marché, mais cherchant à imposer jusqu’au bout sa propre vision. Il est en effet passionnant de l’entendre avouer qu’il est passé un peu par hasard du cinéma industriel au cinéma érotique, lorsqu’un ami lui a proposé de déshabiller ses inspirations, avant que les commandes ne s’enchainent. Il explique également comment après la sortie de Gorge Profonde il fut contraint de s’adapter et de passer – à contrecoeur – au porno, tout en tentant de maintenir malgré tout sa propre perception du sexe. On a la facheuse tendance à identifier l’Art à l’expression intime du créateur, en éludant toutes les contraintes auxquelles il doit faire face. Les exigences d’un auteur libre et d’un cinéaste employé d’un système, prisonnier du mécanisme commercial et devant honorer un contrat ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi l’œuvre de Sarno est si singulière, dans sa propension à dépasser les conventions exigées pour livrer encore un regard unique, facilement identifiable d’un film à l’autre. Le cinéaste se définissait lui-même comme un honnête artisan qui savait faire de l’érotisme puis du X et qui le faisait bien, en donnant, il l’espère, une tonalité toute particulière à ses œuvres.
Très émouvants sont les aveux de Peggy Sarno évoquant un Joe W.Sarno dans les années 70 guettant les véritables soupirs de plaisirs de ses actrices, lors d’orgasmes prétendument non simulés, plutôt que d’avoir les halètements habituels et surjoués du cinéma érotique usuel. L’obsession du plaisir lu sur le visage féminin vient se confirmer lorsqu’elle déclare que même dans un film pornographique Sarno préférait capter l’orgasme féminin non pas dans le gros plan d’un vagin mais dans la fragilité d’un regard. Et Sarno, lui même de conclure : « Même quand je tourne quelque chose de vraiment obscène, je rends quand même ça beau ».
All the sins of Sodom (Joe W. Sarno, USA, 1968) avec Maria Lease, Sue Akers, Peggy SteffansDaddy, darling (Joe W. Sarno, USA-Suède, 1970) avec Elle Louise, Gio Petrè, Ole Wisborg
Dvds édités par Arte
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).