On se rend au Arras Film Festival comme on retourne en villégiature. Excepté que la belle saison est ici remplacée par les premiers frimas et que la beauté des paysages sera flamande jusqu’au bout des toits. On est dans le Nord ou on ne l’est pas : la chaleur sera dans les coeurs, dans le plaisir communicatif d’un staff dévoué, dans les moments de partage saisis au village du festival. Dans les salles, on passe par toutes les émotions. La Compétition européenne s’était emparée cette année de sujets douloureux, qu’ils soient intimes, historiques, sociétaux. Les moments de lumière n’en eurent que plus d’éclat, de nécessité. Entre déceptions et coups de coeur, voici un tour d’horizon des neuf films qui nous furent proposés.
 Duelles (Belgique, 2018, 1h37) de Olivier Masset-Depasse
Duelles (Belgique, 2018, 1h37) de Olivier Masset-Depasse
Qu’on se le dise, il ne suffit malheureusement pas de se dire hitchcockien pour l’être et Duelles en est une démonstration criante. Dès la mise en place rétro du décor – nous sommes dans la Belgique des années 60 avec les jolis habits d’époque, la voiture et les coiffures qui vont avec… – on pressent que rien ne va fonctionner. Tout est tellement exposé, disposé soigneusement dans la norme du quotidien historique vintage que le spectateur en est presque gêné. Même la pelouse sent la nostalgie. La comparaison avec ce que Todd Haynes faisait du mélodrame des années 50 dans Carol ou Loin du Paradis est sans appel.
Se dire hitchcockien, juste parce que l’on prend parti de disséminer l’ombre du doute pendant 1h45, c’est oublier combien le cinéaste britannique était avant tout un merveilleux styliste. Or, ce qui manque surtout au film d’Olivier Masset-Depasse, c’est justement le style, une forme, une identité qui le fasse sortir de cette sensation de téléfilm luxueux qui défile sous nos yeux. Pour un film à suspense, l’absence de rythme qui provoque une indifférence pour l’enjeu narratif est pour le moins embarrassante. Pourtant, avec un peu moins d’académisme, l’intrigue (inspirée par le roman Derrière la haine de Barbara Abel) était attirante. Dans le Bruxelles des années 60 Céline et Alice, les meilleures amies du monde sont aussi les meilleures voisines, habitant dans une petite zone pavillonnaire très calme. Jusqu’au jour où le fils de Céline se tue en tombant par la fenêtre, avant qu’Alice paniquée ne parvienne à trouver sa mère. Dès lors, Alice est persuadée que Céline la tient pour responsable d’avoir fait preuve d’imprudence et laissé tomber son petit garçon et qu’elle veut se venger en faisant subir le même sort à son bambin à elle. Fantasme ou réalité ? On finit par s’en moquer un peu, à vrai dire, car dès lors Olivier Masset-Depasse déroule laborieusement les fils de son thriller paranoïaque en enfilant les archétypes du type « jeune fille recherche appartement », en tombant joyeusement dans les pièges tendus. Nulle audace formelle, nulle recherche visuelle, une esthétique convenue et fade domine le tout, avec une omniprésente musique « lourde de signification » : la menace est tellement partout qu’elle n’a plus d’impact. Gros plans sur les regards méfiants ou les yeux menaçants, expressions suggérant la folie : les effets sont tellement grossiers que peu importe que ce soit l’une ou l’autre qui soit folle pourvu que ça finisse et vite. Comme s’il ne faisait pas confiance à son propre film, il surligne, ajoute des flash-backs explicatifs pour revenir à une scène précédente, au cas où on n’aurait pas repéré les détails (ah ah vous n’aviez pas remarqué que ce thé pouvait être empoisonné la première fois ? Je vous remontre la cuillère en plus gros plan). Le thriller aurait pu être fascinant, troublant, dérangeant, il ne suscite que l’ennui. A croire que le cinéaste aura réussi à nous glisser un somnifère dans notre tasse. (O.R.)
 Jumpman (Podbrocy, Russie, 2018, 1h27, vostf) de Ivan I. Tverdovsky
Jumpman (Podbrocy, Russie, 2018, 1h27, vostf) de Ivan I. Tverdovsky
Le film du russe Ivan Ivanovitch Tverdovski aura suscité attachement et agacement. On reste donc un peu trop partagés pour sauter à pieds joints dans l’enthousiasme qui gagna le jury lorsqu’il remit l’Atlas d’Or à ce film. Porté par une très belle ouverture, contenant juste ce qu’il faut de mystère et d’émotion, Jumpman laisse pourtant l’impression d’être passé à côté de son sujet. Denis, un adolescent abandonné par sa mère à sa naissance, souffre d’une maladie grave et rare : l’analgésie congénitale. Autrement dit, il est incapable de ressentir la douleur. Sa mère n’ayant pas obtenu l’autorisation de le reprendre avec lui, ils quittent tous deux l’orphelinat dans l’illégalité (et sans qu’ils n’en soient jamais inquiétés). Mais la particularité et la naïveté de Denis l’amènent à être utilisé comme piéton supposément accidenté dans le cadre d’un vaste réseau de chantage. Si le personnage principal se révèle particulièrement attachant et sincère, cela ne suffit pas à compenser le manque d’écriture de l’ensemble des protagonistes, tombant même parfois dans la caricature, à l’image de ces scènes d’audience se déroulant dans un véritable tribunal de l’absurde, théâtre de vendus faisant la fête ensemble le soir et le jour envoyant en prison les innocentes victimes de leur machination. En étant ainsi outrée, exagérée, la caricature de la Russie et la dénonciation des institutions (justice, police, hôpital) manque son but, en plus de suivre une mécanique répétitive lassante. De même la relation mère-fils souffre de quelques clichés (quand elle ne tombe pas dans le malaise), alors qu’on aurait voulu la voir constituer un des cœurs du film. La lumière n’est nulle part, mais si le propos est respectable, l’exagération de la noirceur ne sert pas le film. Tout se résume aux magouilles, coups bas et vexations, de manière si forcée que le sort de Denis, finalement, nous importe sans nous emporter, sans compter que sa maladie demeure plus un outil qu’un tremplin vers une réflexion plus profonde. De là le caractère précieux d’une jolie photographie parfois vaporeuse, de quelques belles scènes fuyant le côté un peu tape-à-l’œil du reste de la mise en scène, et de cette fin en forme de retour au commencement, où Denis n’est plus méprisé, mais quelque part reconnu, et où son absence de souffrance n’est plus utilisée à des fins malveillantes mais sous forme de jeu, de défi (étrange et quelque peu malsain, mais ce sont autant de questions que le film ne traitera pas). Si la frustration de ne pas l’avoir plus rencontré demeure, au moins son regard plein de pureté nous aura-t-il happés. (A.J.)
 Winter Flies (Zimske muhe, Rép. Tchèque, 2018, 1h25) de Olmo Omerzu
Winter Flies (Zimske muhe, Rép. Tchèque, 2018, 1h25) de Olmo Omerzu
Portrait sensible de la jeunesse tchèque, Winter Flies suit deux jeunes amis, Hedus, 12 ans et Mara, 14 ans, qui après avoir volé une voiture, traversent le pays pour fuir leur ville natale. Des raisons qui les motivent, nous n’en saurons rien. Le film ne s’embarrasse pas de fioritures psychologiques et prend ses héros au vol, mais – comme les deux gamins – trace sa route et s’évertue surtout à saisir l’état d’esprit d’une jeunesse qui veut continuer de rêver dans un monde qui n’a plus grand-chose à lui offrir. Pas de superflu donc mais une mise en scène épurée qui fait la part belle aux comédiens et à la campagne tchèque, brumeuse et mélancolique.
Road movie par son trajet, Winter Flies est surtout une douce chronique sur l’amitié, sur le besoin de s’évader et de chercher sa folie, sa route, sa liberté.
Avec un budget restreint, le réalisateur embarque son spectateur dans la voiture de protagonistes attachants. Le duo d’acteurs constitue le cœur névralgique du film, ils sont touchants de simplicité et de naïveté. Ils sont le reflet d’une jeunesse perdue qui rêve de devenir adulte, de rencontrer des filles, de faire l’amour, de vivre des aventures, de conduire tout en hurlant son envie de rester jeunes, de ne pas être responsables et de pouvoir s’amuser sans se soucier du lendemain.
Ils rencontrent une belle inconnue sur laquelle ils fantasment plus que de raison avant de rêver de la France et des femmes françaises. Mais leurs pérégrinations se termineront inéluctablement chez les flics. Intelligemment, le film alterne scènes de voyage et scènes d’interrogatoire au commissariat et donne alors un contrepoint amusant entre les faits et la perception de l’adolescent.
L’art de Olmo Omerzu est funambule, c’est un art de l’équilibre : celui de trouver la justesse entre la nostalgie et la légèreté, l’insouciance et la maturité, entre la sobriété et quelques fondus enchaînés amusants. Le réalisme brut n’empêche pas l’onirisme magique de s’installer. Parfois le temps paraît suspendu, arrêté sur la vue du monde animal, de hérissons se promenant dans la nuit, venant rappeler la beauté et la poésie du monde. Lorsque le conducteur s’endort paisiblement en voiture, chacun craint que la séquence ne tourne au drame, mais elle se poursuit de manière féerique, et s’achève dans le calme du petit matin.
Il y a dans le film une légèreté salutaire et beaucoup d’humilité. Pas d’esprit de sérieux mais un regard amoureux et une caméra qui caresse les personnages. Le cinéaste prend de la hauteur, du recul et les filme avec sensibilité et tendresse.
Tout cela donne un film précieux et subtil, une fable savoureuse sur le besoin qu’ont les hommes et les femmes de se raconter des histoires, de se mettre en scène, de vivre leurs folies jusqu’au bout. De se sentir vivant, surtout. On se croirait presque revenu au temps du cinéma tchèque des années 60, avec cet art inégalé d’immerger en une seule image dans l’amertume et la drôlerie. Une splendide échappée. (J.R.)
 Take it or leave it (Vota voi jata, Estonie, 2017, 1h42) de Liina Trishkina-Vanhatalo
Take it or leave it (Vota voi jata, Estonie, 2017, 1h42) de Liina Trishkina-Vanhatalo
On a tellement l’habitude des beaux portraits masculins de la féminité, que lorsque c’est une cinéaste qui se lance dans un magnifique portrait d’homme en partie défait de ses atours virils, le projet paraît presque inédit … et le résultat trouble. La réalisatrice estonienne Liina Trishkina-Vanhatalo suit les pas d’Erik, un ouvrier de 30 ans qui du jour au lendemain découvre qu’il est père : Moonika, qui l’a quitté depuis plusieurs mois, le recontacte et lui demande de venir la voir à l’hôpital. Elle vient d’avoir une petite fille. Et n’en veut pas. Dès lors, Take it or leave it va décrire le cheminement intérieur d’un adulte encore très adolescent et immature vers la responsabilité parentale et l’amour pour son enfant. Quoi qu’on en dise, il est rare que le cinéma fasse un tel hommage à cette forme d’héroïsme, tant le malheur est réservé la plupart du temps aux filles-mères abandonnées, aux femmes maltraitées par la vie ou les machos, devant faire face aux rouages du destin. Ici, Take it or leave it peut se décrire comme un récit d’apprentissage alors que chacun croit Erik incapable de faire face et d’assumer son rôle, lui répétant « qu’un père, c’est bien, mais une maman, indispensable ». Liina Trishkina-Vanhatalo s’empare de son sujet avec une subtilité surprenante qui ne cède pas au pathos. Son regard se fait finement observateur. Nous suivons avec émotion l’apprentissage maladroit d’Erik avec Maï, attendris, émus par la beauté des gestes. Elle réussit à capter l’émotion, les regards et babillements de la petite fille sans mièvrerie ni cliché. Le contexte social est bien là, la difficulté d’élever un enfant en étant dans la précarité, ou l’impossibilité pour l’homme qui ne travaille que de ses mains de trouver un travail adéquat lorsqu’on a un bébé sur les bras, mais la cinéaste, plutôt que d’insister sur l’écrasement du réel, opte pour la luminosité. Peut-être pourra-t-on juste émettre une réserve sur une dernière partie « coup de théâtre » qui ajoute une tension supplémentaire un peu plus archétypique, bien que crédible, qui casse un peu le ton du film. On s’étonnera à peine de voir la mère de Maï s’appeler Moonika, hommage évident au Monika de Bergman. L’héroïne du cinéaste suédois, jouée par Harriet Andersson, incapable d’assumer son rôle de mère, abandonnait son enfant au jeune père. Take it or leave it commence en quelque sorte là où Monika s’arrêtait. (O.R.)
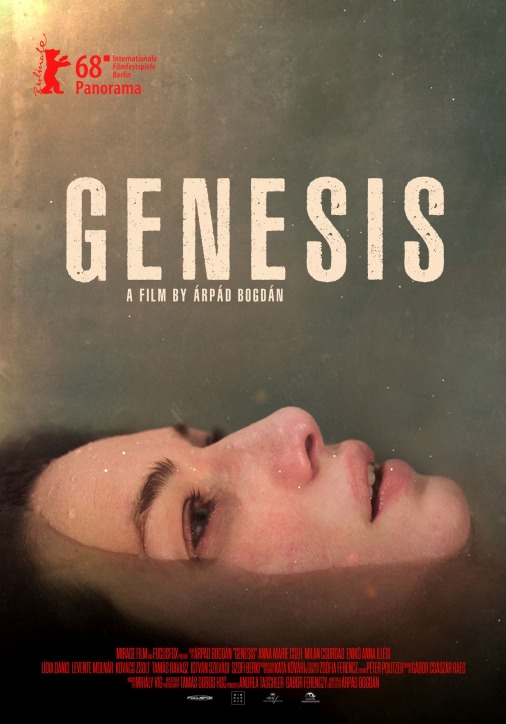 Genesis (Hongrie, 2018, 2h) de Arpad Bogdan
Genesis (Hongrie, 2018, 2h) de Arpad Bogdan
Le hongrois Arpad Bogdan a choisi lui aussi d’entrecroiser plusieurs histoires, mais il eut le bon sens de les limiter au nombre de trois, et de les traiter une à une, les trois segments formant un tout baptisé Genesis. Plus exactement, il suit plusieurs personnages tous liés par la même histoire. C’est Risci, un garçon rom de neuf ans, qui sera le point de départ, le plus meurtri par les faits sur lesquels se base le film. Tandis que son père est en prison et apprend qu’il purgera encore sa peine pendant deux ans (pour une raison disproportionnée que nous découvrirons plus tard), sa mère continue de lui prodiguer amour et bienveillance. Mais une nuit leur village est la proie d’une attaque raciste. Risci échappe aux flammes mais perd sa mère dans le drame. On le retrouvera à la fin du film, après avoir également croisé la route de Virak, une adolescente pensant connaître l’un des coupables, et Hanna, jeune avocate chargée de le défendre. Le ton du film est plutôt sec, Arpad Bogdan ne s’embarrassant pas de fioritures, collant au plus brut au réalisme, cadrant ses personnages de près et prenant son temps pour saisir les émotions que les mots ne sauraient décrire. De là une absence générale de pathos (on relèvera juste une ou deux scènes en trop) en dépit de la gravité des thèmes et des difficultés rencontrées par les personnages. Si le récit, dès le départ fort, ne tient pas complètement la distance (la dernière partie n’a pas la rigueur de celle consacrée au petit garçon), on obtient un film suffisamment plein pour le considérer comme une louable tentative. Dans l’ensemble rugueux, il sait aussi s’échapper grâce à des moments d’immersion (littérale, l’eau semblant accompagner les personnages dans leur introspection) qui touchent plus à l’intime. Mais au final le film s’inscrit bel et bien dans la société dans laquelle il vit, en s’emparant du sujet douloureux du racisme envers les tziganes. Ni véritable héros, ni complètement martyre, Risci offre un regard douloureux, d’enfant, sur un monde incompréhensible. Aujourd’hui, à quelques pas de chez nous. Une tranche de vie délicate pour un film imparfait, mais concerné. (A.J.)
 The most beautiful couple (Das schönste Paar, Allemagne, 2018, 1h37) de Sven Taddicken
The most beautiful couple (Das schönste Paar, Allemagne, 2018, 1h37) de Sven Taddicken
Entremêlant tensions cérébrales et enjeux du film à suspense, The most beautiful couple est un thriller psychologique qui saisit le spectateur dés la première image et ne le lâche plus pendant plus d’une heure et demie.
Le film s’ouvre sur une magnifique scène : dans le noir, on entend tout d’abord des gémissements de jouissance, des chuchotements de plaisir. Ensuite vient l’image et avec elle la mer, le ciel bleu, une petit crique sur laquelle un jeune couple fait l’amour. Le couple allemand, en vacances à Majorque, prend du bon temps, les corps exultent. Cette image d’épinal, belle, pure et innocente -on dirait Adam et Eve dans le jardin d’Eden- , tranche radicalement avec la scène suivante et l’horreur qui va saisir le couple, victime d’une agression abjecte et odieuse. Battus par trois gamins qui violent la femme sous les yeux du mari, le couple ne sera plus jamais le même et va être solidement mis à l’épreuve tout le long du film.
Le réalisateur se penche surtout sur les conséquences d’une agression. Que faire, comment avancer, comment continuer à s’aimer, à faire l’amour dans une situation post-traumatique ?
Doit-on se venger, oublier, pardonner? The most beautiful couple pose des questions vitales et s’intéresse à la reconstruction du couple qui tente de rester debout après une telle horreur.
Il questionne également les instincts grégaire de l’homme, son besoin de domination car si la femme décide d’aller de l’avant, l’homme ne peut se résoudre à oublier et est incapable d’accepter la situation. Lorsque qu’il rencontre par hasard son agresseur en Allemagne, c’est le début d’un dangereux jeu du chat et de la souris qui finira par confondre l’agresseur de l’agressé, le dominant du dominé.
Le trio d’acteurs est impeccable, ils sont tous les trois très justes. L’agresseur (Florian Bartholomai) est déroutant et malsain, le mari (Maximilian Bruckner) tout de violence contenue est très bon mais mention spéciale pour l’actrice (Luise Heyer), qui est magnifique. Elle mélange la grâce, la fragilité, le charme à une force sereine et rassurante, une rage froide et déterminée. Le film vaut déjà pour sa simple découverte.
The most beautiful couple n’est pas sans défauts : la dernière partie tourne un peu en rond et finit (malgré une excellente séquence finale) par sombrer dans les archétypes un peu moralisateurs auxquels le cinéaste avait pris le soin d’échapper auparavant. Il manque de la profondeur et de l’inventivité au scénario qui court après son sujet. Un peu trop conventionnelle et attendue par moments, la mise en scène est pourtant parcourue d’une réelle tension qu’elle parvient à rendre palpable et concrète pour son spectateur, en apnée durant tout le film. En plus d’une violence physique, le cinéaste travaille plus subtilement à une violence mentale et psychologique, renvoyant les interrogations à la face du spectateur et ne le laissant partir qu’après avoir été secoué par des questions morales pertinentes. Sven Taddicken crée une empathie particulière entre son public et ses personnages et joue habilement de l’effet cathartique du cinéma pour questionner les actes barbares et la violence de la société. (J.R.)
 The Eternal Road (Ikitie, Finlande, 2017, 1h43) de Antti-Jussi Annila
The Eternal Road (Ikitie, Finlande, 2017, 1h43) de Antti-Jussi Annila
Pour peu que l’on ne soit pas allergique aux fresques historiques lyriques, The Eternal Road est une vraie réussite du genre, évoquant le destin tragique de Jussi Ketala, accusé de communisme en Finlande et qui dut fuir dans les années 30 son pays et abandonner sa famille. Arrivé en Union Soviétique, on le prend d’abord pour un espion, avant de profiter de sa connaissance de la langue anglaise pour le forcer à espionner des immigrants américains venus bâtir le « paradis socialiste ». En retraçant l’odyssée dramatique de personnages réels, The Eternal Road évoque l’idée d’un héros de l’Histoire idéal, guidé par un sens moral et un pacifisme inébranlables. On pourrait reprocher au film d’être un panégyrique d’une figure exemplaire, mais ce serait peut-être faire preuve de cynisme et de misanthropie que de considérer que de tels hommes n’existent pas. Antti-Jussi Anmila avait déjà tourné en 2008 l’incroyable Sauna, injustement inédit en France, une des œuvres fantastiques les plus hantées et païennes des années 2000. Il confirme ici le souffle de sa mise en scène et du rythme et la manière dont il utilise pleinement l’espace proposé par ses paysages naturels. Comme c’était déjà le cas dans Sauna – mais avec ses terrifiantes étendues glacées – son esthétique renvoie régulièrement à celle du célèbre peintre finlandais Akseli Gallen-Kallela qui illustra tout autant les mythes fantastiques de la Carélie que les horizons finlandais, scènes villageoises et bucoliques. C’est peut-être dans les séquences les plus apaisées, la perception des moments suspendus qu’il s’en sort le mieux, filmant par exemple à merveille le regard d’une petite fille à la recherche d’un père ou quelques instants de joie populaire. Sans atteindre le génie de Cimino, on sent bien que le modèle du cinéaste est La Porte du paradis, pleurant lui aussi ces illusions écrasées une à une par le poids des iniquités. Il retranscrit ce lyrisme populaire entremêlé à cette irrémédiable tristesse et ce sentiment d’écœurement que provoque sur le spectateur le pouvoir totalitaire, le pouvoir du massacre. Le cinéaste dit avoir fondu en sanglots à la lecture du livre et avoir immédiatement désiré rendre hommage à cet homme hors du commun que fut Jussi Ketala. On pourra trouver son approche candide, elle est surtout d’une sincérité absolue. Pour comparer avec un autre avatar du genre, Spielberg dans La Liste Schindler sombrait beaucoup plus dans le pathos et la démonstration. Le cinéaste use moins d’effets faciles, mais le simple fait de raconter cette histoire bouleverse et révolte. Il évoque combien l’homme du peuple quels que soient sa force et son désir d’insoumission n’est qu’une marionnette de l’Histoire. Jussi, après avoir été persécuté comme communiste – qu’il n’a jamais été – devient l’objet utilisé par le communisme russe pour inventer des coupables et faire exterminer des innocents. The Eternal Road constitue en cela un beau témoignage de la perte ou plutôt du vol d’une identité, avec l’exil comme première mort. En entrant en Russie, on le mutile de son nom, on le mutile de son âme, on le tue, le forçant à renaître sous une autre forme. Pardonnons à The Eternal Road quelques écarts sentimentalistes tant il constitue un beau témoignage de la douleur immémoriale de l’individu ballotté par l’Histoire et des moyens d’y résister, d’y survivre. Et malgré la tragédie, malgré l’ignominie, même brisé, le héros garde jusqu’au bout cette énergie de vie. (O.R.)
 Panick attack (Atak paniki, Pologne, 2018, 1h40, vostf de Pawel Maslona)
Panick attack (Atak paniki, Pologne, 2018, 1h40, vostf de Pawel Maslona)
La proposition du polonais Pawel Maslona illustre parfaitement l’idée selon laquelle un concept original ne garantit pas un bon film. Se basant sur le phénomène psychologique qu’est l’attaque de panique, le réalisateur orchestre sa montée à l’intérieur de plusieurs personnages qui, pour diverses raisons (prise de drogue, accouchement inopiné, perte de repères, difficultés relationnelles), en arrivent à un point limite. Le problème est que l’on se fiche absolument de tout ce qui leur arrive. Le découpage n’aide certes pas à s’intéresser à eux. Ainsi on passe d’une séquence consacrée à l’un à une séquence consacrée à l’autre, la plupart du temps sans transition, au gré d’un montage cut refermant violemment une porte pour en ouvrir tout aussi brutalement une autre. On peut si l’on veut remettre les pièces du puzzle en place, mais en a-t-on seulement envie ? Ne virant ni dans le drame ni dans la comédie, Panick Attack déroule son fil sans jamais s’approcher de l’essence de l’angoisse. Si certaines situations recèlent une part d’intérêt (quelques personnages féminins se laissent suivre d’un œil), elles se retrouvent à la fois noyées dans un maelstrom et interrompues à cause du parti pris de montage du film. L’exercice de style est bien vain, et on voit venir à des kilomètres le climax final en forme de montage épileptique. Comme si cela n’était pas suffisant, un lien entre certains personnages ainsi qu’un brouillage des temporalités en rajoutent une couche dans l’inutilité et l’esbroufe. Car ces composantes ne servent absolument à rien (si ce n’est à nous faire réaliser que, tiens, untel prenant l’avion avec untel est l’ex de unetelle, héroïne d’un autre segment). C’est bien maigre, et un désagréable « Tout ça pour ça » nous étreint à la fin de la projection. Quant au malaise grandissant des personnages, il ne suscite qu’un peu de tension, au cas où nous aurions eu l’espoir d’au moins vivre une expérience intense ou haletante. À quand l’inscription de l’attaque d’ennui dans le DSM cinématographique ? (A.J.)
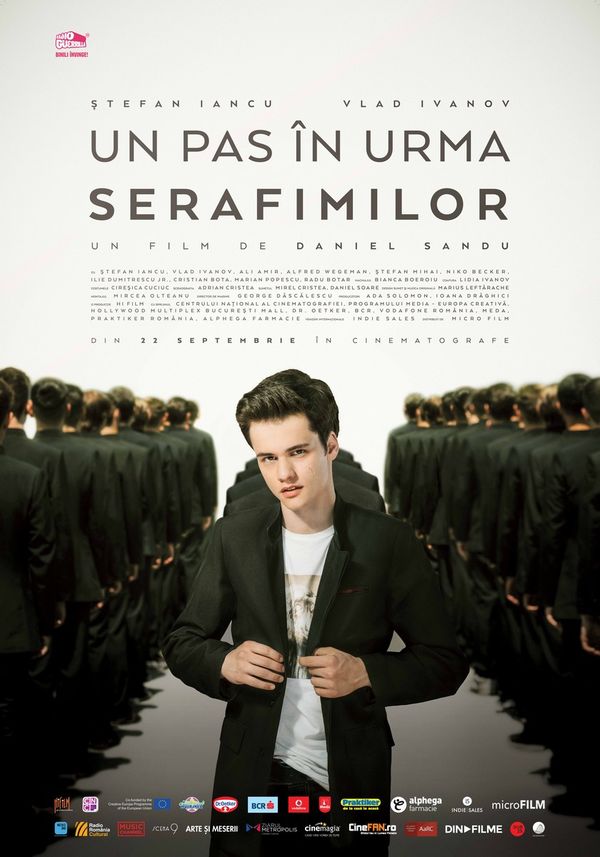 One step behind the Seraphim (Roumanie, 2017, 2h27) de Daniel Sandu
One step behind the Seraphim (Roumanie, 2017, 2h27) de Daniel Sandu
Le dernier film de notre programme s’est aussi avéré l’un des meilleurs. On savait qu’on allait voir un film sur un adolescent de quinze ans entrant au séminaire pour devenir prêtre, mais on ignorait à quel point ce voyage en Roumanie allait constituer un superbe récit d’apprentissage. C’est là la force du film, qui lui fut par ailleurs reprochée de-ci de-là : ne pas interroger, malgré le contexte, la foi et le rapport à la religion, mais l’appréhension par un adolescent d’un nouvel univers. L’intrigue aurait quasiment pu se dérouler dans n’importe quel autre type d’école, ce qui importe, c’est la manière dont un jeune découvre l’envers d’un décor, envisage son avenir, son rapport aux autres, aux sentiments (n’oublions pas que nous sommes chez les prêtres orthodoxes, qui ont le droit de se marier et d’avoir une vie de famille). Pourquoi donc One step behind the Seraphim plante-t-il alors son décor dans ce cadre ? Tout simplement parce que Daniel Sandu, son réalisateur, s’est basé sur sa propre expérience, et a voulu raconter ce dont il avait été lui-même témoin. En l’occurrence un environnement difficile, voire hostile, où sous des aspects bienveillants et protecteurs, la trahison et la manipulation sont de mise, de la part même de ceux qui sont en charge de leur enseignement, de leur évolution dans la vie. Tout l’enjeu, pour Gabriel, le jeune héros du film, sera alors de trouver sa place dans ce jeu de quilles, d’apprendre à contourner des règles biaisées, d’affirmer ses valeurs en dépit des méthodes abusives employées au séminaire. Cette véracité de l’éveil à l’âge adulte se trouve épaulée par une très belle mise en scène, remarquable pour une première œuvre, une photographie légèrement désaturée nous baignant d’un bout à l’autre dans les années 90, et une interprétation juste et sensible de Stefan Iancu en premier lieu. On notera quelques longueurs (avait-on besoin d’assister à autant d’allers-retours dans le bureau du directeur, certes obsessionnel dans sa quête de motifs d’expulsion ?), mais ce regard de l’intérieur, ce point de vue intime et sincère que le réalisateur insuffle à son personnage fait réellement mouche et apporte toute son épaisseur à un film qui annonce à n’en pas douter le début d’une prometteuse carrière pour Daniel Sandu. (A.J.)
Et voici le palmarès de la 19ème édition du Arras Film Festival
ATLAS D’OR / GRAND PRIX DU JURY
ATLAS D’ARGENT / PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
Mention spéciale du jury
PRIX SFCC DE LA CRITIQUE
PRIX DU PUBLIC
PRIX REGARDS JEUNES – RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).





















