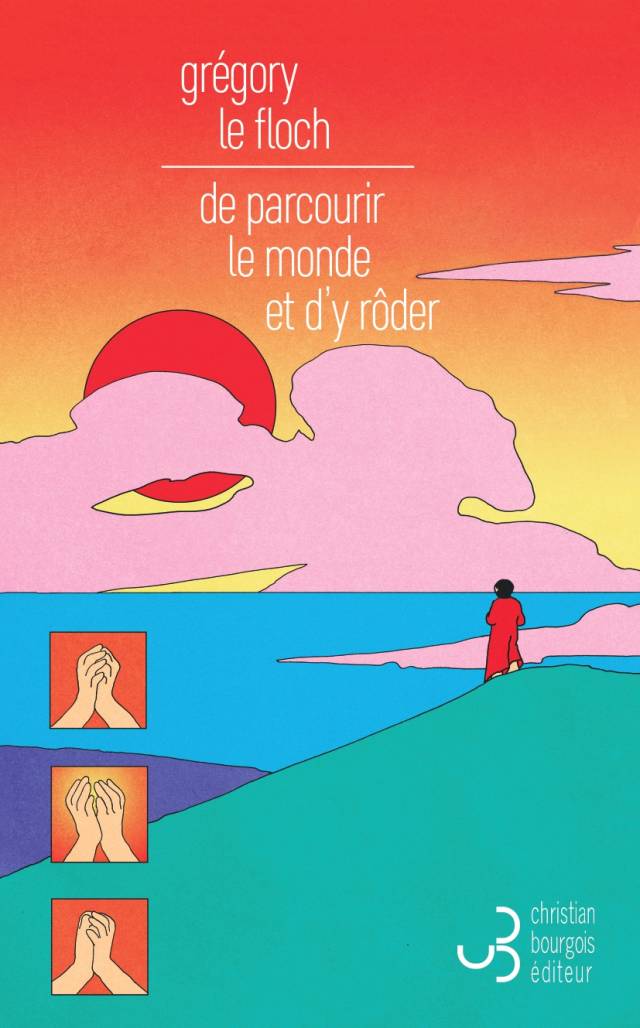C’est un jour comme un autre, pour le narrateur, perdu au huitième étage de sa tour (il est sûr du chiffre, il a déjà tenté d’insulter des passants sans succès). Sauf qu’il croit entendre un « Oh » ou un « Ah », il n’est plus trop sûr. Quand il descend, il trouve sur le sol, « une chose ». Pas moyen de mieux la définir, d’autant que les rares passants ont tous un avis sur la question quand ils ne détalent pas en courant face à l’horreur que provoque sa vision. Ni une, ni deux, il va bien falloir définir ce truc, cette chose. Il serre les poings, et se met en route.
Démarre alors une épopée truculente, à la recherche du sens et des aventures, dans ce poétique et bringuebalant « De parcourir le monde et d’y rôder », second roman de Grégory le Floch, dans la dynamique rentrée littéraire de Christian Bourgois.
« Chez moi, j’ai posé la chose sur la table, j’ai tiré une chaise et je m’y suis assis. J’ai posé mon menton sur la table et j’ai observé la chose. […] Des scientifiques, j’en avais vu, comme tout le monde, à la télé, dans des films. Et tels qu’on me les avait montrés, je me les figurais calmes, méthodiques et froids.
Parfois, je me levais pour réfléchir en marchant –les scientifiques faisaient ça-, puis je me rasseyais sur une autre chaise et découvrais la chose sous un nouvel angle. […] Découragé, je me suis levé pour aller m’affaler sur le canapé. En contournant la table, l’un des dessins que j’avais faits m’a sauté aux yeux : W I E N. c’est ce qui apparaissait sur l’une des feuilles de papier depuis ce côté-ci de la table : W I E N. » (pp. 21-23)
Le livre qui démarre alors, difficile à résumer, grande cavalcade fantasque et rieuse, peut tout entier se lire comme une incarnation physique et romanesque du MacGuffin, ce procédé cinématographique qui permet de lancer les rebondissements et ne sert à rien d’autre qu’au prétexte et dont la blague désormais célèbre, racontée par Hitchcock à Truffaut, semble résumer magnifiquement ce roman :
Deux voyageurs se trouvent dans un train allant de Londres à Édimbourg. L’un dit à l’autre : « Excusez-moi, monsieur, mais qu’est-ce que ce paquet à l’aspect bizarre que vous avez placé dans le filet au-dessus de votre tête ? — Ah ça, c’est un MacGuffin. — Qu’est-ce que c’est un MacGuffin ? — Eh bien, c’est un appareil pour attraper les lions dans les montagnes d’Écosse — Mais il n’y a pas de lions dans les montagnes d’Écosse. — Dans ce cas, ce n’est pas un MacGuffin ».
- Eloge du Schmilblick
Eloge de la sérendipité, ode au récit (ce qui nous meut) autant qu’au roman dont il joue dès les premières pages -brisant le 4e mur ou accumulant des digressions de bas de pages-, le récit de Grégory Le Floch se pose dès son incipit comme un grand objet ludique et fantasque, aussi amusé que proche de la folie.
On songe par son ton à une version sous buvard du Jean-Philippe Toussaint des débuts, grand amoureux des objets (La télévision, la salle de bain, etc), non seulement pour son hyper attention jusqu’à l’absurde, mais surtout pour cet humour du petit pas de côté, non de la déflagration mais des micro-fissures, et à ses personnages toujours à la fois hyper présents et un peu lunaires, déversant par les mots un lent glissement du sens. Le narrateur de Le Floch le confie d’ailleurs très vite : il vit des crises dont il ne peut obtenir l’évacuation qu’en parlant et en se confrontant aux autres.
Et c’est peu dire qu’il va s’y confronter : Juifs prêts à l’ Alyah, résultats d’une recherche web sur près de 2 pages, l’histoire loufoque du caca relique Listz, une considération sur l’âge d’or des vigiles, séquence d’amour torride avec la gardienne du musée Freud et attentats sans conséquences, fantasmes de cervelas et agression gratuite de passants pour cause de pulsions de violence, des escapades à Vienne, New York, des rencontres avec des intellectuels, une troupe de cirque freak, des diamantaires bizarres et des bouchers anti-FPÖ : avec « LA CHOSE », le grand cirque du monde qui s’ouvre.
« Caille à la truffe, souligne, recette pour 4 personnes, à la ligne, 4 cailles, 100 grammes de foie de volaille, 1 kilos de pommes de terre […] C’est bon ? T’as noté ? Je continue, à la ligne, acheter les cailles chez Ebner, pas Hauser, c’est un nazi de la FPÖ, à la ligne, choisir celle de gauche, le plus loin de la fenêtre, là où le soleil ne va jamais […] A la ligne, râper la truffe sans alumer la radio, ou la télé, car partout, sur toutes les chapines, on parle de la FPÖ, partout on leur donne la parole, et avec leur face de rats, ils joue au gendre idéal et embobinent la moitié de l’Autriche qui se dit NOTE ! qui se dit, donc, note sans oublier un mot, S’ils pensent comme ca alors pourquoi, nous, on ne penserait pas comme eux ? et la gangrène prend […] »
Ainsi libéré autant que perdu, le narrateur dérive, et son lecteur avec lui, à la fois passionné et distant à mesure que progressent les pages, pris tous deux entre la farandole des évènements et une forme de flottement, comme si de ce marasme rieur se dégageait, par accident (et qu’est donc ce roman si ce n’est un éloge de l’accident ?), un panorama en sourdine de notre époque, sursaturée et souffrant de Trouble de l’attention, promettant à coup de publicités des « rencontres » et des « expériences ». Les éclats du monde sont là (l’antismétisme, la révolte sociale, un attentat), mais toujours comme en passant.
Bien sûr, à force de rebondir sans cesse, l’énergie cinétique du début s’y perd un peu. La chose s’éloigne, se multiplie, stagne, et la partie new yorkaise, chronique douce-amère pourtant cœur d’un bon tiers du roman et lieu où l’humour laisse de plus en plus poindre le trouble, semble se disperser et s’épuiser.
Il se dégage alors de cette micro odyssée une poésie bizarroïde, où, suspendant la causalité (on peut y jeter un bébé par la fenêtre, faire l’amour et s’oublier, vivre un attentat sans conséquence), s’y suspend aussi le sens.
« Ce que le médium disait à propos des deux choses, je m’en foutais, c’était du sens, et le sens, avec eux, glissait sur moi. » (p.191)
Peu à peu, la rêverie se fissure, la loufoquerie du début se teinte progressivement d’étrange, comme si se célébraient les noces de de Chirico et de Magritte. L’inquiétude y guette, à mesure que la quête semble perdre d’horizon et que la narration se délite, et que l’angoisse tue de l’immobilisme et de la mort surviennent. Le cancer étend son spectre, gangrénant les actions et le récit, qui cahote et crachote. La mélancolie prend ses quartiers.
« je me rasseyais sur une autre chaise et découvrais la chose sous un nouvel angle ».
Tumeurs autant que moteurs, réflexion métaphysique sur l’être (et son néant) autant que la narration : et si, au fond, en le poussant sans cesse vers l’avant, la chose était le roman ?
- L’amour comme une valise
« Parce qu’aujourd’hui, dans le monde tel qu’il est, et pour une personne telle que je suis, si je monte dans un avion, comme n’importe qui, et que je me retrouve dans un pays loin d’ici, rien n’aura changé : j’échangerai des sourires avec les hôtesses, quelques politesses avec les vendeurs de là-bas, je pourrai même trouver un amant sur place. Mais je n’aurai rencontré personne, véritablement rencontré je veux dire, il n’y aura pas eu de nouveau départ, tout sera inévitablement comme avant. Ma solution, c’est la valise. Le type sort une fille, il doit réagir. »
Il existe un très beau livre, « Les arpenteurs du monde », de Daniel Kehlman, qui met en regard les deux grands Hommes, Von Humboldt et Gauss, l’explorateur des confins et le « prince des Mathématiciens », le marcheur insatiable et le pur esprit. Urbi et orbi, comment habiter le monde ? Comment l’arpenter ?
Avec plasticité, et à sa manière : avec loufoquerie, absurdité et rebond, répond malicieusement et avec angoisse Gregory Le Floch. Il faut se confronter aux autres, contre les autres et contre le monde : éviter le néant et la solitude, qui délitent nos existences comme le roman de celles-ci. Mobilis in mobile (sic), disait le Nautilus : Une bien belle manière d’être en vie.
Editions Christian Bourgois, 256 pages, 18 euros. En librairie le 20 Aout 2020.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).