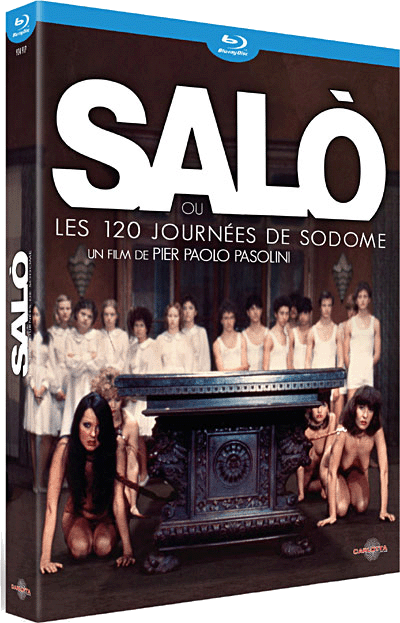© Carlotta
35 ans après sa sortie, que reste-t-il de Salò ? Au-delà de sa sulfureuse réputation d’une des œuvres les plus extrêmes jamais réalisées, qui alignerait les séquences sadiques et sexuelles, Salò ou les 120 journées de Sodome s’affirme avant tout comme un ahurissant paradoxe esthétique qui épuisera à jamais les tentatives d’analyse, faisant voler en éclat les critères usuels du « beau » et de la morale. Définitivement intemporelle, elle continuera dans 35 ans encore à marquer les esprits de son empreinte profonde, pour les hanter, les interpeler, ébranler leurs certitudes à chaque vision. Car de l’approche philosophique et politique de Pasolini naît une réflexion terrifiante sur les penchants innés de l’individu vers le Mal, son instinct de conservation et de domination clivant l’humanité en maîtres ou esclaves. En transposant dans l’Italie fasciste l’ouvrage de Sade, Les 120 journées de Sodome, Pasolini se confronte à deux grandes figures de la transgression, l’une culturelle, l’autre historique. D’un côté une œuvre placée sous le signe du sacrilège, de la pornographie, et de l’horreur. De l’autre les crimes contre l’humanité bien réels pour une période encore ressentie comme une plaie ouverte. Il s’attaque à deux domaines enchainés à un tabou de représentation qui charrient l’interdit et la censure. Aussi discutable que pouvait paraître de prime abord le choix de cette transposition, il fait office de double révélateur : l’œuvre de Sade livre des clés pour l’analyse du fonctionnement fasciste lorsque l’horreur historique permet d’appréhender la pensée sadienne dans toute sa complexité et de la réhabiliter. Brusquement, comme une évidente correspondance, la barbarie du réel puise son explication dans l’enfer littéraire. L’œuvre métaphysique de Sade trouve son abominable application dans les mécanismes du fascisme. Pasolini dépasse l’analyse critique superficielle qui maintient dans la rumeur de l’abject et de l’inconcevable, confondant l’homme et l’œuvre et affirmant que « montrer », c’est être du côté des bourreaux. La réflexion sur l’Histoire et sa négation se fond à la meilleure approche possible de Sade dans son versant le plus philosophique et désespéré, bref sa dimension la plus subversive. Salò devient une grande œuvre sur le Mal au travail, faisant des ponts stupéfiants entre sa réalité tangible et sa transposition littéraire. Ici, les aristocrates décadents du XVIIIe sont remplacés par quatre « seigneurs », représentants du pouvoir en place, choisissant dans les villages alentours des jeunes hommes et des jeunes femmes afin d’en user selon leur bon plaisir en les enfermant pendant 120 journées dans un magnifique domaine en vue de les torturer, les violer, puis les mettre à mort.

© Carlotta
Ils se font les créateurs d’une gigantesque pièce de théâtre dans laquelle se jouent les vies de ceux à qui ils ont distribué eux-mêmes les rôles, attribuant à certains ceux de bourreaux et au plus nombreux ceux de victimes. Par extension, ils redéfinissent le mécanisme même de la vie, nouveaux dieux tirant les ficelles de leurs marionnettes, décidant de l’instant propice où les couper. Les pièces de la villa deviennent un gigantesque espace de rituels, de cérémoniaux, telle une arène pour des combats gladiateurs : organisations de cérémonie de mariage, de repas coprophages, de scènes de coïts ou de tortures. Si la construction de Salò en trois cercles (inspirés par l’œuvre de Dante), comme trois actes, renforce incontestablement ce dispositif théâtral, elle illustre de façon inéluctable et hallucinée, une métaphysique de l’existence en trois axes vitaux : le sexe (« le cercle des passions »), le fonctionnement digestif (« le cercle de la merde ») et la mort (« le cercle du sang »). Salò ressemble parfois à une parodie funèbre des rêves de vie communautaire, dans laquelle le « rape and torture » se substituerait au « love and peace ». Plus encore, cette mascarade morbide et grotesque, ce carnaval de gens endimanchés pour mieux jouer la danse du sexe et de la mort, rappelle les rictus des squelettes d’Ensor qui décrivait l’absurdité de la vie par l’omniprésence de la Mort. Salò expérimente tout ce que l’homme est en mesure de faire subir à son prochain si on lui laisse le droit, libérant ainsi les pulsions que l’ordre social et la civilisation contenaient et refoulaient jusqu’à présent.

© Carlotta
Il n’y a donc dans ce spectacle aucun effet de suspens, on connaît par avance le sort réservé aux victimes (le générique l’annonce d’ailleurs, séparant d’un côté les acteurs jouant les victimes et ceux jouant les bourreaux). Les événements s’y déroulent phase par phase et rien ne viendra rompre les projets initialement prévus. Ce spécimen d’homme civilisé expérimente un nouveau système, froidement, logiquement, et toujours avec distinction, lisant les poètes romantiques ou citant les philosophes. L’attribution des rôles tortionnaire/victime se révèle parfaitement interchangeable, comme si l’innocence individuelle n’était qu’un hasard de distribution. Les maîtres bourreaux choisissent arbitrairement celui qui accomplira les sévices et celui qui les subira : l’un peut en quelque sorte apercevoir dans le regard de l’autre la souffrance auquel il aura échappé. Ecrasé par l’aliénation sociale et la soumission, l’homme, qui ne peut aspirer à la liberté est malléable, guidé par le miroitement de la gloire et la menace de la peur. La critique pasolinienne ne se limite donc pas à l’Italie mussolinienne et s’attache à démonter les rouages de tout pouvoir : « Le nazisme a commis cet acte de matière grossière, grand guignolesque, atroce, directe. Mais depuis, le pouvoir n’a pas changé.

© Carlotta
Le pouvoir, à présent, au lieu de manipuler les corps à la manière atroce d’Hitler, les manipule d’une autre façon, mais il réussit toujours à les déformer, à en faire de la marchandise ». Cet entrechoquement des thèmes, le trouble qui s’installe à chaque vision vécue comme une expérience, le débat sans cesse renouvelé autour d’une œuvre ouverte à toutes les analyses, tendent parfois à éclipser la beauté formelle de Salò, en particulier un sens inouï de la mise en scène et du cadrage, ainsi qu’une gestion de l’espace qui rappelle – aussi étonnant que ça puisse paraître – celle d’un Kubrick dans Shining par exemple. Au sein de cette immense villa, comme dans le futur hôtel Overlook, Pasolini installe ses personnages dans de grandes pièces qui les perdent dans leur immensité, à mesure qu’il les enferme. Les personnages livrés à cette géométrie se retrouvent écrasés entre une porte et deux murs transversaux. Ainsi, rarement la prégnance de l’innommable et de l’atrocité n’aura injecté autant de venin à l’image, avec un aplomb à la mesure de son absence de complaisance, nous posant comme spectateurs impuissants d’un carnage sur lequel il n’a aucune prise. Aucun repère moral ne survit pour venir en aide. Quand la musique de Carl Orff retentit lors du spectacle final, l’ultime horreur observée à travers des jumelles, c’est l’épouvante au sens propre qui nous étreint, nous laissant vidés et désemparés face à cette abomination géniale. Paradoxalement, derrière le masque de la distanciation théorique qui exclut toute émotion se dissimule la pudeur d’un cinéaste qui étouffe son cri dans une froideur presque clinique. Et pourtant la vision de ces visages torturés trahit l’écœurement de Pasolini, sa pensée insurrectionnelle et son propre mal face à l’Homme, à l’Histoire et au monde.
L’emploi des superlatifs paraît le seul moyen de rendre justice à cette édition blu-ray de Salò présenté dans sa version intégrale chez Carlotta, qui s’annonce comme LA définitive. Le travail de restauration est tout simplement éblouissant et revoir Salò en haute définition, avec un tel transfert, une telle précision tient du miracle au point qu’on en vienne à douter qu’il date de 1975. L’image est si précise, si parfaite que le malaise s’accentue comme incroyablement trop proches des martyres, de la souffrance que nous pourrions presque toucher. Etrange impression qui ne fait qu’en ajouter à ce sentiment paradoxal d’accomplissement formel inouï pour représenter l’horreur. Les bonus sont passionnants, qu’il s’agissent des documents présentant Pasolini au travail, des témoignages évoquant un tournage, jeune, bon enfant presque joyeux pour un film atroce, ou encore des propos de cinéastes français que Salò a marqué (Catherine Breillat, Gaspard Noë, Claire Denis) au point de leur faire définitivement changer la vision du cinéma et leur façon de voir le monde. Mais aussi instructifs soient ils, face au film de Pasolini, chaque analyse paraît insuffisante, laissant à jamais cette œuvre magistrale hors de toute réponse.
Salò ou les 120 jours de Sodome (Italie, 1976) de Pier Paolo Pasolini, avec Paolo Bonacelli, Giorgio Castaldi, Hélène Surgère, Elsa de Giorgi.
Edité par Carlotta
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).