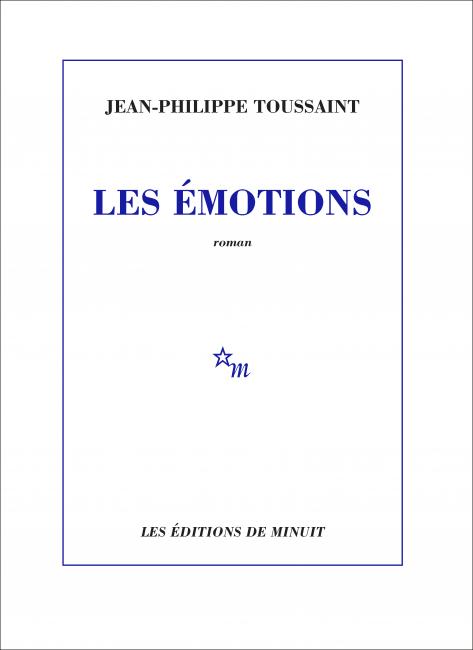« Je le pensai en ces termes : « C’est, en effet, très émouvant. » Je percevais l’émotion que la situation recelait, je me rendais compte que la scène que j’étais en train de vivre était très émouvante, mais je n’éprouvais pas moi-même cette émotion, comme si, l’esprit tendu et attentif, à l’écoute des sentiments que je ressentais ou que j’aurais dû ressentir, j’étais incapable de les éprouver vraiment, je ne pouvais que les observer de l’extérieur, et, dans cette nuance, dans cette infime distinction, je voyais une constante de mon caractère, une raideur, une rigidité, une difficulté que j’ai toujours eue à exprimer mes émotions. »
Ainsi s’échouait, sur les rives de cette ultime pensée, comme une note bleue tenue da capo, La Clef Usb , très grand roman de Jean-Philippe Toussaint, dont on retrouve ici le personnage principal Jean Detrez (pour ce qui sera un cycle à la manière de MMMM), toujours en prise avec sa gestion difficile de la prospective et des sentiments.
Redéployant quasiment exclusivement ce dernier paragraphe programmatique, Les émotions, tout juste paru aux Editions de Minuit, remontera donc dans une mélopée de flux de conscience le fil de l’histoire qui se dévoilait sur les quelques jours de l’action de la Clef USB (jamais évoqué ici ou presque, à peine une ligne, comme une disparition que le narrateur appelait de ses vœux aux premières lignes).
Une auscultation : du souvenir vide gris d’un congrès de prospective international au deuil du père, à peine effleuré avec douceur/douleur dans le premier tome, et creusé ici sur un tiers du récit, ou au retour du réel qui frappe à la porte à travers la crise de l’Eyjafjöll, trois actes fondateurs, éclatés temporellement (avant ou après le deuil), et traversés avec un étrange détachement percé de passions par ce mâle blanc en quête de sens.
- E-mot-ions
« Jusqu’à quel point peut-on oublier quelque chose qui nous est arrivé ? »
Ainsi donc le grand livre triste n’était pas celui que l’on croit : si La Clef USB masquait sous énormément de mouvements la déchirure brutale du deuil qui allait survenir, comme une politesse et un éloge de la fiction pour cacher la brûlure de l’absence, Les Emotions se réveille au contraire comme un grand roman catatonique, où rien ou presque ne se passe.
C’est que Detrez, sorti de son escapade fofolle en Asie, n’est pas exactement un aventurier : bon petit soldat de la Commission, il perd sa vie de congrès en rencontres, de prospectives en scénarios possibles, masquant au mieux possible son vide par ses souvenirs. Celui de son père, défunt, de sa jeunesse, de la restauration hautement symbolique du Beyrlamont par son frère, des tensions avec Diane, de la mélancolie de l’histoire passée avec Elisabetta. Et s’il ronge son os en se bercant au gré d’une photo floue de femme nue qui lui rappelle une aventure avortée mais superbe, il lui faudra une explosion bien plus grande et concrète pour qu’il puisse renouer enfin avec la présence en monde : un volcan explose en Islande, et de la poussière qui recouvre tout naitra un sens (une utilité ?) à Jean Detrez le gris.
Life is what happens to you while you’re busy making other plans, disait Lennon et disions-nous à propos du précédent roman.
On ne saurait mieux dire ici de la grisaille rangée de Detrez, obsédé du déterminisme (comment mes statistiques vont pouvoir prédire le monde et si possible mon existences) qui, après avoir déployé beaucoup d’énergie à essayer de fuir sa vie, voit ici chaque étape pourtant normée de son existence se briser sous le coup d’une rencontre (Enid, Elisabetta, Pilar), d’une absence (le père, Diane).
Du macro au micro, tout l’enjeu de ce négatif du premier tome sera alors de redéployer cette expérience du monde comme un accident, et de tenter, au mieux, de gérer le ballet entre distance et le ressenti, entre le percevoir et le dire, entre ce qui est du présent et de la reconstruction mentale, ce qui fait barrière (souvent) et ce qui ouvre à l’autre (rarement).
- Mélancolie de la maitrise
Les émotions, apparaissent alors, dans la narration comme dans l’écriture, comme ce qui surgit ou se soustrait, ce qui fait effraction : ce qu’en musique on aurait nommé impromptu.
L’élégance ouatée de l’écriture de Toussaint, son goût pour talonner le degré zéro des choses, ses phrases à virgules percées de remarques anodines voire tartes qui décadrent l’action, ses prolepses, bref, son attirail contre le sucre facile accouche alors dans ce bain de souvenirs et de banalité d’un grand et beau livre dont la politesse de surface cache tant bien que mal cette mélancolie et cette tristesse poignantes et intime, cette tension entre la vie et le subi, qui se disent aussi mal que le bonheur, déjà enfui, sans cesse en fuite, comme souvent chez l’auteur d’un roman du même nom.
« Je regardais Elisabetta dans l’église, et, la voyant telle qu’elle avait toujours été — Elisabetta, simple, rayonnante, solaire —, je me rappelais notre première rencontre près de trente ans plus tôt. »
Du désir à la maitrise : quand il tisse cette drôle de partition boiteuse entre le gris et ce qui fait être vivant, quand il creuse pour injecter à haute lutte du romantisme dans des situations narratives d’un ennui total, le blanc révélant la couleur, le livre de Toussaint est superbe et bouleversant.
Il suffit de voir avec quel brio il teinte la pire des situations narratives d’un érotisme discret (les séquences incroyables de bain ou du dernier rapprochement avec Diane), d’une mélancolie du temps qui passe sublime (le retour d’Elisabetta) ou d’un creusement intime qui transforme une visite nocturne d’un appartement habité par une histoire d’amour passée en un rebond de souvenirs émouvants, une simple fuite d’eau dévoilant sans les dire les enjeux cachés d’une sensation qui s’enfuit.
Je ne savais pas ce que je faisais, je touchais son corps, elle portait ses mains sur ma nuque, sur mon épaule, je ne savais pas ce qui se passait et je ne sais pas comment ça s’arrêta, mais ça s’arrêta, on cessa de s’embrasser et de se toucher, on se regardait, immobiles, couchés sur le couvre-lit sans plus bouger, et j’avais le sentiment qu’on était l’un et l’autre terriblement gênés et en même temps terriblement apaisés. Ce que nous venions de vivre à l’instant dans cette chambre d’hôtel était quelque chose d’inexprimable. Toute tentative d’explication aurait été réductrice et aurait dénaturé l’expérience absolument unique que nous venions de vivre. Il y a des choses qui ne peuvent se dire, car ce serait les sortir du contexte de chaleur et de vie où elles étaient survenues. En vérité, nous n’avions rien fait, mais ce rien avait pour moi une résonance indescriptible, et cette union fugitive de nos corps ce soir dans cette chambre d’hôtel, même si nous l’avions très vite interrompue, même s’il ne s’était rien passé, avait été une des étreintes les plus bouleversantes de ma vie.
- Dure lutte
« j’étais incapable de les éprouver vraiment, je ne pouvais que les observer de l’extérieur, et, dans cette nuance, dans cette infime distinction, je voyais une constante de mon caractère, une raideur, une rigidité, une difficulté que j’ai toujours eue à exprimer mes émotions. »
Dans son plus complexe et problématique, cette lutte du personnage et du récit avec les émotions et leur dire, quand elle est perdue, crée une distance inaltérable : Jean Detrez n’est pas l’amoureux triste et enflammé du précédent cycle, Diane (ou ses avatars facon matrioshka, une femme en cachant une autre et une autre) n’est pas Marie, moins insaisissable que casse-bonbon, et la dépression de Detrez qui couve dans le récit finit par éteindre bien souvent les tensions dans une grisaille morne.
Je me souvenais que, peu de temps avant sa mort, un jour que j’étais venu voir mon père avenue Émile Duray et que je m’étais assis avec lui pour bavarder dans son bureau (c’était fin novembre, c’est sans doute la dernière fois que j’ai eu une conversation avec lui sur l’actualité), il s’est levé et il a traversé son bureau pour aller chercher une coupure de presse sur sa table de travail. Il est resté debout et me l’a lue à voix haute : « La décomposition de l’Union européenne est en cours. » Il a souri. Tu sais qui a dit ça ? me dit-il avec une lueur de complicité amusée dans le regard. C’est Trump. Désabusé, il reposa la coupure de presse sur son bureau et il fit un geste du bras qui semblait dire « bah, quelle importance ce que pense ce voyou inculte ». Écoute plutôt ça, dit-il, et il ramassa un autre papier, une page de carnet quadrillée sur laquelle je fus ému de constater qu’il avait recopié lui-même une citation à la main. Évidemment, c’est d’un autre niveau, c’est Victor Hugo : « Oui, puisque l’Amérique, hélas ! lugubrement conservatrice de la servitude, penche vers la nuit, que l’Europe se rallume ! »
Mon père avait été enterré, c’était fini.
Bien sûr, on saisit bien que, au fond, il ne s’agit plus tant seulement de solitude ou de couple que de ce qui nous lie plus globalement, amoureusement, filialement, hiérarchiquement, au monde, et comment se tissent les deux, comme dans l’incipit magistral de pudeur du roman :
« À Bruxelles, la journée avait été caniculaire. Nous vivions avec Diane les dernières heures de notre vie commune. »
Mais cette ampleur inédite finit pourtant par lasser, et si on la réduit à ses personnages, on se prend à bailler gentiment aux errements sentimentaux de cette famille bien blanche et BCBG de classe supérieure, tiraillée entre les bureaux de la Commission et des restaurations architecturales, et ce personnage de vieux mâle blanc CSP+ se révèle finalement si ennuyeux qu’on se rêverait à le secouer pour qu’il cesse de s’observer le nombril et de geindre en mineur.
Bref, il faut l’avouer en mots simples, on s’ennuie un peu/beaucoup, rarement passionnément.
Dans ce grand récit conceptuel (quel gros mot) apparaissent alors, malgré son brio, les « ficelles » de l’écrivain, son système tournant à vide : ses effets de style, son éclatement du récit géographiquement et historiquement, ses courses effrénées (dont il a déjà usé avec un brio inoubliable notamment dans « Fuir ») qui compensent des personnages qui subissent, ses femmes superbes et fuyantes, son mâle middle-age et citadin, sa manière de dire sans dire ou du moins sans investir, sa distance polissant tant qu’à la fin la pierre casse.
Incroyablement racé mais totalement inabouti, on ressort alors de cette traversée ample et minuscule avec le sentiment d’un déjà-lu, d’un déjà-vécu, sans doute mieux.
La maladie Detrez contamine Toussaint : du grand roman mélancolique et pudique, il ne reste que les traces, oripeaux sublime de ce qu’il aurait pu devenir s’il s’accordait, lui aussi, un peu plus de liberté.
Les Editions de Minuit, 240 pages, 18.50 euros. En librairie.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).