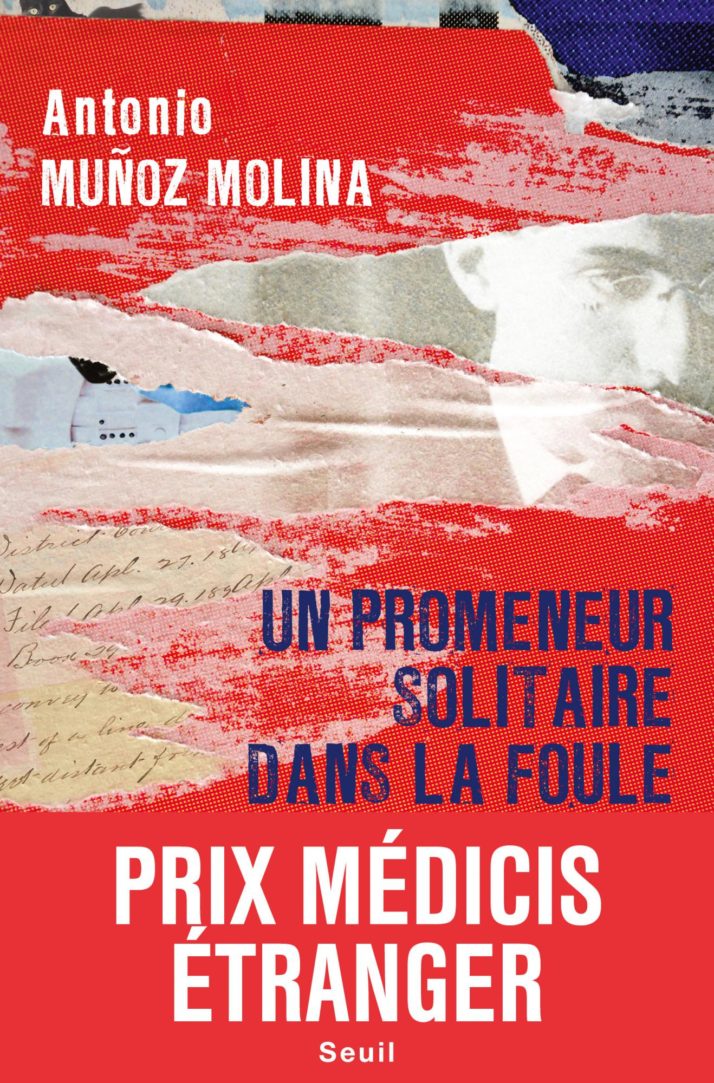Au-delà de l’écrasant « Les lionnes » de Lucy Ellman (dont nous espérons vous parler bien vite), il y a, les mois confinés nous permettent d’en parler plus calmement, décidément une forme de mélancolie douce qui se dégageait de cette rentrée littéraire du domaine étranger chez Seuil, placée semble-t-il sous le haut patronage Joycien de l’expérimentation et du récit.
Après un fantomatique et inabouti « La capture », de Mary Costello (dont nous vous parlions ici), c’est au tour du grand Antonio Munoz Molina de nous convier à sa ronde de regardeur du monde dans « Un promeneur solitaire dans la foule », dans un monde où Ithaque finalement n’existerait pas tant moins que la sensation d’exil dans un récit qui, tiens tiens, convoque Joyce dès son exergue :
A book should not be planned out beforehead, but as one writes it will form itself, subject to the constant emotional promptings of one’s personality.
(On ne devrait jamais planifier un livre à l’avance, mais le laisser se former de lui-même au fil de l’écriture, au gré des injonctions et des émotions perpétuelles de sa personnalité.)
James JOYCE
- Les mots. Des pages. Des pages. Des pages.
Car dans cette résurgence aqueuse des Miscellannées, c’est bien à une odyssée minuscule que s’attelle Munoz Molina, un carnet en poche et un téléphone en mode enregistreur pour répéter ce qu’il voit, entend, ressent, pense, naviguant dans les eaux troubles non des mers, mais des villes et du temps, attentif à chaque morceau, chaque instant, chaque micro-fiction, oscillant de la vulgarité aux pensées philosophiques et littéraires, des fragments volés à la volée de conversations téléphoniques aux souvenirs de déracinement.
Technologie Appliquée à la Vie. Je lis chaque mot écrit que je découvre sur mon passage. Réservé aux pompiers. Alarme connectée avec vidéosurveillance. Achète votre voiture, paiement comptant. Il y a de la beauté, une perfection sans effort dans la tombée graduelle de la nuit. Le mot LIBRE brille en vert clair sur le pare-brise d’un taxi, suspendu dans la rue obscure, comme découpé et collé sur un fond noir, le bristol d’un album. Un autobus éclairé et sans passagers débouche à toute vitesse d’un tunnel, galion fantôme en haute mer. Un de ses flancs est entièrement recouvert d’une publicité panoramique pour du salmorejo1. Profite maintenant des saveurs de l’été. Les mots de la rue acquièrent une séquence rythmique. Achète or. Achète argent. Achète or et argent. Don du sang. Achète or. Don du sang. Aux arrêts d’autobus brillent des panneaux lumineux avec les derniers films à l’affiche. Les Dieux d’Égypte. La bataille pour l’éternité commence. Les Tortues Ninjas : les Héros sont de retour. Invitations, ordres et interdictions successifs auxquels je n’avais jusqu’alors pas prêté attention en passant dans cette rue. Interdit de laisser des récipients hors des containers. Interdit d’entrer. Viens savourer nos cocktails. Célèbre avec nous tes grandes occasions. Avant que j’arrive à la terrasse d’un bar, les voix des buveurs, le son des verres et des couverts sur les assiettes de tapas montent comme un murmure choral. Je traverse sans m’arrêter l’épaisseur de voix et d’odeurs. Viande grillée, graisse animale, fumée de friture et de tabac, carapaces de gambas. Spécialités de viande à la braise et côtelettes d’agneau. Goûtez notre riz au homard. Il y a un étalage de succulence verbale, une splendeur de nature morte hollandaise dans la typographie des pancartes. Croquettes. CÔTE DE BŒUF. Gambas à l’ail. Tripes à la madrilène. FROMAGES. Aubergines au salmorejo. LOUP À LA BILBAÏNA. EMPANADA DE BONITE. PAELLA. ENTRECÔTE. Le soir de juin amène sur les trottoirs de Madrid une ample placidité de ville balnéaire où les familles vont passer l’été. Je me promène en me laissant porter et me rends compte que cette soirée est la dernière que je vis dans ce quartier où je suis resté de si nombreuses années. Un homme et une femme aux cheveux blancs et d’aspect juvénile sourient, leurs visages rapprochés, dans la vitrine d’un magasin d’aides auditives. Sur les publicités, les personnes âgées ont un sourire non dénué d’optimisme et les jeunes rient aux éclats, la bouche grande ouverte, montrant leur langue et leurs gencives. Je n’avais pas fait attention à cette affiche ni à son invitation ou à son injonction, à ses caractères blancs sur le fond bleu d’un bonheur de retraités avec des sonotones invisibles : Sois tout ouïe. Écoute les véritables sons de la vie.
C’est le livre d’un rêveur, mais d’un rêveur éveillé : le regard en alerte, essayant de faire corps avec l’espace qu’il traverse, échouant sans cesse (il y a dans ses notes l’ombre de la dépression parfois), recommençant encore, morceau après morceau.
« Tu es déjà allé au Palacio de Hielo ? »
« Vous pouvez me donner une pièce pour un sandwich ? Ce serait sympa. »
« Il faut que je vienne ici tous les putains de jours de la semaine pour te voir ? »
« Comme je dis toujours, s’ils ont tellement souffert, qu’est-ce qu’on peut y faire si on n’est pas comme eux ? »
« Non, il ne s’est pas levé. Il vient juste de se réveiller. Il était en train d’ouvrir les yeux. »
« Je veux bien lui donner quelque chose, mais sûrement pas tout ce qu’il veut. »
« Quand il avait treize ans, son père est mort d’une attaque pendant une chasse à la perdrix dans le domaine de Cortina. »
« Il faut que ce soit de nuit. »
« Non. De jour, c’est mieux. »
« Une petite pièce, s’il vous plaît s’il vous plaît. »
J’ai l’iPhone que Je Veux.
« Une petite pièce, monsieur, n’importe quoi, ce que vous avez sur vous. »
« Beaucoup de gens disent que tout ça, c’est de la sorcellerie. »
« Je lis tout » : embrassé et embrasé par le regard, le tempo de notre quotidien et du monde se dessine. Dans une rue noire, dans le métro, dans l’intimité d’un appartement que l’on quitte ou dans celui que l’on rejoint, des pages : des pages sur la vulgarité des publicités et leur monde factice (l’iconologie), des pages sur la puissance de Bosch ou la majestueuse misère de Tichy, des pages sur le plaisir de la déambulation, des semelles de chaussures, des pages sur la dépression, des notes bouleversantes sur l’être aimé et la femme qui vieillit à nos côtés, des pages sur Pessoa, l’homme qui n’était pas là, des pages sur les cafés, les bibliothèques, New York, Paris, Madrid, Lisbonne, Madère.
« Je cherchais une musique de mots qui soit celle à la fois de la poésie et du parler de tous les jours et des publicités et des journaux et des magazines de mode et des messages érotiques et des prévisions de l’horoscope : une musique transparente qui respirerait comme l’air et que personne n’aurait pourtant encore ni imaginée ni écoutée. »
Vigilant et intime, écrasant et léger, il se diffuse de ce cut-up choral une musique, celle des injonctions contradictoires, des chiens écrasés comme des grands évènements, des lieux comme des êtres, du passé comme du présent : comment être en vie, alors ? Où être dans le monde alors que tout semble écrasant ?
- Les Lettres.
Il faut peut-être laisser l’esprit replonger vers le passé, semble répondre Munoz Molina, qui glisse doucement et par rebond vers ceux qui l’ont bâti, les mêmes arpenteurs sensibles et colériques, les mêmes Albatros. Ceux qui ont peuplé d’autres pages, et dont il rêve d’inventer la science : celle de la « déambulologie ».
Collant à leur basque parfois des décennies ou siècle plus tard (dans une poésie nostalgique émouvante), il se rassérène aux douceurs de la nostalgie rêveuse, reliant dans une rue de Paris à des époques différentes et déliées les pas de Wilde et de Baudelaire ou Benjamin, le Melville des douanes newyorkaises et le Pessoa des rives du Tage.
Conduis vers l’Inattendu. La silhouette continue de marcher du même pas pressé. On dirait qu’elle se rapproche mais elle est toujours à égale distance, découpée en noir sur l’écran en arrière-plan. De Quincey va toujours d’un lieu à un autre. Il se rend vite quelque part dans le but exclusif d’en repartir dès que possible. Il est à Londres et va à Liverpool. S’installe à Édimbourg et vit peu après à Glasgow. La ville en fond d’écran change à chaque instant.
Ses conteurs impénitents racontent la même recherche du monde, la même marche forcée et la même inadéquation : c’est de Quincey fuyant sa misère dans l’opium, Edgar Allan Poe son quotidien en rêvant d’un Londres ou Paris mythique, Emily Dickinson se retirant du monde pour mieux aimer son jardin, Baudelaire vomissant la modernité en errant dans les grands boulevards, composant de tête les fleurs du Mal.
- Modernité.
Qu’on ne prenne pas toutefois ce long monologue épars pour le cri d’un aigri, délire parnassien d’un vieil homme blanc intellectuel se repliant sur sa culture (ce qui peut parfois en ressortir) pour mieux conjurer le présent et sa basse vulgarité publicitaire, grattant rageusement ou faussement nostalgiquement ces notes pour dénoncer autant de nodules du cancer de la modernité : Antonia Munoz Molina en célèbre aussi la beauté, scrutant la poésie à chaque recoin, se repliant seulement au besoin dans l’anamnèse, les souvenirs et le rêve pour mieux les faire résonner.
Évade-toi Vers la Ville au Meilleur Prix. Marcher dans Paris sans rien faire et sans avoir personne à retrouver après une journée de travail, c’est vivre dans ce couchant de juin précis et l’évoquer des années, des décennies après lorsque, au bout du compte, le présent si flou et même invisible révélera ses intentions incontestables de devenir historique. Sous les ponts, au bord de la Seine, une multitude de jeunes gens boivent et discutent, leurs jambes nues ballant le long des parapets de pierre, une clameur de voix festives pareille à celle d’une place de Madrid. Le courant du fleuve est rapide et turbulent, très puissant, et il a la brillance huileuse du dos d’un grand animal marin sous les réverbères qui viennent de s’allumer. Au bord de la Seine, je me rappelle le courant du fleuve Hudson. Je perds la notion du temps que j’ai passé à marcher. Il y a des places et des boulevards saturés de touristes, à la densité suffocante d’un été vénitien et, à côté, à un pas, des places et des rues plus étroites où règne le silence d’une ville d’un autre temps. Paris en noir et blanc sur une photo de Brassaï. Le soleil a cogné toute la journée en se réverbérant sur la pierre calcaire des immeubles. Après des mois de ciel gris et de pluie incessante, les femmes sortent pour la première fois les épaules dénudées, les jambes très blanches. L’épaisseur de l’air et la persistance de la clarté diurne accentuent un sentiment d’amplitude spatiale et de temps dilaté favorable à la dérive paresseuse. Il fait jour jusqu’à dix heures du soir. Place Saint-Michel, les jeunes gens se baignent dans la fontaine, sous la statue de l’archange de bronze aux ailes déployées et à l’épée levée qui piétine un démon.
Il s’interroge, et note, inlassablement, pour chercher à saisir.
« C’était l’été de pokemon go et des attentats-suicide » : tout semble tenir dans ce genre de phrases, brutales et étouffantes, qui apparaissent sans prévenir au détour d’une page. La modernité faussement facile d’un monde rêvé à notre place s’y trouve déchiré par l’intrusion de la mort (et c’est peu dire qu’après une vingtaine de pages rêveuse, le hurlement d’un kamikaze vient déchirer le voile de nos pensées).
Vulgarité, violence du monde, poésie : l’ouvrage bouleverse justement pour sa dialectique, sa ligne de crête sensible entre les différentes échelles de sens, les différentes temporalités, les différentes focales du regard, qui disent finalement énormément de la perte et du tourbillon du monde tel qu’il ne va plus tellement, et va encore moins depuis plus d’un an.
Dans sa perte, qui est tout autant douceur que lutte contre le monde et contre la mort qui rôde, notant tout ce qui est pour que cela ne puisse s’effacer : « L’archiviste qui veut sauver quelque chose de la grande cataracte permanente ».
- Des passants
Cet axe du livre révèle une noirceur inédite, presque dépressive, derrière la bonhomie légère du flâneur : le livre d’une inquiétude, une lutte pour le décillement, un acte de résistance contre l’écrasement.
« … le grand poème de ce siècle ne pourra être écrit qu’avec des matériaux de rebut », m’a-t-il dit la deuxième ou la troisième fois que nous nous sommes vus, après avoir laissé tomber bruyamment près de lui son cartable bien rempli. Il parlait en concentrant son regard sur le marbre de la table du Café Comercial, à voix basse, d’un ton posé qui contredisait la véhémence de ses propos. « Avec les rebuts de la langue, le désordre et le bruit, les abus et les erreurs dans les doublages des séries et des films américains, avec les mots au rabais de la publicité, de la consommation, des relations publiques, de la politique, du jargon technologique, de la pseudo-poésie des publicités de parfums, du langage de l’autodéveloppement, des prédictions astrologiques, des annonces pour escort girls et massages, des hypothèques et prêts bancaires, avec l’énumération magnifique d’aliments sur les brochures des supermarchés et les ardoises qu’on pose à midi devant les portes des restaurants. Seul le rebut peut rendre compte de toute cette surabondance de rebut.
Devenir acteur du monde par son archivage : il s’épuise à tout saisir, il nous épuise aussi, parfois, au long de ses plus de 500 pages, et on ressort à la fois rêveur et fourbu, de chaque pas en sa compagnie. C’est même l’effet recherché.
Par sa sursaturation des sens, son amalgame tantôt léger, tantôt grave d’histoires et d’Histoire, de lieux, de contradictions, « Un promeneur solitaire dans la foule » est le genre d’ouvrage dont on ressort sans trop savoir ce que nos souvenirs accrocheront, nous demandant, au fond, d’être nous aussi acteurs, de reconfigurer, à notre tour, ses notes d’un monde déjà épuisé.
Il faut le lire comme un « flow », presque une poésie en prose façon beat, accepter les décrochages, l’écouter comme un livre jazz, le descendre comme le fait Jeanne Moreau dans « Ascenseur pour l’échafaud », seule et attirée par la lumière, recherchant sans succès les êtres aimés dans les ombres.
Nous ne sommes que des passants, solitaires et anonymes, nous dit Munoz Molina, et nous sommes tous des histoires, traversant l’espace comme des fantômes. Ouvrons nos sens et nos sensations, et puisque nous ne faisons que passer, déambulons : sa sensible traversée de la nuit nous fait entendre le murmure de la tectonique du monde.
Editions Seuil, 528 pages, 24 euros. En libraire.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).