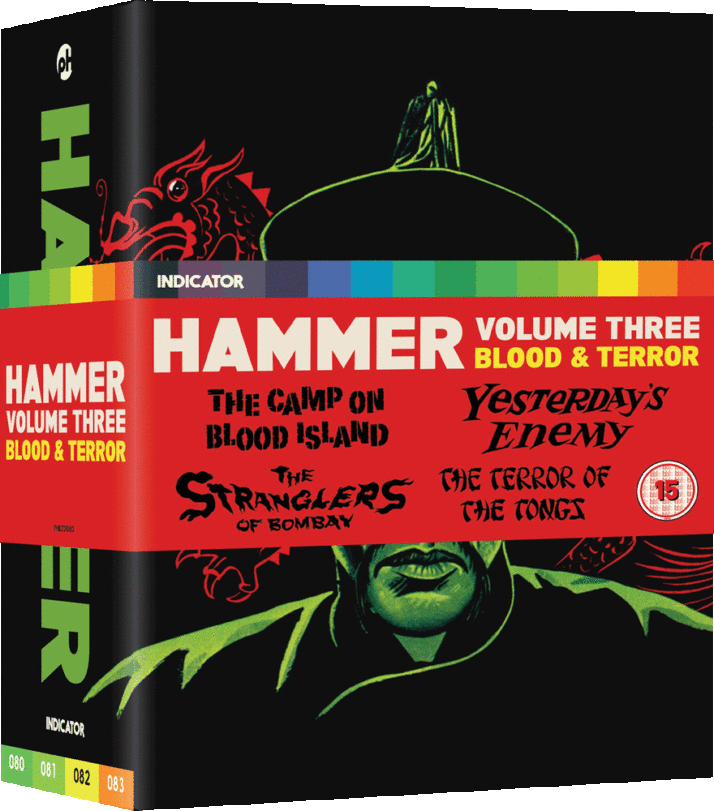L’éditeur anglais Powerhouse poursuit son exploration du catalogue Hammer avec un troisième coffret de quatre films pour la première fois en Blu-ray. Intitulé « Blood and Terror » (« Criminal Intent » et « Fear Warning ! », titres des deux précédents coffrets, auraient aussi pu se rapporter à celui-ci), ce troisième volet fait la part belle à la dimension colonialiste de l’Empire britannique, avec des films se déroulant aux Indes autour d’une mystérieuse secte sanguinaire (The Stranglers of Bombay, sans doute le plus connu des quatre), à Singapour et en Birmanie pour un diptyque d’intrigues se déroulant dans des camps de prisonniers (The Camp on Blood Island et Yesterday’s Enemy), et enfin à Hong-Kong sur les traces d’une organisation criminelle des plus retorses (The Terror of the Tongs). Que le contexte s’avère guerrier ou exotique, l’ensemble se révèle très cohérent, avec ces quatre oeuvres à réévaluer ou redécouvrir absolument !
The Camp on Blood Island (Val Guest, GB, 1958)
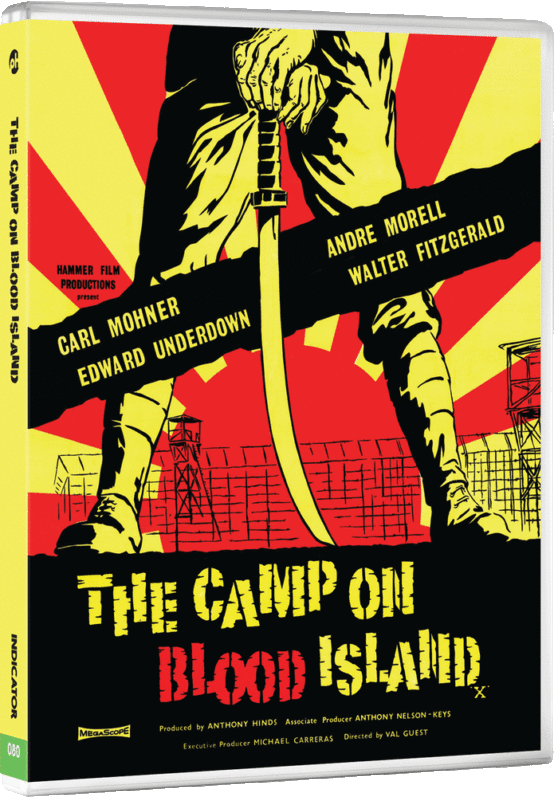
Réalisé en 1958 par le très prolifique Val Guest, à qui l’on doit déjà à ce moment-là les deux premiers films de la série Quatermass (Le Monstre en 1955 et La Marque en 1957), The Camp on Blood Island (son titre français, L’Île du camp sans retour, est quasiment aussi racoleur), jouit d’une réputation mitigée, entre violence gratuite et complaisance de mauvais aloi.
L’action se situe à Singapour au crépuscule de la Guerre du Pacifique, dans un camp japonais de prisonniers britanniques. Le film s’ouvre sur une scène d’humiliation : l’un des captifs contraint de creuser sa propre tombe avant qu’un chef japonais ne l’exécute. Le scénario s’attachera ensuite à décrire la vie pour le moins difficile dans ce camp, l’intérêt de l’intrigue résidant dans le fait que le commandant du camp ait déclaré qu’il massacrerait l’intégralité des prisonniers s’il apprenait la reddition du Japon. Lorsque certains prisonniers apprennent ladite reddition, ils mettent tout en œuvre afin que la nouvelle ne parvienne pas jusqu’au cruel commandant.
L’argument de départ est ainsi particulièrement prenant, autour de cette poignée d’hommes seuls au courant que la guerre est finie, devant dissimuler la vérité à tous afin de les sauver. Flotte un total sentiment d’absurdité et de mélancolie, avec cette impossible joie de la victoire, et ce mensonge comme source de survie.
Évidemment, sur des sujets/décors similaires, The Camp on Blood Island souffre de la comparaison avec des œuvres beaucoup plus subtiles et subversives. On pense d’emblée au Pont de la rivière Kwai de David Lean (1957) ou à Furyo (Merry Christmas, Mr Lawrence) de Nagisa Oshima (1983). Mais The Camp on Blood Island mérite-t-il pour autant sa piètre réputation de catalogue de tortures et de film raciste ? À vrai dire, l’espace critique autour du film paraît aujourd’hui un brin exagéré et plus caricatural que le film lui-même.
Certes, on retrouve parmi les interprètes des britanniques grimés en méchants japonais (Ronald Radd pour le Colonel Yamamitsu, commandant du camp, et Marne Maitland, vu aussi dans La Femme reptile et Les étrangleurs de Bombay, dans le rôle du sadique Capitaine Sakamura), totalement grotesques, en particulier le Colonel, vociférant de colère à moult reprises. Une certaine manière de ridiculiser la notion même de japonais, l’ennemi, pour mieux l’exorciser, une revanche assez basse contre les exactions commises pendant la guerre. En témoigne également ce mépris de la langue japonaise, remplacé par un charabia incompréhensible, une langue inventée à l’occasion sans même qu’ait été prise la peine de chercher la moindre authenticité.
C’est d’autant plus dommage que le traitement de l’héroïsme britannique est quant à lui loin d’être manichéen. On suit un groupe de personnages complexes et bien développés avec chacun leurs motivations. Confrontées les unes aux autres, elles provoquent un vrai trouble chez un spectateur à l’esprit rendu presque aussi confus que celui des protagonistes. Sans atteindre la remise en question de l’héroïsme et du patriotisme de Lean à travers le Colonel Nicholson incarné par Alec Guinness entraîné dans sa folie des grandeurs, le colonel Lambert, enfoncé dans sa stratégie sans dévier d’un sourcil quitte à faire les mauvais choix, provoque un trouble inconfortable. Il se sent responsable et estime que quelqu’un doit décider, s’opposant à toute alternative que la sienne. Et s’il avait tort ? Ce seront pourtant les décisions individuelles hors autorité qui sauveront la mise en passant outre les ordres. À cet égard, The Camp on Blood Island offre une réflexion sur le choix individuel et collectif et le devoir qui rappellerait presque Joseph Conrad.
- Capture d’écran Blu-Ray © Powerhouse
- Capture d’écran Blu-Ray © Powerhouse
Au-delà de tous les reproches que l’on peut lui faire, n’oublions pas que malgré le prisme limité de la vision, les faits décrits ne sont pas inventés. On privilégiera alors la dimension cathartique d’un tel film face au trauma des rescapés de l’après-guerre et de ceux qui attendirent le retour des soldats.
The Camp on Blood Island demeure une œuvre particulièrement tendue et efficace. Très amère également. Le talent de metteur en scène de Val Guest est bien là, et la progression narrative est haletante. On est donc bien loin de l’enchaînement d’exactions que laissait craindre le titre. On tient là une vraie intrigue, une vraie profondeur, secondées par une superbe direction photo. The Camp on Blood Island frappe par son écriture psychologique, en particulier celle de ses personnages féminins, aux antipodes de ce qu’on aurait pu imaginer de la part de la Hammer. Dans leur camp de femmes, séparées de leur époux, de leur père, elles communiquent avec eux comme elles le peuvent, luttant de leur côté, avec une folle énergie et sans une once de « faiblesse féminine ». Barbara Shelley, improvisée médecin à l’image de son mari (Richard Wordsworth, silhouette dégingandée errant tout comme son personnage d’astronaute contaminé dans Le Monstre – et où l’on remarque que Val Guest avait des interprètes fidèles) est impressionnante, notamment dans l’une des séquences les plus marquantes du film, cette magnifique fuite avec Geoffrey Bayldon, l’officier américain (héroïque, dans un probable tribut à l’action américaine pendant la guerre, car rappelons que la Hammer est une firme anglo-américaine pendant cette période), tous deux traversant un lac brumeux jusqu’à épuisement.
The Camp on Blood Island bénéficie d’un rythme particulièrement sec, ne s’épanche jamais dans le lyrisme ou le pathos, presque épuré dans ses moments tragiques. Malgré sa séquence d’ouverture, la représentation de la violence y est sobre, et l’ensemble est finalement peu racoleur. Une heureuse découverte exhumée ici.
Yesterday’s Enemy (Val Guest, GB, 1959)
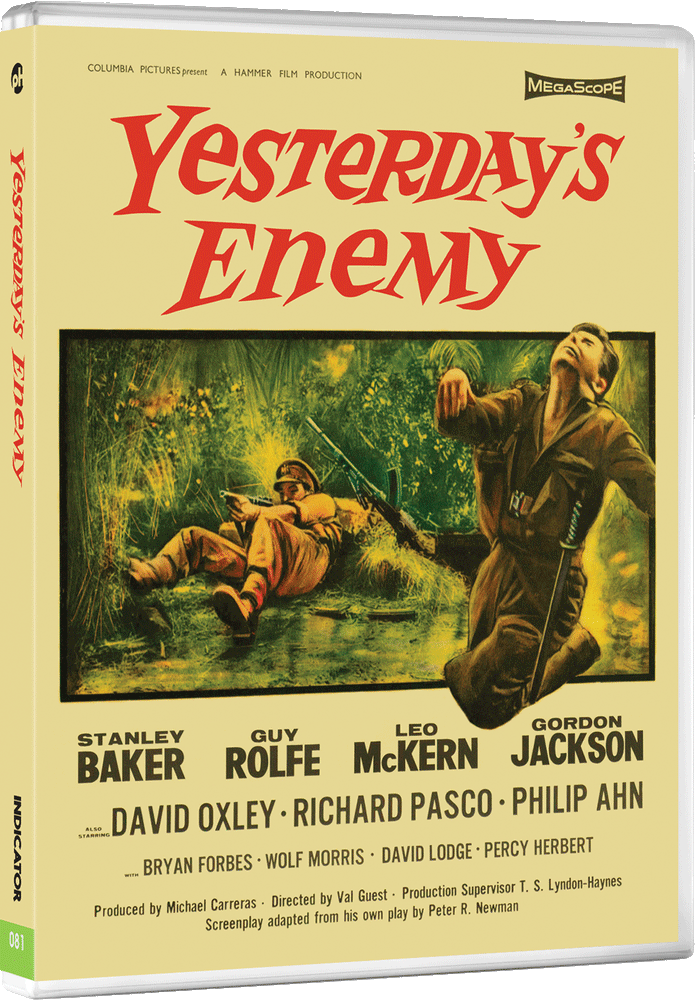
Si Yesterday’s Enemy paraît aussi indissociable de The Camp on Blood Island (réalisé l’année précédente, également par Val Guest), c’est parce qu’il complète le diptyque tout en en constituant le parfait négatif, l’antidote, même. Le réalisateur et son équipe semblent mettre en scène Yesterday’s Evening en ayant parfaitement retenu les leçons du précédent film ainsi que les griefs justifiés qui leur avaient été adressés, reprenant un à un les points litigieux comme un acte créatif de contrition. De fait, là où The Camp on Blood Island penchait vers la caricature et le patriotisme et se jetait dans un suspense de la lutte héroïque, du combat contre l’opposant, Yesterday’s Enemy ne souffre aucune ambiguïté quant à une quelconque utilité de la guerre ou un idéal militaire lumineux. La guerre est atroce, détruit l’humanité qui est en l’homme et le transforme en monstre. Les héros n’existent plus, ou alors ce sont ceux qui, dans un renversement de la représentation habituelle du combattant, s’insurgent contre elle et dénoncent son absurdité.
Le film prend ainsi de la hauteur avec son sujet pour emprunter un sentier métaphysique, sur le sens du devoir, du rapport de l’homme à son existence et le dilemme entre destins individuel et collectif. Combien d’individus doit-on sacrifier pour en sauver plus encore ? Qui s’arroge le droit de décider de qui doit mourir ?
Tiré d’un scénario originellement écrit pour un téléfilm diffusé sur la BBC en 1958, Yesterday’s Enemy prend la forme d’un huis-clos, et sans mauvais jeu de mots, aux motivations presque sartriennes, d’autant qu’il enferme les individus dans leurs questionnements, leurs dilemmes moraux, leur douleur. Pas étonnant que ces personnages ainsi poussés dans leurs retranchements, dans leurs choix, dans cet espace confiné, aient ensuite pris vie au théâtre, en 1960. Curieusement, Yesterday’s Enemy ne souffre pas du caractère étriqué du décor, et trouve au contraire un vrai souffle cinématographique, donnant l’occasion à Val Guest d’exceller dans une mise en scène à la fois très mobile et très épurée, bénéficiant d’un très beau découpage. D’une sobriété exemplaire, le film observe une sécheresse fuyant l’épate : Val Guest, c’est l’efficacité, le quasi effacement au service de son histoire. Le parti pris d’une absence de musique avec comme unique mélodie celle de la jungle environnante, immerge le spectateur, renforce les silences, et rend l’atmosphère plus pesante. Présageant du cinéma de Terrence Malick, le bruit de la nature, des oiseaux lorsque le vacarme des armes cesse, intervient alors comme un douloureux contrepoint.
Soulignons également une distribution éclatante. Le génial Stanley Baker, tour à tour terrifiant et bouleversant, offre une puissance peu commune au personnage du capitaine Langford, aveuglé par sa mission, mais qui laisse lentement entrevoir ses failles et ses doutes sous la carapace. Il fallait un acteur de cette trempe pour susciter un tel trouble. Et tous sont au diapason.
- Capture d’écran Blu-Ray © Powerhouse
- Capture d’écran Blu-Ray © Powerhouse
Yesterday’s Enemy renvoie parfois à la grandeur humaniste et pacifiste du cinéma japonais et en particulier du Ichikawa de La Harpe Birmane ou de Feux dans la plaine, chantant la tristesse des morts plutôt que les louanges du combat. Anti-manichéen, il offre en outre un personnage d’officier japonais d’une complexité que n’avait pas osée David Lean, affirmant à son homologue anglais qu’il aurait préféré lutter à ses côtés plutôt que contre lui, évoquant son amour de la culture anglaise. Rigoureusement soumis aux mêmes dilemmes que son adversaire de faire exécuter des hommes pour obtenir des informations, l’officier Yamazuki se révèle plus intraitable encore. Protagonistes d’une situation en miroir, où le questionneur se retrouve à son tour questionné, les deux hommes sont renvoyés dos à dos, annihilant le concept même d’ennemis. Tous ne sont que des instruments de l’immense machine du pouvoir, ni plus ni moins que de la chair à canon. Sans compter la population locale subissant les revers de la guerre. Anglais ? Japonais ? « C’est la même chose », lance une jeune birmane désemparée.
Tout Yesterday’s Enemy est contenu dans son titre, reprenant l’expression d’un personnage écœuré dénonçant l’hypocrisie des chefs militaires et politiques. Il pourra toujours y avoir des commémorations, de belles couronnes, de beaux monuments aux morts : ce ne sont que des impostures érigées par les nations pour s’acquitter de leurs crimes, en toute bonne conscience. Une formidable œuvre humaniste à redécouvrir d’urgence !
The Stranglers of Bombay (Terence Fisher, GB, 1959)
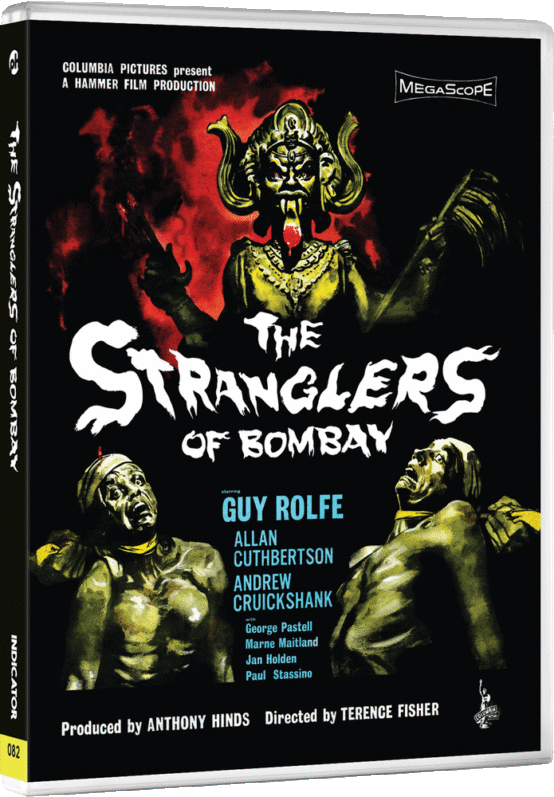
The Stranglers of Bombay pourrait se définir comme une œuvre d’aventures coloniales dans la lignée des œuvres de Zoltan Korda (genre dans lequel s’illustra notamment l’acteur Sabu) réalisées dans les années 40 comme Les Quatre plumes blanches ou Alerte aux Indes. Ils y chantaient les louanges des héros britanniques, les décors exotiques de la fin du XIXe siècle créant cette atmosphère toute particulière d’un cinéma anglais en pays conquis, au point d’en constituer un sous-genre. De fait, il est inutile d’attendre ici une quelconque remise en cause de la colonisation anglaise mais l’ambition de raconter une histoire haletante qui rappelle Kipling, voire certaines nouvelles de Stevenson. Aussi génial soit l’auteur de Kim, du Livre de La Jungle ou de L’homme qui voulut être roi, sa position n’en demeure pas moins ambiguë, notamment par ses héros condescendants face à ses serviteurs et inférieurs, trouvant chez Fisher un écho quelque peu plus humaniste. L’évolution des mentalités à l’époque ne permet pas au spectateur du XXIe siècle de juger de telles œuvres avec un esprit contemporain. Il convient toujours de les recontextualiser. Fisher n’aimait pas beaucoup son film, peut-être en partie à cause de cette morgue britannique qui en ressort et son héros parfaitement intégré au système (interprété par Guy Rolfe, vu également impeccable dans Yesterday’s Enemy), au service de la couronne, aimant son serviteur soumis et celui-ci lui rendant son amour dans son extrême dévotion. Ces réserves mises à part, The Stranglers of Bombay frappe par la maitrise de sa mise en scène et son sens du récit, mêlé à certaines extravagances du montage, un parti pris étonnant de l’ellipse, y compris dans les forts moments de suspense.
Fisher infuse dans son film un certain trouble sexuel à travers ce personnage de femme silencieuse, interprétée par Marie Devereux, qui n’apparaît régulièrement la poitrine en avant que pour jeter un sourire maléfique à chaque mise à mort : cet objet d’érotisme face à la douleur, parfaitement sadien, qui révèle l’aspect charnel de la mort, est fort déroutant. Il faut croire que ces visions furtives énigmatiques et hypnotisantes ne laissèrent pas indifférents l’ordre moral et la censure US qui les coupa purement et simplement. Elles ne seront pas les seules : sans sombrer dans la complaisance, la cruauté pointe son nez de manière assez surprenante encore aujourd’hui à travers les sévices infligés aux victimes ou esclaves des adorateurs de la déesse Kali : mains coupées, langues tranchées, yeux crevés et autres mutilations. La vision de ses visages souffrants possède une sacrée force d’évocation.
- Capture d’écran Blu-Ray © Powerhouse
- Capture d’écran Blu-Ray © Powerhouse
Le choix de Fisher à la réalisation pourrait paraître a priori inapproprié (c’était Val Guest qui était envisagé à l’origine) alors qu’il venait de réaliser les fantastiques Frankenstein s’est échappé (1958) et Le Cauchemar de Dracula (1959), et pourtant il apporte indéniablement sa patte onirique, plongeant parfois The Stranglers of Bombay dans l’étrangeté, au détour de certaines séquences hallucinantes aux lisières du fantastique lorsque les étrangleurs agissent. Rien d’étonnant à ce qu’une mangouste sauveuse intervienne alors comme un leitmotiv poétique et féérique. Car, plutôt classique dans son déroulement linéaire, The Stranglers of Bombay finit par se regarder comme un conte. Fisher glisse parfois avec délectation dans l’irréalité, ouvre une brèche, une porte sur l’ailleurs, comme une autre dimension qui le rapproche des productions Val Lewton. Une des plus belles séquences restera celle du massacre par les étrangleurs de toute une caravane. Des survivants temporairement épargnés sortent de leur tente et découvrent des corps aux allures de dormeurs, avant de s’apercevoir qu’ils traversent un champ de cadavres. La déambulation de ces quelques malheureux regardant la mort avant de la subir est d’une splendeur terrifiante.
Comme le fit Tourneur avec I walked with a zombie, en quelques petites touches, le réalisme s’évanouit et le rideau tombe sur le songe. On a beau savoir que cette secte d’assassins a existé dans les années 1830 et que le film en restitue les méfaits avec le plus d’exactitude possible, la part occulte des adorateurs de Kali prend le dessus et invite le spectacle de l’autre monde.
The terror of the Tongs (Anthony Bushell, GB, 1961)
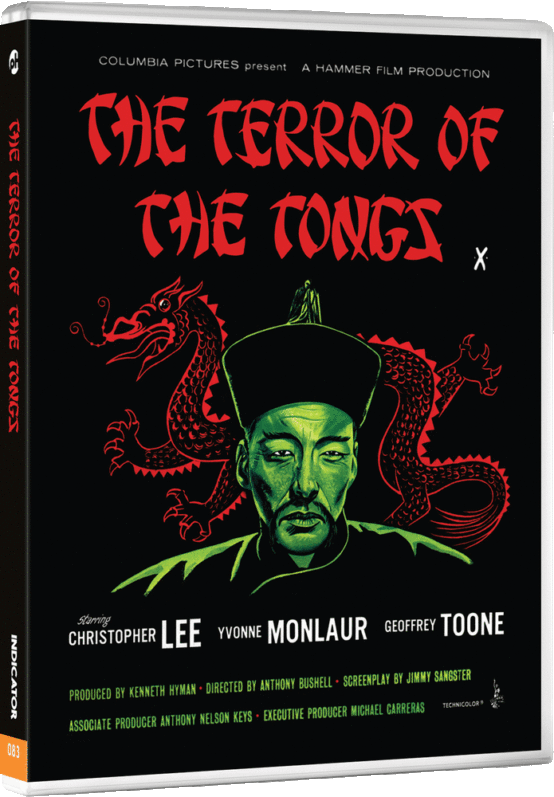
Lorsque la Hammer produit La Terreur des Tongs, en 1961, sa réputation en termes de spécialiste de l’horreur gothique est déjà forgée, après les succès remportés par les relectures des grands mythes fantastiques que sont The Curse of Frankenstein (1957), Dracula (1958) ou The Mummy (1959). Mais en cette fin d’année 59, la firme britannique avait déjà pris un tournant lorgnant du côté de l’horreur mâtinée d’exotisme, avec The Stranglers of Bombay, réalisé par Terence Fisher. C’est également dans cette veine que s’inscrit The Terror of the Tongs, signé Anthony Bushell. Également acteur, ce dernier est aussi connu pour son rôle dans la série de la BBC Quatermass and the Pit (1958-59), qui donnera naissance à un film Hammer en 1967 (de la même manière que The Quatermass Experiment en 1955 et Quatermass II en 1957, tous deux réalisés par Val Guest, furent tirés, peu de temps après leur diffusion, des séries télévisées écrites par Nigel Kneale).
Point de personnage mythique ni de science-fiction ici, mais au contraire un contexte historique avéré : l’existence d’une société secrète chinoise née dans le courant du 19ème siècle et affiliée au crime organisé, les Tongs. Principalement établis dans les quartiers chinois du sol américain, c’est ici à Hong-Kong, alors colonie britannique (au moment de l’action, soit au début du 20ème siècle, mais aussi au moment de la sortie du film) que se situe l’intrigue du film de Bushell.
Le scénariste Jimmy Sangster, justement auteur des scenarii gothiques précités, construit autour de ce climat de peur et d’exactions criminelles souterraines, d’abord abordées sous le prisme de la légende, du mythe effrayant d’une terrible société occulte dont personne ne veut parler ou même reconnaître l’existence, une histoire dont les ressorts ressemblent à ceux de The Stranglers of Bombay. Autre temps, autre lieu, mais en commun un officier britannique évoluant en milieu exotique et cherchant à résoudre une affaire criminelle et à démanteler non plus une secte tout entière dévouée à l’adoration d’une déesse, mais une bande de malfrats parfaitement infiltrée et auparavant jamais menacée, menée par… Christopher Lee. Cependant, si la motivation du capitaine Lewis dans The Stranglers of Bombay émanait d’une empathie face au désarroi des autochtones face à la mystérieuse et régulière disparition des leurs, le moteur du capitaine Sale dans The Terror of the Tongs découle directement d’une affliction personnelle, source d’un désir de vengeance : l’assassinat de sa fille, malencontreusement en possession d’un document convoité par les Tongs, ce qui lancera ce père en plein deuil à leurs trousses.
Avec ce film, la Hammer s’illustre dans le genre du film d’aventures exotiques, au ton très « Tintin », fort d’une ambiance totalement couleur locale. Fabriquée de toutes pièces, elle s’attache autant à recréer le contexte historique servant de base à l’intrigue qu’elle s’avère parfaitement représentative de la notion de « péril jaune ». Sans doute encore prégnante au début des années 60 suite aux conflits mondiaux, cette peur née au tournant du début du 20ème siècle que les peuples d’Asie dominent les Blancs et règnent sur le monde induit ici une forme de racisme au travers de la caractérisation outrée des personnages asiatiques, tous incarnés par des interprètes occidentaux grimés et adoptant un fort accent. Ils sont d’ailleurs plus ici des véhicules de la notion de criminalité que de véritables personnages identifiés. Décrits à gros traits et formant une masse indistincte autour de leur chef, bénéficiant lui d’une plus grande épaisseur scénaristique, encore rehaussée par l’aura naturelle de Christopher Lee, ils constituent sans plus de subtilité le bataillon des méchants Chinois donnant du fil à retordre à notre valeureux et héroïque colon britannique en proie à de terribles dangers.
En lien avec ce caractère exotique, la noirceur des faits est relatée avec un ton enlevé, voire haletant. Le rythme est précis et l’ensemble s’avère très bien mené. L’efficacité narrative de la Hammer trouve ici une belle déclinaison, avec un récit classique, presque romantique, comme les affectionne la firme, qui suit finalement les mêmes ressorts fantastiques que dans leurs œuvres gothiques, soulignés aussi par une belle photographie. Le sens du mystère, du fantasme, entourant l’ensemble, le rapproche d’une manière générale du cinéma fantastique (forces obscures, méchants aux pouvoirs étranges, crimes inexplicables et poisons violents, archétypes du cinéma d’épouvante). On notera d’ailleurs que le compositeur de la musique du film n’est autre que James Bernard, comme pour Dracula.
- Capture d’écran Blu-Ray © Powerhouse
- Capture d’écran Blu-Ray © Powerhouse
Le vampire venant s’introduire la nuit dans la chambre d’une jeune fille est ici remplacé par les Tongs, à cette bifurcation près que chez Dracula, elle aurait sans doute été l’héroïne principale apeurée puis sauvée. Le rôle central féminin revient à l’Eurasienne Lee, interprétée par la française Yvonne Monlaur, également appréciée dans Les Maîtresses de Dracula en 1960. Une émotion toute particulière se dégage de son personnage, servante vendue très jeune à un membre des Tongs, saisie ici dans un mouvement d’émancipation, à la fois rebelle et amoureuse sacrifiée. Elle incarne une figure plutôt insaisissable, un très beau personnage réservant de jolis et douloureux moments.
Cette finesse-là laisse finalement apparaître la nuance générale de l’ensemble. On remarquera d’ailleurs la représentation de quelques « gentils » asiatiques ne rentrant pas dans le schéma global et luttant contre les Tongs. De plus, dépassant le manichéisme bel et bien évident du bon héros dont on espère la victoire, le personnage du chef des Tongs incarné par Christopher Lee apparaît lui-même comme un pion dans cet échiquier. Loin d’un vil félon écrasé sous ses traîtrises et sa cruauté, ses actes font simplement partie d’une guerre stratégique. Il fera d’ailleurs preuve d’une dignité exemplaire face à sa propre mort.
Au-delà de ce que l’on peut reprocher instantanément à cette Terreur of the Tongs (ses stéréotypes, son racisme sous-jacent), on peut enfin aussi y lire une critique en filigrane de la place du conquérant en terre d’Orient et de l’Angleterre toute-puissante, à la gloire de la Couronne. Il est plusieurs fois fait allusion au fait que toutes ces luttes fratricides et la naissance de ces factions terroristes sont bel et bien l’œuvre de la politique de l’Angleterre. Et si, sous l’apparence d’un petit film à suspense (horrifique, qui plus est) parfaitement mené se dissimulait une belle œuvre soigneusement cryptée à redécouvrir ?
Technique et bonus
Les copies proposées dans ce coffret sont somptueuses, magnifiquement restaurées, respectant le grain de l’époque, et surtout intégrales. Powerhouse a fait le maximum pour offrir toutes les versions disponibles, l’américaine et l’anglaise lorsque différentes. C’est d’autant plus intéressant sur Les Etrangleurs de Bombay, qui pour la première fois nous offre la version la plus complète possible en réintégrant les fameuses scènes avec Marie Devereaux, avec leur tension érotique inouïe.
Pour les suppléments, c’est le paradis. Powerhouse peut rivaliser sans peine avec les éditions Criterion, tout d’abord avec de riches livrets de 40 pages regroupant analyses critiques, comparaisons entre les livres et leur adaptation, mises en perspective historiques ou encore compte-rendus des critiques de l’époque. Les riches bonus sont conçus de la même manière sur chaque film avec des commentaires audio, quatre modules écrits et réalisés par Marcus Hearn, et racontés par Claire Louise Amias, avec la participation des historiens du cinéma Alan Barnes et Jonathan Rigby expliquant la genèse du film, le contextualisant dans l’histoire de la Hammer en évoquant également sa réception critique à l’époque. Les « Hammer’s women » quant à eux s’attardent chacun sur une actrice du film en particulier : Mary Merrall (The Camp on Blood Island), Edwina Carroll (Yesterday’s Enemy), Jan Holden (The Stranglers of Bombay) et Yvonne Monlaur (The Terror of the Tongs). D’autres sujets viennent compléter le programme, comme des analyses d’universitaires sur les films. Par exemple, Steve Chibnall évoque la carrière de Val Guest et son évolution, et comment il est arrivé sur The Camp on Blood Island. Il analyse également Yesterday’s Enemy et ses différences avec son embarrassant prédécesseur. Le compositeur David Huckvale étudie quant à lui le travail de James Bernard sur The Terror of the tongs et The Stranglers of Bombay. Ou encore, Richard Falcon précise à quoi s’est attaquée la censure dans The Stranglers of Bombay. Le réalisateur Brian Trenchard-Smith présente durant quelques minutes The Stranglers of Bombay en commentant sa délectable bande annonce. Sont également proposés quelques entretiens rétrospectifs de membres des équipes qui se remémorent les tournages : techniciens, directeurs artistiques, costume designers, assistants directeurs … Enfin, galeries d’images et bandes annonces viennent compléter le tout. Difficile de faire plus complet. Le genre d’édition qu’on peut être amené à consulter régulièrement pour y puiser de précieuses informations.
Coffret édité par Powerhouse films
Les films possèdent des sous-titres en anglais uniquement.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).