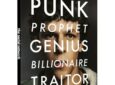World War Z 2, que David Fincher devait réaliser, a été annulé ce qui n’est pas forcément un mal puisque le réalisateur planche sur un projet des plus alléchants : un biopic portant sur Herman Mankiewicz, frère de Joseph et scénariste de Citizen Kane. En attendant, Fincher n’a pas chômé et sort aujourd’hui la deuxième saison de Mindhunter, qui lui permet de poursuivre l’exploration de son genre de prédilection, le film de serial killer.
Si ce genre, chez Fincher, semble renvoyer de prime abord à Seven ou Zodiac, difficile de ne pas considérer que la créature d’Alien 3 est elle-même une tueuse en série ou que le Mark Zuckerberg de The Social Network est un sociopathe qui élimine, virtuellement et tour à tour, toutes ses relations.
Avec Gone Girl, il examinait de près une crise sociale et identitaire, la crise d’une époque où la réalité télévisuelle avait pris le pas sur la vérité du monde. Retour, donc, sur un film où Fincher dépeint une tueuse d’un genre tout particulier, sorte de mante religieuse assassinant, virtuellement ou pas, mais systématiquement, ses conquêtes : Amy Dune.
 Copyright Twentieth Century Fox
Copyright Twentieth Century Fox
Film noir, Gone Girl est avant tout affaire de meurtre et de manipulation. La mise-en-scène, toute en sobriété, déroule une succession de séquences en apparence anodines. Dont deux scènes de baiser, deux clichés, qui se font écho : la scène où Nick effleure la lèvre d’Amy de son pouce puis l’embrasse dans un nuage de sucre, et la scène où, reproduisant le même geste, Nick effleure la lèvre d’Andie puis l’embrasse dans un nuage de neige. Amy, en position de voyeuse lors de la deuxième scène, y découvre la fausseté de Nick, la pauvreté de son jeu de séduction : il répète le même geste, et c’est là le crime originel de Gone Girl. Alors qu’elle était actrice dans la première scène, elle devient spectatrice dans la seconde, et ce passage de l’état d’acteur à celui de spectateur est la base de la réflexion que nous propose Gone Girl : dans notre monde, le spectacle a vaincu, tout n’est que succession de scènes et répétitions. Le combat d’Amy est motivé par son envie de redevenir actrice de son mariage. Elle exprime très clairement, en voix off, sa vision du couple : c’est faire semblant, s’habiller pour plaire à son mari, prétendre être ce qu’il veut : la fille cool et sexy qui ne grossit pas, ne vieillit pas, la fille fidèle à son image. De son propre aveu, le mariage est le plus parfait des simulacres, et sa déception est immense de voir que son mari ne joue plus le jeu.
Gone Girl apparaît comme un curieux jeu de miroir ; la réalité y semble un amoncellement sans fin d’éclats et de reflets, une superposition éternelle de strates d’irréalité et de couches de subjectivité. Il convient, dans Gone Girl, de gratter, d’essayer d’aller sous la surface des choses. La scène du crime (le salon, la cuisine) est examinée quatre fois.
- Nick rentrant chez lui, découvre la scène.
- Les policiers inspectent la maison.
- Amy explique la scène lors d’un flash-back.
- Les policiers encore. Le luminol révèle une nouvelle vérité, qui s’avérera fausse aussi.
La parfaite petite maison américaine de ce charmant quartier pavillonnaire est stricto sensu, un authentique gouffre à chimères. Si les perspectives se multiplient, il en va de même pour les êtres. Nick a une sœur jumelle, Margo, de sexe opposé, ils sont donc de faux jumeaux. Les parents d’Amy se sont inspirés de leur fille pour créer l’héroïne d’une saga littéraire, qui s’appelle Amy aussi, et dont leur fille est l’involontaire ambassadrice et la rivale éplorée. Amy a donc une sœur jumelle, éponyme, virtuelle, qui lui ressemble en tous points ; au-delà des images, ce sont les êtres qui sont décalqués, reproduits, ramenés à une condition d’avatar, de profil sur un réseau social : c’est une nouvelle donne, avec laquelle il va falloir composer.
Amy, contrairement à Nick, a parfaitement compris cette nouvelle donne, ce monde qui s’est séparé de toute notion de réalité, ce monde où tout doit être digéré par les machines, traduit sous forme de chiffres, et recraché sous forme de spectacle. Les caméras, la télévision sont devenues l’indispensable médiateur entre les êtres, au niveau social comme au niveau intime. Pour leur anniversaire, Amy a offert à Nick un couple de marionnettes et au premier degré, on peut y voir l’image du fait qu’Amy, dans la tradition des femmes fatales, tire les ficelles. Il n’en est, en fait, rien, car au Missouri comme partout ailleurs, une force obscure a vaincu. La victoire promulguée par Gone Girl, c’est celle du capitalisme tel que défini par les situationnistes. Ainsi, Debord disait que « Le « spectacle » est à la fois l’appareil de propagande de l’emprise du capital sur les vies, aussi bien qu’un « rapport social entre des personnes médiatisé par des images. »La télévision, le network, avancent nus dans Gone Girl et apparaissent comme un odieux assassin qui récidive chaque jour et chaque heure, un simulacre masqué qui substitue à notre regard éteint un monde où ne règne pas le sens, mais la contrebande inavouée d’une idéologie.
Ainsi la demeure hi-tech de Desi Collings, homme riche et donc winner, maison bardée de caméras qui filment et enregistrent tout, sorte de parachèvement de l’immeuble chic et cosy du Gang Anderson (S. Lumet). À peine Amy trouve-t-elle refuge dans cet abri qui n’en est pas un, que Desi lui tend un sac, contenant de la teinture, du maquillage, des vêtements : de quoi reprendre l’apparence d’Amy afin de se sentir à nouveau Amy, lui dit-il. Le Scotty de Vertigo, lorsqu’il accompagnait Judie, l’avatar de Madeleine, chez le coiffeur, ne s’y prenait pas autrement. Aucun doute, l’image prend le pas sur le réel, jusque dans les relations intimes des êtres avec eux-mêmes.
« Il faut choisir, mourir ou mentir.
Je n’ai jamais pu me tuer moi. »
Céline, Voyage au bout de la nuit
C’est ce que Nick va devoir apprendre à ses dépens ; il va devoir, lui aussi, opérer son travestissement. À peine apprend-t-on la disparition de sa femme que la télévision s’empare, en toute urgence, de son histoire. Première partie du show : Nick Dunne réagit de manière très détachée à la disparition de son épouse… Erreur de casting ? Une mauvaise prestation de plus et c’est la peine de mort… Son avocat, en bon metteur en scène, lui apprend, avec succès, à jouer le rôle du mari inquiet. Nick doit feindre, lors d’un show télévisé, d’aimer plus que jamais sa femme, afin de renverser l’opinion. Dans le salon de Desi, Amy, vautrée dans un fauteuil confortable, une crème brulée à la main, assiste au spectacle. Elle n’est pas dupe une seconde, bien au contraire, elle est heureuse : Nick a accompli sa métamorphose, il a abandonné toute résistance face à l’image, il sait faire semblant. Il peut prétendre l’aimer, il a l’air convaincant : ils sont désormais sur un pied d’égalité.
 Copyright Twentieth Century Fox
Copyright Twentieth Century Fox
La scénariste Gillian Flynn et David Fincher n’ont jamais caché leur admiration pour Alfred Hitchcock et Gone Girl fourmille de références au vieux maître. Les titres mêmes d’œuvres hitchcockiennes pourraient servir de synopsis à Gone Girl : Nick est Jeune et Innocent (et écrivain tout comme le héros de ce film qui se bat contre une accusation mensongère), Une femme disparait… Mais, avant tout, comme chez Hitchcock, innocence et culpabilité vont de pair dans le film de Fincher. Envers toutes les apparences, le couple formé par Amy et Nick est un parfait miroir, et tous deux apparaissent rapidement comme successivement, puis simultanément, innocents et coupables.
Dans la succession de clichés que propose Gone Girl, une scène saute aux yeux. Une authentique démarque. Une scène de douche. La scène de la douche. D’abord parce qu’elle est purement invraisemblable : il est évident que les autorités n’auraient jamais laissé Amy rentrer chez elle ainsi, c’est-à-dire maculée, pour ne pas dire maquillée, de sang. Premier indice : un plan bref, d’à peine une seconde, où l’on voit le sang mêlé à l’eau s’échapper par la vidange de la douche : impossible de ne pas penser à la salle de bain du Motel Bates.
Tous deux nus comme au premier jour, Nick et Amy parlent enfin. Nick blâme Amy de l’assassinat de Desi. Amy affirme l’avoir fait pour le sauver de la peine de mort, autrement dit : elle a tué pour lui. Elle se lave littéralement de son crime, et le rend à son véritable propriétaire. Dans Gone Girl, on commerce le crime comme à bord du Nord Express. Elle lui demande du shampoing, il lui donne instinctivement, se ralliant inconsciemment à son propos.
Ils se couchent après la douche, elle est tout vêtue de blanc, d’un blanc immaculé de la même teinte que celle du soutien-gorge de Marion Crane dans Psychose. Il est, pour sa part, entièrement vêtu de noir : les choses sont rentrées dans l’ordre, Amy a rendu son crime à son véritable propriétaire. Ils sont tous deux coupables et innocents.
L’innocence semble parfaitement absente du film : tout le monde est corrompu. Coupable, la policière qui a parfaitement compris la manipulation, mais, dépossédée de l’enquête, n’en fera rien. Coupable les médias d’être friands d’irréalité, coupable le public d’avaler leurs mensonges. Coupable l’avocat, incarnation du cynisme, qui se réjouit de la situation et du spectacle : de quoi Nick peut-il bien se plaindre, puisqu’on lui a offert un nouveau contrat, et qu’on prépare un film sur sa vie ? Les affaires reprennent, le commerce va bon train et c’est bien évidemment tout ce qui compte dans le néo-rêve américain. Cette disparition de l’innocence et de la réalité semble précipitée par l’omniprésence de la prise d’images : bon nombre des protagonistes passent à la télé et tous ceux qui n’y passent pas la regardent. Il semble évident, dans le monde de Gone Girl, que les rapports humains ne peuvent plus se passer de son intermédiaire. La vie de Nick ne tient qu’à un fil, celui de sa capacité à devenir un bon acteur télévisuel, car la fiction réelle, celle de notre passé, a disparu au profit de la fiction télévisuelle, forme ultime et prédominante d’entertainment. Les scènes de campement autour de la maison renvoient bien à évidemment au Gouffre aux Chimères de Billy Wilder où l’on assistait déjà au triomphe du spectacle sur le réel, au processus de médiatisation d’un drame, à sa métamorphose en événement télévisuel, à la prise de contrôle par les médias de l’Histoire, à des fins sensationnalistes, à la validation des intuitions de L’Homme qui tua Liberty Valance (John Ford).
 Copyright Twentieth Century Fox
Copyright Twentieth Century Fox
La fiction réelle, c’était celle des écrivains, est bien en peine. Il n’est pas innocent que Nick et Dunne se prétendent tous deux écrivains. A aucun moment, il n’est fait état d’un livre qu’ils auraient écrit ; on sait tout juste qu’ils rédigeraient des tests pour des magazines et que Nick enseigne la littérature (mais laquelle ?). Les parents d’Amy sont les auteurs d’une saga de bandes dessinées à succès : une fois encore, à aucun moment, ils n’inventent, ils ne font que décalquer la vie de leur fille sur papier couché. Dans ce monde d’écrivains qui ne créent plus, la fiction apparait là où on l’attend plus, dans le journal intime d’Amy, autofiction bardée de quelques éléments inventés qui, à eux seuls, renversent toute la lecture de son histoire intime. C’est exactement pareil pour la télévision, qui se permet, çà et là, des incartades qui pervertissent notre lecture de la réalité.
Dans ce nouveau monde, dans cet imparable et permanent décalque de la réalité, Amy navigue à son aise, et Nick vient d’apprendre à jouer selon les règles de cette nouvelle donne. Dans ce nouveau monde, Amy s’est fécondée avec le sperme congelé de Nick ; il n’y a, bien évidemment, plus nécessité de rapport entre les êtres pour procréer. Ils auront donc un enfant et leur premier réflexe est de l’annoncer à la télévision : et là, quelque part dans le ventre d’Amy, ce foetus semble nous contempler, à l’instar de celui de 2001. Il est filmé dès l’état fœtal, avant même d’être décelable aux échographies. Sa vie entière sera soumise au règne des images.
 Copyright Universal Pictures
Copyright Universal Pictures
Fincher, à l’inverse de Psychose, ne tue pas son héroïne à la fin du premier acte, mais l’y ressuscite, comme dans Sueurs Froides. Il faut voir ce fantôme, bien vivant et en cavale (encore un thème éminemment hitchcockien), disposer ses Post-it sur un calendrier : c’est son jeu de plateau à elle, son maléfique jeu de l’oie. Quand, plus tôt, Nick apporte un Mastermind à Margo, celle-ci décline : elle n’aime pas. Ils jouent à un jeu de société qui comprend une roue en guise de dés ; contrairement à Amy, ils obéissent encore au destin. Comme dans The King of Marvin Gardens (Bob Rafelson), le film dans son ensemble apparait comme un vaste jeu de plateau où Amy, plus ou moins maîtresse de son destin, se déplace de case en case. Chaque case étant une image, un plan, un cliché. Une case réalité, où confrontée à deux aigrefins, elle se fait dévaliser (la scène la plus réaliste du film). Une case Marvin Gardens (l’équivalent américain de notre Rue de la Paix) : la maison de Desi… Dans cette succession de cases-images, une démarque : la scène de la douche. Des cases presque identiques, les scènes de baiser.
Et enfin, les cases départ et arrivée, qui ne font, comme au Monopoly, qu’une, dans un drôle de symbole. Une scène d’ouverture et une de fermeture, apparemment identiques : un même plan en caméra subjective, Nick caressant la chevelure d’Amy sur son torse, elle finit par se retourner vers lui, sage enfant à l’air serein et mélancolique. Dans la première scène elle a les cheveux longs, dans la seconde les cheveux coupés. A ce détail près, les images sont identiques. Le discours change peu. Des phrases au présent, innocentes, les phrases banales d’un couple : « Comment te sens-tu ? ». Suivies d’une phrase au passé, plus inquiétante : « Que nous sommes-nous infligés l’un à l’autre ? » mais que l’on peut aussi traduire par « Que nous-nous sommes infligés les uns aux autres ? », Nick semblant s’adresser à l’humanité toute entière. Le futur s’invite dans l’ultime phrase : « Qu’allons-nous faire ? ». Entre ces deux clichés, c’est évidemment tout un monde qui s’est décomposé pour se recréer.
 Copyright Twentieth Century Fox
Copyright Twentieth Century Fox
Gone Girl revendique sa volonté de faire du faux avec du faux et nous expose l’image d’un monde ou la vérité se prostitue sans cesse avec le mensonge. De cette union contre-nature naît une nouvelle réalité, parfaitement déficiente, celle où l’on converse sur internet, où l’on s’informe en contemplant la télévision, où voyant un homme rendu célèbre par la disparition de sa femme et potentiellement par son meurtre, on accourt, armé d’un smartphone, afin de faire un selfie. Dans Fight Club, Fincher s’amusait à insérer des images quasi-subliminales. Gone Girl, il parvient à créer une pure image-mentale, une image parfaitement insaisissable, omniprésente, qui hante longtemps. Car cette image, c’est une image du bout de la nuit, c’est celle de l’espoir jeté au mitard. On ne sort pas indemne d’une première ou troisième vision de Gone Girl, on en sort chargé d’une terrible impression : celle de vivre plus que jamais dans les décombres de la réalité.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).