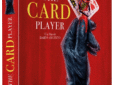Quelques mois à peine après la rétrospective que lui a consacré La Cinémathèque française, les films du Camélia sortent début décembre un coffret consacré à Dario Argento, avec 6 de ses films restaurés (il s’agit des somptueuses restaurations de la cinémathèque de Bologne présentées à l’occasion du cycle de juillet) accompagné du passionnant documentaire que Jean-Baptiste Thoret avait consacré au cinéaste et qui nous avions chroniqué ici-même : Soupirs dans un corridor lointain. ainsi qu’un livre inédit d’Olivier Père de 250 pages intitulés Les 6 visages de la peur.
Les six films composent un parfait condensé pour comprendre la démarche de ce grand formaliste pour lequel le genre fut in fine plus une coïncidence qu’une volonté. En effet, lorsque le cinéaste s’exprime dans sa passionnante autobiographie, l’épouvante, l’art de la peur tel qu’il les exprime dès son premier éclat sur un écran reflète moins le désir de s’inscrire dans un mouvement que de transmettre son amour esthétique et intellectuel pour les écrivains, les peintres, les cinéastes dont les oeuvres trahissaient leurs propres angoisses. C’est finalement tout à fait spontanément qu’Argento se tourne vers un cinéma graphique, dont l’épouvante traduit ses hantises intimes, de celles qui débutèrent avec ses cauchemars enfantins pour le poursuivre dans des terreurs adultes. Paradoxalement, en regardant de plus près son cinéma souvent critiqué voire censuré pour sa grande violence, transparaît la douceur d’un auteur infiniment mélancolique. Il faut observer le cinéma d’Argento au-delà de sa texture première, comme l’expression de l’artiste tentant de retranscrire son rapport au monde à travers ses fantasmes cinématographiques, les voyages qu’il offre à un spectateur à la fois terrorisé et hypnotisé. Le plaisir de l’abîme.
Après quelques années dans le journalisme et avoir co-écrit ll était une fois dans L’ouest, Dario Argento va réaliser un L’oiseau au plumage de cristal (1970), aussi matriciel en matière de giallo que le fut 6 femmes pour l’assassin de Mario Bava puisqu’elle signe le début de tous les films aux titres animaliers biscornus qui suivront avec plus ou moins de bonheur. Argento y développe déjà un sens de l’espace cadre devant tout autant à Antonioni qu’à De Chirico qui enveloppe une délirante intrigue s’échappant d’Hitchcock en nous faisant passer à travers le miroir – presque au sens propre puisque dès lors que le héros se retrouve coincé entre deux vitres d’une galerie d’Art, c’est quasiment dans un autre monde qu’il pénètre. Cet entre-deux du giallo argentesque, permet au réalisme policier de glisser dans le fantasme. Pour cette raison, le monde d’Argento, dont l’intrigue racontée pourrait être identifiée au réél – avec ses tueurs en série – s’apparente très rapidement à l’empire du rêve. Les siens qui parlent aux nôtres. L’aventure se poursuit avec Le chat à neuf queues (1971) qui obéit plus aux conventions d’un suspense à l’anglo-saxonne – Agatha Christie et Ellery Queen ne sont pas loin -, en apparence plus calme, plus classique. Si de la trilogie animalière, Le Chat a 9 queues est celui qu’il aime le moins, il n’en demeure pas moins d’une grande beauté, comme si Argento après avoir démarré en fanfare dans le formalisme échevelé jouait la carte de l’épure. Le cinéaste se montre à la fois capable de raconter une histoire et de peaufiner son rapport au regard – de la cécité à la vérité et sa preuve passées sous nos yeux sans que nous ayons su la regarder. C’est cette thématique même qu’il va sublimer dans Profondo Rosso (1975) atteignant probablement un sommet indépassable, et qui vient peaufiner cette idée de perception impossible. Rien d’étonnant à ce que David Hemmings en soit le protagoniste principal, tant il prend la suite du photographe de Blow Up face au mystère du meurtre dont on se demande s’il avait vraiment eu lieu. Argento interroge ici notre rapport à la réalité, au fonctionnement même de notre cerveau face à ce qui imprime notre rétine (dommage que le magnifique Quatre mouches de velours gris n’y figure pas, car cette idée de mémoire visuelle y est fabuleusement prégnante, jusque dans son concept post-mortem) et égare notre raisonnement. Distrait, égaré, l’homme se condamne à être aveugle, et sa quête du meurtrier se fait existentielle. Avec Blow Out, De Palma viendra clore cette trilogie informelle inaugurée avec Antonioni, le personnage joué par John Travolta ne s’attachant plus à déconstruire le champ visuel, mais sonore. Avec Ténèbres (1981) Argento réalise une sorte de giallo ultime qui s’approche du méta, même si en matière de mise en abyme il franchira un pas supplémentaire avec Opéra. Il y a quelque chose de singulièrement vengeur dans la cruauté de Ténèbres, au titre reprenant celui du livre policier dont s’inspire l’assassin. La boucle est bouclée, l’Art peut définitivement tuer, concrètement, même à l’instar de son incroyable séquence finale. La malice dissimule sa colère, dans un humour cruel fou où Argento répond génialement à ses détracteurs, à ses ennemis les journalistes qui l’accusaient d’avoir l’âme d’un tueur pour mettre en scène de telles perversités. Il s’en donne à cœur joie à les prendre au pied de la lettre, tout en intégrant un autre traumatisme, celui du cinéaste victime d’un fan fou en voulant à sa vie après avoir un peu trop regardé Suspiria. L’ultime pied de nez de Ténèbres est sans doute de laisser présager des éclairages les plus sombres lors que c’est probablement son film le plus diurne, presque surexposé … où le blanc immaculé se souille évidemment vite de sang. Ténèbres proclame Argento comme un génie impur qui ne recule pas devant la trivialité. Phenomena marque quand à lui une véritable transition dans sa filmographie. S’il semble répéter la forme du conte de fée horrifique de Suspiria, il trahit surtout un vrai pessimisme en cette confrontation de l’innocence à la laideur universelle. Jennifer arrive dans un institut pour jeunes filles, comme avait pu le faire Suzy dans une école de danse. Mais il y avait une forme d’enchantement de château hanté en 1975 qui ne peut plus fonctionner en 1984. Communiquant avec les insectes, l’héroïne par sa nature se distingue, s’exclut… et donc s’extrait du monde et de la réalité. Rejetée, maltraitée par ses camarades, montrée du doigt comme un monstre par l’institution, elle ne doit finalement sa survie qu’à ce don, et à la rencontre avec un professeur entomologiste tout aussi solitaire qu’elle. Désormais pour Argento, le lot de tout individu pensant, c’est la fuite dans la poésie, dans l’amour de la nature. L’étreinte avec un chimpanzé en dit beaucoup sur le chaos contemporain : mieux vaut compter sur les animaux que sur ses congénères. Phenomena demeure paradoxalement le film le plus poétique, le plus cruel et le plus tendre d’Argento. Oui, l’héroïne argentesque évolue à partir de Phenomena. Et j’ai tendance à considérer que c’est un même visage dont le changement, la mutation se poursuit dans Opera, Trauma puis Le Syndrome de Stendhal (Voir dossier). Opera pousse donc sa réflexion sur l’œil à son terme, en opérant de variation en variation autour du thème du regard inscrit dès son argument de départ : une jeune diva d’opéra y est régulièrement séquestrée par un meurtrier qui l’oblige à regarder ses crimes en lui collant des aiguilles sous les yeux. C’est également à nous qu’il s’adresse, à notre propre rapport à son théâtre de la cruauté, à nous demander si, nous, garderons les yeux ouverts. Opera est un giallo qui confine à l’expérimental, dans lequel Argento se lâche formellement comme jamais, la caméra tourbillonnant, virevoletant, testant rigoureusement tout ce qu’elle peut. Argento était dans une période dépressive qui transparait à chaque image du film : l’existence est invivable, les humains ne communiquent plus mais se torturent et vivent avec leurs traumas, les relations sont stériles, et lorsque les êtres font l’amour, c’est sans le moindre plaisir. On préférera parler aux lézards que se confronter aux relations humaines. C’est aussi une œuvre où l’incohérence est reine, érigée en tant que règle, comme si la folie qui s’immisçait en Betty contaminait le film lui-même.
Ce beau coffret nous invite à nous replonger dans la spirale poétique d’Argento, entre la psyché, l’œil et les ténèbres.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).