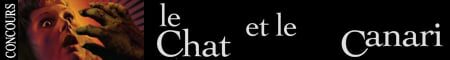« Ode au désert »
Les anciens disaient que Jauja était dans la mythologie une terre d’abondance et de bonheur. Beaucoup d’expéditions ont cherché ce lieu pour en avoir la preuve. Avec le temps la légende s’est amplifiée d’une manière disproportionnée. Sans doute les gens exagèrent, comme toujours. La seule chose que l’on sait avec certitude, c’est que tous ceux qui ont essayé de trouver ce paradis terrestre se sont perdus en chemin
Ainsi s’ouvre Jauja de Lisandro Alonso, avec un carton qui inscrit d’emblée la quête, l’illusion et l’égarement au cœur du projet visuel et spirituel du film. Réagissant à la difficulté de certains journalistes à prononcer le titre du film, Viggo Mortensen, son acteur principal, précise que Jauja est un mot qui sonne étrangement, même en espagnol. Tout concourt donc à faire de ce film, jusque dans son titre, un objet insolite et mystérieux.
Ce dernier opus marque un véritable tournant dans le cinéma du réalisateur argentin, tout en entretenant des liens très forts avec ses précédents films. Comme dans Los Muertos (2003) ou Liverpool (2009), Jauja s’articule autour de la question des liens familiaux et du déplacement et met en scène un homme parti à la recherche d’une femme. Mais Lisandro Alonso donne une impulsion nouvelle à son œuvre en travaillant avec Timo Salminen, le directeur de la photographie d’Aki Kaurismäki et en dirigeant pour la première fois des acteurs professionnels, évolution radicale qui a fait dire au créateur de Jauja qu’il avait eu l’impression de faire son premier film. Le réalisateur a su bien s’entourer si l’on en juge par l’incroyable photographie du film et par la performance époustouflante de Viggo Mortensen, par ailleurs coproducteur et compositeur de la musique du film. On peut aussi parler d’une expérience collective puisque Jauja est le fruit d’une étroite collaboration entre Fabiàn Casas, poète argentin et Lisandro Alonso.
L’intrigue se déroule en 1882 en Patagonie, pendant la Conquête du Désert. Récemment arrivé du Danemark, le capitaine Dinesen vit avec sa fille Ingeborg dans un avant-poste reculé. Il est à la tête d’une compagnie de soldats qui travaillent à la construction de la tranchée d’Alsina et a pour mission de mater les groupes d’Indiens rebelles. Si le capitaine éprouve le mal du pays, sa fille, elle, se plaît dans ce milieu sauvage. Alors que Dinesen veille à la protéger de l’appétit sexuel des hommes qui l’entourent, Ingebord s’échappe une nuit avec un jeune soldat dont elle est tombée amoureuse. Commence alors une quête solitaire et désespérée pour le capitaine, qui s’enfonce toujours plus loin dans le désert pour retrouver sa fille.
Par son cadre grandiose, son univers viril et son sujet, Jauja n’est pas sans entretenir une certaine familiarité avec le western. Grand admirateur de John Ford, le réalisateur argentin affirme n’avoir pas vu La prisonnière du désert (1956) dont la trame évoque celle de Jauja. Toutefois, c’est sous une forme inédite, celle du western poétique et philosophique, que le film décline le genre. Outre cette filiation apparente, on peut également voir dans le film de Lisandro Alonso un croisement inattendu entre Aguirre de Werner Herzog et Gerry de Gus Van Sant. Jauja transplante de l’Amazonie à la Patagonie l’exploration d’une contrée hostile par un père et sa fille, mise en scène dans Aguirre. Quant à Gerry de Gus Van Sant, qui – coïncidence troublante – fut tourné dans le désert en Argentine, il représentait déjà une perte de soi confinant à l’expérience métaphysique. En dépit de ces affinités, Jauja ne ressemble à rien de connu tant il innove par sa forme et surprend par sa liberté radicale. Le film tire son origine d’un épisode personnel de la vie de Lisandro Alonso. L’assassinat tragique d’une amie aux Philippines a poussé le réalisateur à faire un film qui répondrait à la question suivante : « Que se passe-t-il quand on est dans un endroit équivoque par rapport à notre trajectoire ? ».
Dans Jauja, le réalisateur entrelace les motifs de la quête et de la perte à travers le parcours du héros. A la recherche de sa fille, le personnage incarné par Viggo Mortensen perd ses repères et ses certitudes, au gré d’un parcours qui l’entraîne vers un but de plus en plus incertain. La quête de l’autre tourne à la quête de soi au fur et à mesure que « le désert s’insinue en [lui] ». En même temps que le héros collecte des indices qui semblent attester du passage de sa fille dans les lieux qu’il traverse, il s’allège progressivement de ses effets personnels, se faisant voler tout à tour son cheval, son arme, son chapeau. Ce dépouillement graduel suggère la vulnérabilité grandissante du personnage mais fonctionne aussi métaphoriquement comme une mise à nu du personnage et de ses fragilités : l’identité de Dinesen se fissure, entamée par le milieu naturel. C’est que le véritable héros de Jauja n’est pas tant le capitaine danois que le désert, étendue inquiétante et changeante, incarnation d’un ennemi sans visage et silencieux, qui engloutit hommes et bêtes sans distinction. Le film semble alors avancer par glissements successifs, amenant de manière concomitante le personnage et le spectateur à explorer un territoire inconnu, à la fois géographique et mental. Ces dérapages continuels, manifestes dans le va-et-vient entre l’espagnol et le danois, dans l’anamorphose des paysages qui se transforment insensiblement, sont emblématiques d’un cinéma du lâcher prise. Le dernier quart du film creuse encore la notion d’égarement et achève de désorienter le spectateur en trouant le récit d’une faille temporelle. C’est au sein d’une grotte, point aveugle où le héros perd pied, qu’a lieu le basculement. Ce glissement d’un paysage tangible vers l’infini du songe souligne l’infinie liberté de Jauja, qui s’autorise la rupture.
Jauja surprend aussi par son rythme, porté par une lenteur hypnotique, et à propos duquel Viggo Mortensen évoque Tarkovski. Ici, le plan commence avant l’action et se termine bien après. Loin de suivre le personnage, la caméra filme de longs plans fixes sur des paysages qu’il traverse et qui le traversent, avant qu’il ne sorte du cadre, comme une silhouette qui s’évanouit. De même, le format presque carré (4/3) avec ses coins arrondis tels de vieilles photographies ne relève pas de la coquetterie dans Jauja mais tranche au contraire avec le western traditionnel. Le format large y évoquait l’avancée et la conquête de l’espace sauvage et indompté. Là, le rapport de l’homme à l’espace est modifié, comme pour montrer l’impuissance des humains à maitriser ce territoire impénétrable. A la profondeur de champ traditionnelle se substitue ici une alternance entre plans larges et gros plans. Ceux-ci révèlent l’âme vivante du désert à travers le mouvement des herbes agitées par le vent, le bourdonnement des insectes, le fond d’un ruisseau.
C’est ainsi que le film de Lisandro Alonso nous invite à une expérience sensorielle et poétique sans pareille. Le spectateur est immergé dans un univers dominé par les éléments puissants et indéchiffrables. Au rythme des saisons, il traverse des décors multiples : du bord de mer à la pampa, en passant par un monde de plus en plus minéral et un paysage de cendre et de pierre. La poésie du film naît d’un jeu de contrastes et d’oppositions : à l’univers en bleu et rouge des premières séquences, au film d’hommes, s’oppose la fin du film – sorte de réveil forestier inquiet et féérique, baigné d’un onirisme féminisé. A la sexualité virile de la première moitié du film répond une fin qui brille d’une autre sensualité, et qui incite à relire Jauja sous un angle différent. Entre ces deux mondes, Lisandro Alonso crée des passerelles souvent représentées par des indices fantasmatiques récurrents qui jalonnent l’enquête de Dinesen et fonctionnent comme des rimes. Tel est le rôle qu’on pourrait assigner au chien Jersey ou aux objets à valeur symbolique, à l’instar du réveil d’Ingeborg ou du petit soldat qu’elle égare, miroir dérisoire du héros égaré dans l’immensité désertique.
En dépeignant la déroute d’un homme et son voyage initiatique semé d’embûches, Jauja sonne comme une variation cinématographique autour des premiers vers de la Divine Comédie. Seul le décor change puisqu’à la forêt « féroce et âpre et forte » de Dante se substitue le désert menaçant. Lisandro Alonso élève le western à la méditation d’ordre cosmique et fait la part belle au mystère. A l’image de la pythie recluse dans sa grotte qui n’est pas celle que l’on croit, Jauja ne livre pas tous ses secrets, parle par énigmes, affirmant ainsi son éblouissante singularité.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).