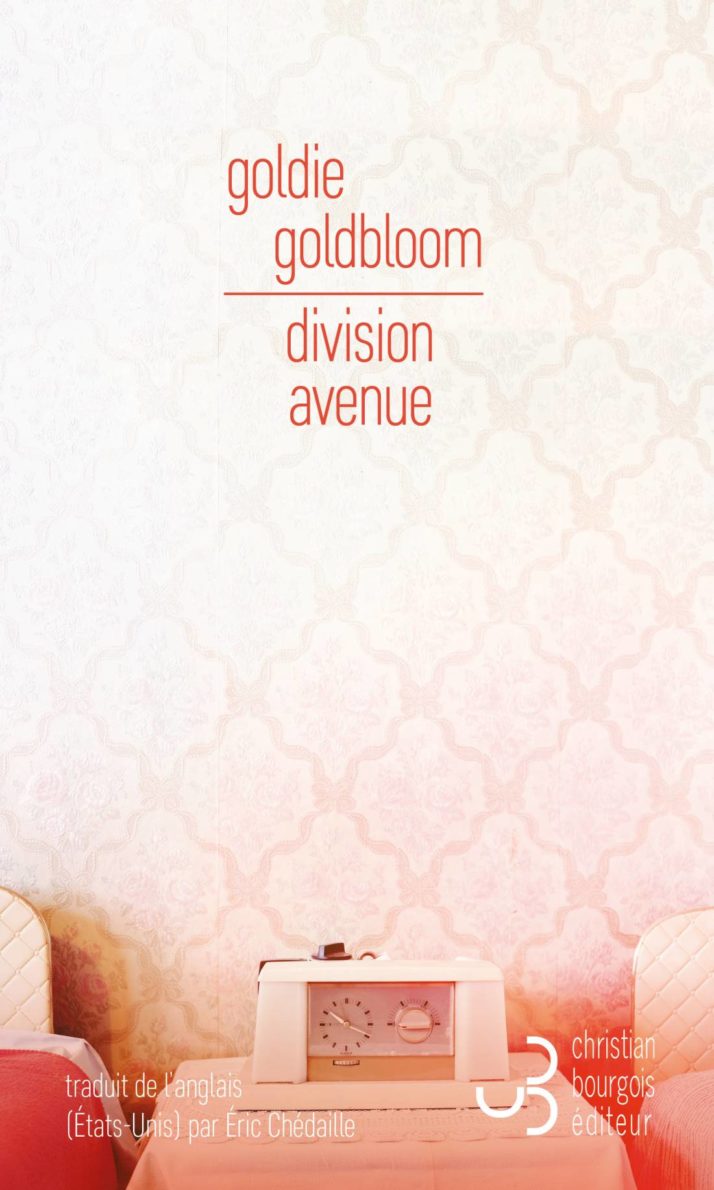A Williamsburg, dans le quartier de Brooklyn, vit une communauté de juif hassidique très pieux, fascinante et close communauté qui suscite pour les personnes extérieures autant de d’envie que de répulsion, aujourd’hui fameuse grâce à la serie Unorthodox sur Netflix, jusqu’à la dégueulasse organisation de Bus tour où on les observe comme au zoo.
Surie Eckstein, 57 ans, est l’une des femmes de ce petit monde. Une femme « épanouie » (les guillemets seront importants), mère de 10 enfants, grand-mère de 32 petits-enfants, obéissante, avec un mari gentil comme tout, rythmant sa vie entre les fêtes, les rites religieux ou sociaux, et le regard des autres et des voisines.
Sauf que voila, Surie, à près de 60 ans, ménopausée, se découvre enceinte. De jumeaux. Et qu’elle décide de ne rien en dire à personne, ni son mari dont elle craint de s’éloigner, ni à quiconque de sa famille, qui se brasse dans l’immeuble où elle vit ou à quelques numéros de là, en un huis clos vertigineux et mortifère.
La sage-femme dit à la femme hassidique : « Vous arriverez à terme le 13 juillet. N’est-ce pas une perspective réjouissante ? »
Surie marqua un temps d’hésitation.
« Non, dit-elle. J’avais espéré avoir enfin un peu de temps pour moi.
— Est-ce que vous n’avez pas déjà des petits-enfants ? Vous devez être très prise de toute façon. Qu’est-ce qu’un enfant de plus dans une famille comme la vôtre ? »
Surie se borna à répondre avec douceur qu’un enfant est un monde en soi.
C’est que son immeuble, joliment, se trouve sur l’artère qui donne son nom au roman touchant de Goldie Goldbloom, Division avenue, et traduit par Eric Chedaille chez les toujours stimulants Christian Bourgois.
Car c’est cette Division (le titre original, d’ailleurs, insiste encore plus dessus, « On Division »), en tant que femme ou en tant que mère, en tant que parole/silence, monde extérieur/interieur, vie/mort, passé/présent, et qui sait rôle/liberté, qui rythmera la traversée comique et tragique, souvent douloureuse de cette femme au bord de la crise de nerfs.
Et de ses fantômes, eux aussi tus : à cette grossesse-ci revient une autre, celle de son sixième enfant, Lipa, homosexuel et atteint du VIH, rejeté par tous et dont le deuil par suicide en Californie doit être tu, parce que n’ayant pas obéi à ce que les autres attendaient de lui (Goldie Goldbloom, juive hassidique est elle-même mère de huit enfant et militante LGBT.), maillon d’horreur sur la famille jusqu’à entacher Gitty, la fille de Surie que personne ne voudra épouser.
Au cours de ces semaines de janvier, Surie essaya souvent d’aborder avec Yidel le sujet de Lipa, puis comme elle n’y parvenait pas, quelque chose l’en empêchant, son anxiété concernant les jumeaux augmenta. Jamais auparavant elle n’avait caché quoi que ce fût à Yidel. Jamais elle ne s’était sentie aussi seule ni à ce point en position de pouvoir. Elle avait un goût de cendres dans la bouche.
- Ce silence qui grandit en soi.
Ce poids du silence est donné dès les prémisses de l’ouvrage, ouvrant le ton doux-amer et écrasant : après une citation d’Abraham et de sa femme Sarah enceinte à 90 ans, dans une grande double page s’étend tout l’arbre généalogique de la famille, fait de dizaines de petits enfants et d’ancêtres, de passé d’exils, de génocide, décimant parents, grands-parents, oncles, sur les plaines de Hongrie ou sur le chemin de Birkenau. Horreur, Histoire et histoire, sur chaque épaule.
Le lecteur goy ne manquera pas alors d’être décontenancé par ce ressassement plaintif, fait de spirales, de retours, percés de dialectes yiddish inconnus qui percent le texte et trouent la pensée : bikkour holim, nachas, Chas vecholila, der Oibershter, kiddouch ou bilkelach.
Et c’est peu dire qu’il faut à première lecture parfois (souvent) s’accrocher, pour continuer les phrases, plonger dans ce roman parfois aussi clos et dépaysant que cette communauté, et ressentir ce flux de pensée, Virginia Woolf chez les hassidims.
Au lecteur, de se déciller, de voir apparaitre les lignes courant sous la bizarrerie des rites, sous les regards d’opprobres impossibles, sous les angoisses spécifiques et universelles. C’est en se sentant à l’écart qu’il le peut : l’histoire de Surie est aussi l’histoire des traits de cet arbre généalogique, de cette impossibilité à dire je sans porter le poids de sa position.
Ce soir-là après le sheva brochos, quand les fillettes eurent dévalé les marches pour aller retrouver leur mère, Surie lava tous les plats qui restaient, les essuya et les rangea. Elle décida de mettre une chemise de nuit que lui avait offerte une amie en guise de plaisanterie après son opération du cancer. À l’hôpital, après avoir jeté un œil à l’intérieur de la scandaleuse boîte, elle avait poussé un cri d’effroi et piqué un fard. Cela avait été fort drôle à l’époque, exactement ce qu’il fallait pour lui insuffler un sursaut d’énergie mutine à un moment où elle se sentait au plus bas. Elle aurait dû s’en débarrasser, mais ne l’avait pas fait. Elle retrouva la boîte au fond de sa penderie et l’ouvrit. Une chemise de nuit blanche sans manches avec un nœud en soie rose. Elle l’enfila, puis couvrit ses bras nus d’un cardigan. Le bombement de son ventre se voyait sous le tissu fin et moulant. Quand elle ressortit de la salle de bains, son mari leva la tête pour la regarder. « Jolie robe », dit-il.
Le matelas de son lit jumeau s’affaissa lorsqu’elle se coucha. Elle ne rabattit pas immédiatement les couvertures sur elle. Quelque temps plus tôt, quand ses règles avaient cessé, ils avaient décidé de rapprocher leurs lits pour la nuit. Chaque matin, elle les écartait de nouveau et poussait entre eux une petite table de nuit. Allongée sur le dos tout près de la limite entre les deux matelas, elle lissa le tissu au plus près de son ventre et regarda son mari du coin de l’œil. Il contemplait le plafond.
« Yidel, dit-elle, elle te plaît vraiment ? »
Il ne regarda pas de son côté.
« Ce n’est pas une robe, tu sais.
— C’est une bonne chose que tu sois un modèle aussi raffiné pour nos einiklach*, dit-il. Leur bubbie est toujours tellement élégante. »
Il fixait le plafond du regard tout en mordillant ses poils de moustache. Le tic-tac de la vieille horloge dans la salle de séjour paraissait anormalement sonore.
Elle étira encore le tissu et souleva les hanches, espérant qu’il remarquerait.
Est-ce qu’il rougissait ? Mais oui ! Et elle de même. Cette chemise de nuit dépassait les bornes, trop transparente, trop impudique pour lui. Elle se mit brutalement sur son séant, sauta du lit dans un bruit de ressorts et courut se changer.
« J’aime bien celle-ci, la vieille en coton », dit-il quand elle revint. Cette chemise possédait des manches et un col haut avec des rangs de dentelle. Il passa le bras autour d’elle et lui posa les lèvres sur la nuque.
« Elle sent ton odeur.
— Qu’est-ce que je sens ?
— Le détergent. Peut-être cette poudre que tu utilises pour récurer l’évier ? Et la crème à polir l’argenterie. »
- Division : être soi.
Entrelaçant de plus en plus les temporalités (la jeunesse, le mariage, les naissances successives, les passés de génocide), des souvenirs heureux ou tristes, peu à peu, au fil des pages, le roman dévoile, sous l’arbre des jumeaux impossibles, toute la forêt de l’ambiguité de la condition de la femme dans ces communautés (et qui sait, dans le monde) : une femme qui devrait avoir honte de porter un enfant aujourd’hui, une femme mise au ban parce qu’ayant perdu un enfant, fautive, toujours fautive, mais une femme vierge aussi dont on a sans détour demandé la date des règles pour être sûr de programmer le mariage un jour de fertilité pour pouvoir être troussée avec résultat, une femme dont ne demande que de fermer sa bouche et obéir, plier le linge, même avec la tendresse infini d’un mari aimant. Une femme qui.
Car s’il n’était que les jérémiades d’une vieille femme juive craignant de parler à son mari, le roman, même passionnant, prendrait l’eau et les eaux à défaut de les perdre. Mais c’est pourtant sous cette mécanique de l’angoisse, ces cercles de petits riens et de peurs, que se cache la puissance d’un récit libératoire.
Et lorsque, l’air de rien, sans même que le roman ne semble s’y attarder, Surie ose répondre à un homme, médecin goy qui plus est, c’est tous les germes plantés par Val, la sage-femme rencontrée à l’hôpital, sœur de silence en charge d’elle qui se mettent à fleurir et tous les combats qui s’amorcent.
Elle ne se sentait pas comme la Surie qui s’était rendue à Manhattan plus tôt dans la journée. Elle ne se sentait plus comme la femme qui avait préparé ce matin-là cinq omelettes et un énorme pot de café. Mais elle n’aurait su dire en quoi elle était différente. Sa seule pensée était qu’elle allait traverser le pont à pied au lieu de prendre le bus et que l’air frais ferait du bien à son organisme.
Elle commence à traduire pour elle ce que disent les médecins en yiddish et inversement, apprend peu à peu la base médicale (et donc le corps et son corps), se met à rêver de passer son diplôme d’infirmière (provoquant la colère des proches quand, sacrilège, ils découvrent qu’elle lit).
Bien sûr, l’ensemble du récit se coud alors inlassablement de fil blanc : le plaisir de découvrir l’hôpital, la place retrouvée dans l’humanité, hors du monde clos, le respect en tant que femme, l’incompréhension des proches et la colère des siens, etc., et on pourrait alors facilement reclasser le livre dans la catégorie « empowerement féministe », le réduire, à nouveau, à celui d’une libération des liens.
Entre deux contractions, elle prenait appui, toute tremblante, sur ce qui se trouvait à portée.
Elle avait oublié de vider la machine à laver et de mettre en route le sèche-linge. Hier. À moins que ce ne fût avant-hier. Elle détestait l’odeur de moisi.
Elle n’avait jamais demandé à sa mère comment s’était passée sa naissance. Facile ou difficile ? Il ne restait plus personne à qui elle aurait pu poser la question.
- Vers le pardon
Mais il faut patienter, encore, jusqu’au dernier tiers de l’ouvrage, pour saisir toute la densité de l’art de Goldie Goldbloom et vivre l’acme magnifique de son récit, déroulant sur plus d’une centaine de pages, deux journées de deuils, d’horreur et de pluie où se mêleront, avec une poésie insupportable, toute l’ambivalence des sentiments humains, passant de la tristesse à la détestation, de la chaleur duelle d’une communauté à l’insoutenable deuil d’un couple, un matin, sur la table d’une cuisine. La famille qui se resserre et se perd, les mots impossibles à dire. Les fluides et les rites, les lumières vacillantes comme des vies qui ne seront jamais.
Dans ces quelques chapitres se niche toute la puissance d’un texte qui touche au sublime. Un témoignage doux et brutal, d’une densité folle sur la condition de la femme, sur l’ambiguïté de la maternité, des désirs contraires, sur la famille et sur soi, d’être ou de devoir, des limites d’une communauté autant que son cocon, des frontières, enfin, du couple et de la solitude de donner la vie, perdus dans l’immensité de l’existence, n’arrivant jamais à répondre clairement, cherchant, désespérément, à dire et à oser.
Et quand le livre s’éteint, bercé et lavé par la pluie divine, s’ouvrant aux bruits extérieurs à la frontière de l’Hudson, qui trace la limite avec le monde, les autres, la vie, il n’y aura rien : pas de miracle, pas de libération, pas de fuite mythique. Juste quelques mots, d’une intolérable douceur. Et d’un grand récit de deuil, Division Avenue, qui porte si bien son nom, se fait peut-être celui d’un pardon.
Editions Christian Bourgois, 360 pages, 22 euros. En librairie.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).