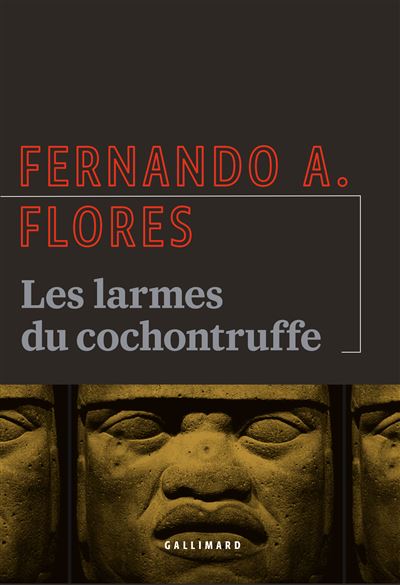La vie n’a plus vraiment de sens, pour Bellacosa, barbouze désabusé, veuf trainant son spleen de chacun des côtés de la frontière entre le Mexique et les USA, séparés non par un mais par deux murs d’ignorance et de violence, dans ce futur proche où les cartels, à peine remis de la mort du glorieux Pacheco, réorientent leurs trafics vers celui des objets amérindiens et des têtes réduites (historiques ou effectuées sur place ou à emporter) et le développement de la Filtration, une technique complexe de clonage à la limite du magique, ayant pour but de recréer, à destination des riches de ce monde et des trafics divers des espèces disparues ou mythologiques : oiseaux à becs d’ivoire ou ours rares y côtoient licornes et tortues éteintes, pour le plaisir des yeux, de leur peau, ou des papilles.
« Le filtrage -c’est-à-dire la production artificielle d’une matière organique- avait endigué la famine. »
Alors quand, arnaqué sur un de ses deals, Bellacosa croise la route du journaliste de Paco Herbert, journaliste enquêtant sur les banquets clandestins où se dégustent ces Chimères, il n’en faut pas plus pour que « Les larmes du cochontruffe » de Fernando A. Flores (traduit par Paul Durant) ne bascule totalement du côté des songes et du réalisme magique, où le réel et ses frontières se troublent dans le regard d’une bestiole mythologique, le cochontruffe dont les larmes viendront révéler le récit.
Une langue baveuse émergait de sa bouche, ou plutôt de son bec, semblable à celui d’une poule ou d’un coq. Sa peau vert foncé était pareille à celle d’un crocodile, avec des trainées ruisselantes qui luisaient comme une jolie paire de bottes. Quelqu’un lui avait attaché un foulard autour du cou, portant le symbole du Mouvement pour le désarmement frontalier.
La Noire de Gallimard frappe fort pour son retour après plus de 15 ans d’absence avec ce premier roman d’un auteur mexicain vivant aux USA qui plonge dans les arcanes de cette dualité, étrange littérature à l’ancienne, presque surannée en surface : un roman noir aux phrases à l’os lorgnant vers le hard-boiled où dans de drôles de villes frontières asséchées et pleine de trafics et d’arrangements un cortège de figures attendues, du journaliste pugnace au antihéros dépressif et hanté, luttent contre la misère et les questions migratoires sur fond de cartels et de complexe militaro-industriel pourri…
Terrain connu et rebattu, nourrissant les fantasmes littéraires et cinématographiques depuis plusieurs décennies, mais dont les circonvolutions se chargent ici d’une hyper-modernité inquiétante (le mur du Mexique, les migrants, les manipulations génétiques, etc), approchant par instants d’une littérature d’anticipation ou de SF, qui se projetterait juste un peu en avant pour mieux éclaire nos présents.
- Mélancolie et larmes
Ce grand écart, qui place aussi bien la collection que le roman dans une dynamique de tension, accouche pourtant d’un étrange surplace chargé d’une étrange mélancolie.
C’est que Flores, au-delà d’être un excellent créateur d’ambiance (il faut savourer son portrait des frontières, des villes à cheval comme des passages du Rio Grande, s’effarer de la décadance de son diner), se plait à déjouer les attentes, en délayant le récit, en en brouillant les temporalités en le perçant petit à petit d’un limon mythique: ce sont les têtes réduites, d’abord, qu’on recrée au besoin en fonction des commandes (et gare à celui qui a la peau assez sombre pour « faire amérindien »), résurgence séculaire et quasi tintinophile, puis la présence fantomatique des Aranañas, cette peuplade ancienne d’indiens, victimes de choix et qui errent dans le désert, ayant, dit-on la faculté de pouvoir passer sans problème d’un monde à l’autre.
Cette faille entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire, d’abord à la marge, contamine peu à peu le récit tout entier, jusqu’au point d’orgue du diner au mitan du roman où la porte des mondes s’ouvre totalement dans une déconstruction à la fois mythologique et rituelle.
Pour eux, onirisme et conscience ne faisaient qu’un.
- Contamination onirique
Et si le roman plonge alors avec délectation dans le noir d’une nuit qu’on dirait infinie, maintenant son patronage hard-boiled et techno-thriller dont on se gardera de dévoiler ici les tenants d’une intrigue finalement assez anecdotique (voire cliché), il révèle véritablement sa puissance étrange lorsqu’il se relie sans entrave à l’animisme et à l’imaginaire, basculant dans un monde aussi inquiétant qu’un film de Lynch ou de Cronenberg, où on peut sans problème accueillir un animal chimérique dans sa baignoire crade tandis qu’un personnage-clef se vide jour après jour d’un ver qui grandit en lui et l’approche un peu plus de la mort.
Et dans un renvoi soudain, avec une grâce obscène, un ver épais de deux ou trois centimètres émergea d’entre les lèvres d’Oswaldo, suspendu à la verticale du bouillon. Le parasite s’étira ; il semblait d’une longueur infinie. Oswaldo eut d’autres contractions, jusqu’à ce que la queue translucide de l’animal se détache de la bouche et tombe dans la préparation fumante. Le supplice était terminé.
- Histoire, histoires, histoire…
C’est que cette contamination bactérienne de l’imaginaire et du passé est à la fois le véritable cœur de l’ouvrage, sa douleur et son issue.
Car derrière les gesticulations de l’enquête, des cartels et des séquences visuelles puissantes, sous l’oubli des Aranañas, de leur langue, de leur culture et de leurs cultes, c’est tout le pays que Flores interroge.
Il avait l’impression que les murs de protection, les cartels de filtrage, les biologistes décapités et le trafic de têtes réduites existaient depuis toujours, en gestation avant de devenir réalité. Ces évènements appartenaient à un flux continu, une tension qui couvait depuis plus d’un siècle le long de la frontière.
Il est dit que le Cochontruffe est le miroir de l’âme de celui qui le regarde. Et ce qui se reflète dans les mots de Fernando A. Flores n’est pas beau à voir : c’est le portrait d’élites voyous, ploutocrates prêts à tout pour s’acheter un peu d’éternité en toc, œuvrant dans leur hybris en soumettant des animaux mythiques ou disparus, quand ils ne s’achètent pas des morceaux d’hommes et d’Histoire.
Bellacosa ne savait comment l’expliquer, mais le Cochontruffe l’avait rapproché de sa femme et de sa fille disparues, de la vie qu’il aurait pu avoir. Il se gifla pour arrêter de pleurer.
Et ce qui surgit alors, derrière le regard comme le réel, semblable à ces bouts de corps baignant dans des auges, c’est le limon des disparus : les rites perdus, les mythologies et les civilisations, mais aussi en sourdine ces fantômes anonymes du présent, ceux que les cartels du monde réel disposent démembrés sur un pont, ou que le Rio Grande rejette, gonflé d’eau sale et de leurs rêves d’ailleurs.
Intime ou national, pas étonnant que nous retrouvions aux premières lignes du récit Bellacosa sur le plancher vermoulu d’une masure qui aurait pu être sa maison natale ou sa Nation. Dans les iris du Cochontruffe et du conte, les humeurs tristes d’un pays perdu et perdant, sacrifiant son passé et son futur, oubliant ses corps et ses contes, dépecé de lui-même et de son histoire sur les autels de la mondialisation et de la violence.
Il faudra attendre et espérer les ultimes pages du roman pour qu’après la nuit se se trace une émouvante forme de paix et de défaite heureuse : un quotidien mystique qui unirait le réel et les défunts, dans un univers complètement désert, comme unique et faible signe d’espoir.
Destruction et renaissance : tant de larmes du Cochontruffe pour espérer que l’imaginaire puisse ensemencer et réparer le monde.
Editions Gallimard, 336 pages, 20 euros. En librairie (et click and collect).
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).