« J’apprends ( oui je peux encore apprendre ) que l’histoire n’est pas seulement une succession de maux devant laquelle on en est réduits à des imprécations impuissantes, mais qu’elle est aussi – et depuis toujours, une forme inaugurale de paix que chacun, même moi, peut prolonger. Moi qui me suis toujours tenu en dehors de tout ( encore que souvent capable d’entrer par la pensée en autrui ) je viens d’apprendre que je faisais partie de l’histoire des formes et que j’évoluais en elles tout comme les gens à l’intérieur du café et ceux qui passaient dehors dans la rue (…) Mon histoire (notre histoire bonnes gens ) doit devenir claire, claire comme le fut cet instant ; jusqu’ici elle n’a même pas pu commencer : coupables, n’appartenant à personne et surtout pas aux autres, nous étions incapables de vibrer à l’unisson de la pacifique histoire humaine et notre absence de forme ne faisait que susciter une faute nouvelle. Pour la première fois, je viens de voir mon siècle à la lumière du jour, ouvert aux autres siècles et j’ai accepté de vivre aujourd’hui. J’ai même été content d’être l’un de vos contemporains et un habitant de la terre parmi les habitants de la terre ; et (par-delà tout espoir ) je fus exalté par le sentiment non de ma propre immortalité, mais de l’immortalité humaine. Je crois en cet instant : je le note : aussi doit-il être ma loi. Je me déclare responsable de mon avenir, je désire la raison éternelle et ne veux plus jamais être seul. Qu’il en soit ainsi. »
Peter Handke, Lent retour, 1979
C’est un projet inabouti, inspiré par le Lent retour de Peter Handke, qui laisse libre cours à Paris-Texas. Au-delà des déserts et des routes américaines, les mots de l’alter ego d’un Wim Wenders première période hanteront le scénario des Ailes du désir, Wenders redécouvrant les dialogues de Peter Handke « très beaux et poétiques, étaient là comme des monolithes tombés du ciel ».1 Envisagé depuis 1977 et un séjour dans cette autre réalité du bush australien, mais abandonné pour suivre Coppola dans le naufrage de Hammett, Wenders va recommencer à travailler, après la palme et la sortie couronnée de succès de Paris-Texas, sur un projet de film dont la quête aboutirait là-bas, au cœur de la Terre-mère australienne. Mais son projet mégalomane de tourner dans une quinzaine de pays effraie et décourage les producteurs, d’où entre temps un retour au pays via Berlin avec la réussite que l’on connaît. Le plus gros succès public de Wenders lui permettra de boucler un budget de 20 millions d’euros, inhabituel dans le domaine du cinéma d’Auteur. Plus rare encore, il n’aura jamais à transiger sur sa manière d’écrire ou de tourner, réservant le maximum de place aux rencontres et à l’improvisation. Cette fois, le retour à la mère patrie est plus douloureux. La durée du montage commercial de Jusqu’au bout du monde est réduite d’environ 40 % au désespoir de l’Auteur. Et le film ne marche pas… Pire, il est oublié ; le purgatoire critique commence pour Wenders. Chaque parole du cinéaste est extirpée de son contexte et érigée en aphorisme paranoïaque et vide de sens par une partie de la critique un peu prompte au sarcasme, relayée aujourd’hui par la génération Twitter. Noël 2015 : Tamasa décide de sortir enfin la version intégrale, ce director’s cut voulu par Wenders et son monteur Peter Przygodda. Bien sur, avec le temps, tout s’en va. Exit le film d’anticipation face à un objet devenu historique, sauf que notre contemporain éclaire plus que jamais les idées développées ici sur le devenir des images.
Dans la continuité du précédent, les scènes liminaires imaginées cette fois avec l’écrivain australien Peter Carey, sont comme des compartiments de métro hantés par des déjà-morts. L’héroïne, Claire, est toujours interprétée par l’ange Solveig Dommartin, cette fois au cœur du projet, mais le personnage bat sérieusement de l’aile. Dans son existence européenne branchée, absurde, Claire est incapable de réconcilier ses cauchemars et un quotidien schizoïde qui ne vaut guère mieux. Alors par lâcher prise plus que par volonté, elle fait comme l’ange Damiel avant elle le pas de côté ou plutôt l’embardée, qui va entraîner le récit dans une course folle déstabilisant son spectateur. Il en résulte des bribes d’aventures, un peu comme si perçues par des anges extra-terrestres peu concernés se tirant la bourre sur le périphérique de l’espace, Wenders ne faisant d’abord ( encore une fois ) qu’effleurer ses tableaux. Des vignettes éthérées, qui n’ont pas le temps de se solidifier que le récit déraille à la suite d’un satellite fou-furieux menaçant en off l’avenir de l’Humanité. L’esthétique du film rompt avec la délicatesse des Ailes du désir, dans l’esprit d’un scénario qui nous promène dans la troposphère pour mieux nous laisser aux portes d’un sommeil paradoxal où le néocortex se joue de l’hippocampe. C’est un peu le même schéma que celui d’un roman de Carey, Un autre ( The illegal itself ) dont le voyage retourne à une de ces communautés alternatives australiennes. Autre différence notoire avec le film précédent, dans Jusqu’au bout du monde la musique est moins souvent jouée live dans les limbes, mais toutes ces chansons pop informes semblent au contraire un composant de cette atmosphère, où se seraient évaporés les continents et les cultures.
« L’œuvre de Wim Wenders témoigne de cette féconde contradiction qui fait travailler en lui la mythologie américaine, « colonisatrice d’inconscients » et la recherche d’une identité culturelle ouverte à un cosmopolitisme déterritorialisé, arraché à l’idée même d’un espace approprié ».2
Du vouloir être au monde de Claire, Wenders part en dérive politique. Il survole les fils narratifs distendus d’un polar d’anticipation qui jongle avec des villes-écrans sous l’emprise d’un mirage informatique – depuis devenu vieux-, le contrôle de l’individu. La frénésie mondialisante de ce village global qui ne dort jamais permet à Claire de s’extraire d’une Venise-bourbier de carte postale, puis de fausser compagnie au grand embouteillage de la ratio pour goûter la liberté des causses méridionaux. C’est le début d’un grand jeu de marelle avec les capitales européennes, puis intercontinental. La simultanéité supprime toute cartographie, le désir éludant la topographie, reliant l’immensité des gorges du Tarn au périphérique occidental toujours bouché ou la métropole Tokyoïte au désert des Bungle Bungles. Cette déterritorialisation s’accompagne qui plus est d’un sentiment tenace de « déjà-vu », si mode au sortir des années 80, en instance mélancolique. D’où la tentation baroquisante qui oblige à styliser le monde plutôt qu’à l’enregistrer, au risque de dissiper son projet aux quatre coins dans une « world culture » devenue indigeste avant même la fin des années 80. Un monde sur le déclin, vu comme un grand ovni aux arrêtes cosmopolites mais normalisées. Dans la perception du Wenders globe-trotter, les motifs deviennent signes et déjà, il repeuple son Amérique post-western de homeless de plus en plus nombreux, épanchant ainsi son angoisse très crédible quant au futur d’une terre autrefois d’abondance. Ne restent que ses bars favoris, oasis ressuscitées de son odyssée précédente. Il faut accepter qu’à des moments – d’abord partout et tout le temps ! – ce trop plein remplisse sa fonction de débordement. Ainsi, il nous projette très tôt et violemment dans une chambre d’enfant exubérante tirée de la malle psychédélique d’un Terry Gilliam ou d’un Tim Burton. Costumes et décors extrapolent en tous sens le développement de l’esthétique de cette scène indy new-wave des eighties moribondes, jusqu’au ravissement ou au dégoût. Nos yeux brûlent devant ces micro univers flashy et comme dans un trip sous LSD, on n’a aucune prise sur des scènes plus artificielles les unes que les autres. Wenders passe ainsi le temps ( et un paquet d’argent ) à remplir ses villes fantômes de détails surannés, à jouer à la poupée avec les tenues les plus fashions de son héroïne ( le plus souvent redessinée par Yoji Yamamoto, à qui il vient de faire une sublime déclaration d’amour avec Carnets de notes sur vêtements et villes en 1989 ) pour réveiller nos sens en étourdissant notre raison. La caméra promène un regard morne sur des cités/champs de bataille, déroule un travelling sur des murs tagués de rouge et or, capte ce Tokyo contemporain donc déjà futuriste, les ambiances sonores d’une Lisbonne éternelle. Si beaucoup de motifs n’émergent pas de ce luxueux livre d’images nous plongeant dans la torpeur ou tout au moins dans la perplexité, un simple tram bondé de supporters invisibles du Benfica suffit à recréer de la permanence dans ce flottement. Si référence il y a, comme souvent chez lui en maniériste post-moderne, elle est engluée dans la profondeur de champ de ces immenses vues d’ensemble qu’il affectionne pour mieux lutter contre le diktat du gros-plan. Pour rouvrir le champ rabougri par la culture télévisuelle, il augmente le piqué de l’image et pousse à l’extrême cet art de la fenêtre hérité de la Renaissance. Par sa volonté de surcadrer, il va jusqu’à détacher cette limite factice du plan de l’image ( la mousse très kitch qui maintient le pare-brise remplacé de la voiture de Claire, ne fait que matérialiser l’isolement dans lequel il confine le couple principal aussitôt hors du temps ). Il semble que son récent hommage à Salgado arrive à la limite de ce procédé au delà duquel, hors la photographie, point trop de sel du cinéma. D’où de sérieux adversaires pour ce « cinéaste encadreur » selon la formule concrète mais limitative de Michel Chion.3 Quand bien même ces tableaux vertigineux et sonores appartiennent à un plus vaste simulacre, il est ici impossible à un spectateur avide de repères de ne pas vouloir décrypter les symboles lovés dans la luxuriance des arrières-plans. Nous sommes déjà dans le Tjukurpa, ce temps du rêve aborigène, quand surgit telle violoncelliste de rue ici ou un curieux spationaute là, qui va son chemin sans qu’on y prête attention.
Heureusement, apparaissent un à un les protagonistes d’un thriller. Bien qu’absurdes, leurs actes sont mus par une nécessité impérieuse, leurs gestes heurtés et leurs changements de directions accidentels, d’où une sensation de danger sensée nous tenir éveillés. Un jeune premier énigmatique et peu coopératif, un privé collant, un chasseur de primes sympathique et enfin, l’ancien mari écrivain qui déboule et roucoule quand bon lui semble sa litanie en voix-off. Sans oublier un drôle de duo, Eddy Mitchell et Chico Ortega, qui amène un ton décalé, résolument kitch (osera-ton « français » ? ) et comme échappé du fin fond des années 80 ( le néo psychédélisme des Musulmans fumants ou la naïveté de L’affaire Louis Trio ? ). Le plus souvent, ces silhouettes de fiction se neutralisent l’une l’autre, ne servant qu’à détourner les jolis yeux de l’héroïne d’une apocalypse annoncée. Escroquerie, espionnage industriel, le film croque aussi une des mamelles de son scénario en étalant ses marques. Loin de la simplicité d’Alain Tanner ou de la nostalgie future de Lisbonne story, Wenders traite en quelques plans une capitale portugaise hitchcockienne. Après l’espionnage extrême oriental, il utilise la réalité délirante des hôtels à la japonaise ( sortes de cercueils avec porte-hublot de machine à laver empilés les uns sur les autres ) pour injecter une séquence joyeuse de Yakuza eiga. De même qu’il met en exergue cet exotisme communiste anteperestroïkaien figé dans une posture de bande dessinée, le cinéaste réinvente chaque ville à son gré ( comme chez Rivette, on entre dans un bâtiment devenant dans la continuité du mouvement immense cargo ), échappant de justesse à la présentation de collection par un romantisme échevelé, presque érotique, qui transpire de plans en chambre étonnamment éclairés par Robby Müller. La dimension monumentale de plus en plus affirmée de son cinéma, où la UFA pré nazie succède au western originel, s’étire dans l’horizontalité du road movie à toute la surface terrestre… et à sa finitude. Œuvre à multiples facettes, Jusqu’au bout du monde boit ce calice esthétisant jusqu’à la lie. Par son ampleur, comme pour ses couleurs saturées, il est le chaînon manquant avec les fugues argentines ou futuristes de Wong Kar Waï qui elles, déchaîneront les passions ( et ce même si Wong butera lui sur ce même écueil avec 2046 ), particulièrement dans un premier plan resté célèbre de Claire, quelque part dans les étages supérieurs d’une tour pékinoise, devant le ruban lumineux de la circulation qui s’écoule aussi lentement que la fuite du temps dans un sablier. Une presque suspension dans un film-univers où tous se meuvent, se débattent, à la vitesse de circulation des images.
« Je trouve que c’est seulement quand on donne à chaque image le droit de raconter quelque chose pour elle-même, d’être là pour elle-même, qu’on peut espérer aussi qu’elle vous autorisera pour ainsi dire à la placer dans un contexte et créer un tout ».4
Il en est de même de tous les éléments d’anticipation qui se développent, moins dans les sphères géopolitiques où évolue l’affaire du satellite que dans les petites choses du quotidien, afin de composer un futur crédible, palpable. S’il faut peu de temps à un Wenders vaticinateur pour glisser d’un décor-pays à un autre, il en faut plus pour que ses créations fabuleuses se transforment en invention brevetées. Mais reconnaissons lui l’invention du GPS, celles conjuguées de Skype et du téléphone portable ainsi que d’une flopée de tablettes. Juste pour l’humour, les motards de la police nationale deviennent sur leurs engins aux ailes rétractiles des serviteurs ailés, mais moins zélés. Enfin, c’est dans le champ informatique que les avancées sont plus conséquentes, avec des logiciels destinés à surveiller pour mieux punir, comme celui de reconnaissance d’empreintes digitales ( déjà dépassé mais dont l’imagerie se fera un nom dans la trilogie des Bourne ). On oublie vite ces innovations tant elles foisonnent mais elles sont en général, soit du côté de la forme, d’une ligne ou d’un design qui suit le sens de l’histoire ( la fuite ), soit, et plus fréquemment du côté des images elles-mêmes. Car comme depuis toujours ou presque chez l’auteur de Faux-mouvement, « le cinéma comme tel se réfléchit de part en part, autant dans le dispositif de sa production que dans celui de sa projection : la multiplication des appareils d’optique, d’enregistrement, la présence obsessionnelle de la télévision, parfois brouillée, métaphorise le cinéma jusqu’à en revenir à son essence. »2 Wenders louvoie dans cette pensée d’une transformation inéluctable du cinéma qui se cristallise derrière le film de fin du monde à la résolution bienheureuse annoncée. Un septième art, érigé en îlot de résistance, confronté à la prolifération des nouveaux supports et à l’annonce d’un futur passage au numérique, thèmes récurrents des derniers textes de Daney. Depuis toujours hanté par cette vision mélancolique, Wenders en partage l’angoisse et pour ce faire, suture le film d’un vaste flux d’images médiatiques créées pour l’occasion. Ainsi il tourne pour David Byrne et les Talking heads un des premiers clips en HD, fond finalement plus sonore que visuel malgré l’écran géant du bar où il s’étale. Comme dans son documentaire sur Yamamoto, il mélange les textures. Les images vidéo tournées par Sam interrompent la platitude expansée de la haute définition, délivrant ainsi des vues quasi documentaires d’une Chine de l’intérieur alors peu représentée ( un rendez-vous donné… place Tian’anmen ), prélude à ce jour encore lointain où elle sera enfin libérée. Tout, plutôt que l’écran blanc d’Au fil du temps…
« Comment perpétuer un cinéma de l’évidence quand on est saturé d’images et de sons, quand la mémoire est encombrée de clichés au point de courir constamment le risque du ressassement ? »2 Pour Wenders qui a toujours voulu revenir à un cinéma originel ( Ford, Ozu ), le renvoi à une enfance de l’art où les rêves remplacent le cinéma appartient à une pensée logique. A l’avant dernière station, il rend d’abord hommage au maître japonais par la séquence, transparente – la seule de la première partie -, où Sam ( William Hurt ) est soigné par Monsieur Mori. Là comme chez Ozu, « sa façon de raconter les choses va dans le sens figuré ».5 En tournant avec le couple fétiche Ryu Chishu – Kuniko Miyake, il perpétue au-delà de la référence, une tradition à la fois stricte et profondément humaine qui a l’avantage de repousser hors champ l’enjeu quand même envahissant du scénario ( la destruction de notre planète ). Ce que suggère cette parenthèse, c’est que le monde des apparences a déjà disparu. Annihilé dans l’instantanéité semée un peu partout depuis que le spectateur, lancé à la poursuite des personnages, fait du surplace. Il ne sait pas encore qu’il est pris dans les rets d’une narration romanesque, certes erratique mais aussi des plus traditionnelles, qui relie les beaux oripeaux terrestres protégeant un nombril niché dans un pli de l’Outback australien. Les scènes et rencontres s’additionnent durant deux heures pour former un long cordon ombilical au bout de ce placentas musical, innervé de chansons, de mélodies ou pièces de musique écrites sur la vague indication d’un découpage. Pour le film, tous les musiciens composent avec vingt ans d’avance, cette atmosphère d’avant la fin.
C’est là que se tient le paradoxe de Jusqu’au bout du monde, film présentant un état des lieux pompier de ce monde en ses presque-ruines, alors que comme Claire jetant l’ancre avec l’eau du bain, Wenders veut dès lors soustraire à sa forme tout superflu. « S’il part des structures narratives les plus clairement codées du cinéma américain, celles de l’errance, du retour incertain, des amitiés masculines confrontées aux grands espaces, il les transfigure dans celles d’une réflexion sur l’aventure même du cinéma : ses fictions ne cessent de nous parler du cinéma, de ses conditions de production aléatoires, autant que de ses conditions de projection, toujours hantées par sa mémoire cinéphilique. »2 Après le glissement perpétuel sur la surface des choses, un nouveau mouvement commence à mi-parcours. Une seconde étape qui délaisse l’enquête et l’anticipation pour l’expérience et la science-fiction. Elle va répondre à cette question plus souterraine de l’Auteur, finalement pertinente : « Un film de science-fiction pourrait-il s’incarner comme une nouvelle façon d’ouvrir les yeux ? »6 A quoi ressemble cette fin des temps depuis le désert australien où « l’œil ne voit pas comme le cœur » ? A l’intensité d’un quotidien idyllique vécu dans la panse de la terre, où l’homme post moderne n’est plus qu’un blanc déraciné face à l’ancien comédien aborigène culte David Gulpilil ( celui qui a fait sien le choix d’abandonner les voyages et le cinéma pour vivre au sein de sa communauté ). Là le film mythique ( ses extérieurs crus et dénudés ) s’oppose formellement à la fable science-fictionnesque ( un dialogue permanent avec des écrans ). Avec pour objectif la re-création du monde plutôt que son anéantissement, le scénario entend redéfinir l’acte de voir à travers le personnage de Jeanne Moreau, la mère aveugle de Sam. Rendre la vue aux aveugles était un thème que Wenders portait depuis l’enfance et sa proximité avec une tante non voyante mais cinéphile. L’ambition naïve du mari et père va incarner l’aboutissement de ce processus. Et son revers.
« Croire qu’il aurait suffi au docteur Farber de seulement montrer des images à sa femme pour la guérir aurait été le fruit d’une utopie irrémédiablement enfantine. A la suite de nombreuses recherches et de débats avec des ophtalmologistes, des biochimistes et des informaticiens, nous avons imaginé une théorie, appelée « l’acte de voir » que j’aimerais vous exposer ici. Pour permettre à un aveugle de voir, la transplantation des yeux paraît exclue, même à longue échéance. Relier le nerf optique avec le centre visuel du cerveau restera utopique, même en l’an 2000, il faudra donc envisager d’autres possibilités. L’électronique, par exemple. D’ici dix ans, il existera des ordinateurs qui auront appris à voir. Des logiciels de plus en plus complexes leur permettront de distinguer des couleurs, des contours et des formes. Les computers pourront lire et interpréter des informations fournies par des images. Ils seront capables de « regarder » les images et de « savoir » ce qu’elles représentent. Ils pourront faire des distinctions entre les choses entre un chat et un chien, un homme et une femme, entre deux visages. C’est un aspect important de la conception du film. » 6
Pour concrétiser ce fantasme cinématoscientifique, il faut retrouver l’essence de l’image entraperçue dans ces caméras-lunettes. Le son enregistré en direct, on obtient ce que Wenders appelle l’ « image objective ». Mais plus encore, si on parvient à capter l’activité du cortex cérébral de l’opérateur à la prise de vue, c’est l’acte de regarder qui est immortalisé en une image « subjective », au long d’un processus que Wenders désigne comme le « premier regard » . Le deuxième regard sera celui du filmeur revisionnant ensuite ses propres images, leur mémoire. L’ordinateur peut alors reconstituer une image, exclusivement à partir d’ondes cérébrales. Partie du récit boudée par les fans de la première, elle est pourtant la plus intéressante puisqu’on y interroge et analyse leur nature : ces images biochimiques sont-elles des images ou juste des émulsions informatiques qui agissent pareillement sur notre capacité à nous émouvoir ? La mise en scène détaille et fouille les pixels, matérialise la perte du signal lors d’interfaces de signes cristallisés dans le néant de la durée. Si le scénario parvient à nous passionner avec cette épopée du deuxième regard, c’est peut-être parce qu’elle prend naissance dans un environnement dépouillé et que les intrigues secondaires entre les personnages finissent par céder sous la pression d’une fausse apocalypse. La fin du monde est en réalité sa mise en formes pour les beaux yeux morts d’une aveugle pas préparée à un tel choc. Dans cette constellation de personnages, les petits détails tentent de maintenir une cohésion alors que face à eux, la communauté aborigène semble aussi vaste que soudée. Peu de traits de caractère mais un grand esprit collectif. A ce titre, un des plus beau plan est simplement celui de silhouettes d’enfants jouant devant le feu. Wenders choisit de ne pas expliciter leur rapport au rêve, refusant au contraire du père de Sam, de transgresser ce tabou. Le rêve doit rester la dimension intime, secrète de l’individu intérieur et ne peut être révélé aux Pyranipa ( les gadjé de l’outback). D’abord, le processus de fabrication de ces représentations résonne avec une cosmogonie indigène où la pensée a créé toute matière. Mais Farber en a oublié le choc des civilisations… Passé cet aboutissement en forme d’impasse, ce père raté, typique du bestiaire wendersien, et qui est aussi une métaphore du créateur qu’il pourrait devenir poussé par sa volonté de recherche exponentielle, a besoin de la vérité latente des images, lui qui est si prêt de toucher du doigt celle des rêves. Sa femme, Edith, possède au contraire ce regard originaire, issu de ce Tjukurpa qui fonde l’univers aborigène. Elle est cette première spectatrice qui découvre des images glanées au fil des déplacements et des actions par son homme-éclair de fils ; une spectatrice inquiète défiant l’adage godardien (« dormir au ciné, c’est faire confiance au film » ).
Dans cette longue dernière partie, Wenders joue donc du contraste entre cet extérieur en forme d’Eden brûlant de ses derniers feux sous la menace invisible des radiations et de la caverne platonicienne hypertechnologique où se réenfantent les mythes. Son regard de peintre se rassasie des couleurs vives exacerbées par Robby Müller : des rouges, des ocres, des jaunes primaires lavés au bleu profond du ciel où se détache une Solveig déjà spectrale. Et c’est aussi-là que le peintre-photographe-cinéaste-cadreur rejoint encore une fois cette réalité bazinienne : « On peut vider l’image cinématographique de toute réalité, sauf d’une, celle de l’espace. »7 Un état de choses que Wenders a compris très tôt, c’est que l’espace permet de positionner les personnages les uns par rapport aux autres. Une phrase de Jean Collet résume toute la première moitié du film : « Le plus court chemin d’un personnage à un autre, c’est l’univers ».8 Jusque là, sur la route de l’errance, tout le film était peuplé de présences nostalgiques et d’apparitions. La seconde partie stoppe le monde pour mieux observer les interstices entre les choses, leurs empreintes car « aborder la question de l’espace au cinéma demande de se placer en retrait par rapport aux états de choses qui apparaissent à l’écran, pour remonter à leur condition d’apparition, qui nous parlent aussi de rêves et d’attentes. »9 Alors qu’il a réussi par le passé à donner une intensité rare à des espaces quelconques, Wenders n’en finit plus de nous ramener à cette fenêtre où l’espace filmique se dilate. Mais aux fins fonds du plan, le monde globalisé s’est mué en réel expansé. Dans cet outback, la durée creuse le plan comme l’érosion les rochers, mettant à l’épreuve les neurones.
Entre deux allers-retours, le régime d’images (cinéma, vidéo, biochimiques…) nous stimule et la quête plastique et métaphysique de Wenders alors émeut. Dans cette grotte-salle de montage où seuls les outils ont changé, les ordinateurs d’un petit génie ont pris la main et l’homme s’il n’est pas que spectateur, est tout au plus un canal qui ne fait que repasser des images qualisignes pour mieux les repenser. La question de leur partage, plus que celle de leur circulation ( même si ces images-affection passent par toutes les strates et tous les états selon leur condition, leur durée, le temps de leur réception ) est posée. Leur perception. L’aveugle reçoit leur spectre sous forme d’images biochimiques qui parasitent les affects dont elles sont chargées. Et c’est la séquence de la sœur de Sam qui évoque le mieux cette impossibilité physiologique en délivrant un constat plus grand encore. C’est de l’ensemble ( son, dialogues, image, couleurs, valeur de cadre, effets de répétition du montage ) et de ses différences ou manques que naissent émotion et frustration. « Il y a pour moi une vérité latente dans la vision. Beaucoup plus que dans la pensée où l’on peut s’égarer d’avantage, où l’on peut s’éloigner du monde. Pour moi, voir c’est se plonger dans le monde tandis que penser c’est prendre ses distances ».4 Œcuménique, Wenders a néanmoins pensé à raviver les sens des spectateurs borgnes et aveugles. Ainsi à l’extérieur règne une harmonie qui prend corps dans un bœuf musical utopique et improbable, une prière à la terre blessée plus urgente que des recherches de cinéastes paumés et non émotionnellement impliqués.
L’idée qui hante, subliminale, Jusqu’au bout du monde sans dire son nom, c’est donc celle de la mort du cinéma, cette grande affaire qui naît dans les années 80 et traîne dans l’air jusqu’au milieu des années 90. Elle se trouve moins ici dans la résurrection en images mentales et pastels que dans le dialogue de sourd d’un individu perdu face à son écran individuel. « Pouvoir regarder de la sorte les images les plus profondes du psychisme humain ne peut être qu’un acte corrupteur, profondément amoral ou narcissique. »6 En quelque sorte, voilà la différence entre rester spectateur de sa vie dans le grand recyclage post-moderne et être acteur de son rêve dans la société aborigène ou selon tout précepte chamanique. A l’opposé, autiste, Farber Sr cogite au centre d’une pelote de câbles comme autant de terminaisons nerveuses. Le couple principal s’y dissout, « dévorés vivants » par le reflet de leur psyché et sourds (Claire, repliée en position fœtale dans une oreille de roche ) aux appels d’une planète régénérée par la cérémonie rituelle d’énergies conjuguées. Revient à la charge le sempiternel conflit wendersien, insoluble, entre vision et dramaturgie. A notre tour, nous sommes fascinés par ces mirages en formation bien qu’extérieurs à l’expérience très physique qu’en font les personnages. Elles n’évitent pas la supercherie, y participent. Max von Sydow y découvre la vieillesse « sexy » alors qu’il n’y a jamais eu que lassitude. Lui même ressemble au fantôme charbonneux d’un clown bergmanien sur le point de trépasser. D’où l’impression qu’elles vampirisent l’histoire au contraire de la grande peur contraire du réalisateur10. En ne figurant plus que le double du filmeur/rêveur, elles éliminent l’altérité, affichant la suprématie du champ intérieur du Soi. Mais une fois cet imago asséché jusqu’à la trame, elles ne peuvent plus guère filtrer le flot d’un récit qui finit à nouveau par irriguer, puis submerger le conte cruel. Il nous emporte dans un semi-coma jusqu’à une fausse fin où l’utopie collective supplante le romantisme – suranné en 1992 – de Paris-Texas. Abandonnant une Amérique mythique de néons et de bars où Wong Kar Waï trouvera lui la matière de My blueberry nights, Wenders préfère envahir un autre domaine réservé de la SF, tout aussi balisé, celui de la conquête spatiale, pour une sorte de prolongement d’une COP 21 souveraine. Le scénario de Carey invoque quant à lui St Jean pour réaffirmer la primauté du verbe à un spectateur pas si dupe, car si l’écrivain maintient le monde par les mots, le cinéaste le célèbre lui par l’image-mouvement, par le cliché et sa liquéfaction.
Wenders s’est toujours méfié d’un récit potentiellement mensonger par rapport à la « possibilité de vérité » des images. Pour un film sur leur devenir, « … il m’a semblé tentant de faire un film de science-fiction qui traite du futur usage de l’image et de réfléchir en toute liberté sur l’avenir du regard. »6 Ces images nouvelles sont la plus belle réussite de Jusqu’au bout du monde. L’équipe utilise pour la première fois la Sony NHK HD chez Sony à Tokyo pour six longues semaines de montage où « nous avons déstructuré les images, les dénaturant et les détruisant par tous les moyens. Nous les avons soumis à des centaines d’effets spéciaux via Paintbox Matte-box et à travers différents étalonnages. Nous avons été les premiers à voir ce que l’avance rapide donnait en HD. Enregistrer les images en avance rapide et les ralentir à nouveau révéla chaque pixel… ».11 Agiter les pixels, les déchaîner et découvrir dans ce tourbillon le futur de l’image. Paradoxalement, ces anamorphoses ou émulsions en chaîne jusqu’au grand chaos numérique, à la pointe du cinéma expérimental et de l’art vidéo réconciliés sous les auspices de l’informatique, aspirent le voyage jusqu’à une autre dimension où ces formes sont soumises à la spéculation interprétative. Certes, en 2015, ces chimères ont cessé d’être effrayantes. Mais on voit Wenders atteindre une puissance visionnaire à travers elles, plus que dans la fable morale, qui aussi intéressante soit-elle, ne reste que vaguement prophétique. Alors que les images semblent avoir gagné la bataille ( depuis elles règnent en maître sur les réseaux sociaux quand les mots ne sont plus que d’ordre ), le fond – et ce cinéma mutant avec – devient réflexif au rythme des palpitations procurées par une nouvelle sensation car « l’impression de réalité que procurent les images animées pour le spectateur n’est pas qu’une illusion, car, d’avantage encore que le mouvement, c’est le temps qui est ainsi capturé et conservé ».12
La lumière ébouriffante de Müller peut se mêler au divin bonheur d’un classicisme réinventé ( Robby Müller et Wenders évoquent Vermeer pour la scène filmée de la sœur et de sa fille, illuminées par une fenêtre extérieure ). A l’image de l’écrivain contemplant le monde d’après dans une nuit presque d’encre ( plans sublimes, incroyables ), le road movie conduit à un retour aux sources alignant des métaphores aussi limpides qu’aux débuts de l’art pariétal. Dans l’attente du miracle qui dévoilerait les signifiances cachées venant résoudre le désordre apparent de nos vies et tuer dans l’œuf tous nos questionnements. « La raréfaction de l’image commence lorsque ces deux actes jumeaux, voir et montrer ne sont plus naturels et sont devenus comme des actes de résistance. Reste alors à imaginer ce qu’on ne voit plus. L’imagination est le fantôme de l’image. Elle est notre amère victoire ».13 Ici elle commence à galoper au sortir d’un long film, monstre et merveille, miroir et envers, réussissant à embrasser ce qu’il y a en bas, en haut, en dedans, le fini et l’infini, par tous les moyens du cinématographe et de la figuration.
—————————————————————————————————————————————————
Ce beau combo dvd-blu ray édité ( juste avant Noël…) par Tamasa rend parfaitement hommage au travail technique exceptionnel ( couleurs et définition ad hoc ! ) et constituera sans aucun doute l’édition ultime du film. Pas de bonus mais un superbe livret contenant des propos forcément passionnants de Wenders. On regrettera juste l’absence d’un texte critique de valeur en lieu et place de l’« éditard » du « Scrogneugneu de la critique »14, Michel Ciment, qui n’apporte à peu près rien, et d’une revue de presse qui tente de nous convaincre de l’intérêt d’un film qu’à priori le lecteur s’est déjà procuré. Ni l’un ni l’autre ne pallieront au désamour critique dont Wenders est aujourd’hui l’objet et il aurait mieux valu publier le papier d’Alain Masson dans le même numéro de Positif. A vrai dire, ce n’est qu’un infime détail tant le film, tel le monolithe de 2001, se suffit à lui-même pour qui veut bien tenter de s’y aventurer.
1 : Wim Wenders : Cahiers du cinéma n° 400, supplément rédigé par Wim Wenders. L’extrait de Lent retour est également extrait d’un encadré accompagnant la critique des Ailes du désir par Alain Philippon dans ce même numéro.
2 : Gilbert Cabasso, 08/02/2014, Transitions n°8.
3 : Michel Chion, Révolution douce…et dure stagnation, Cahiers du cinéma n°398, Juillet-août 1987.
4 : Wim Wenders in Vincent Amiel : Wenders, Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction d’Antoine de Baecque et philippe Chevallier, Puf 2012.
5 : Michel Boujut : Wim Wenders, 1982 cité in Gilbert Cabasso, 08/02/2014, Transitions n°8.
6 : Wim Wenders : Le deuxième regard, Le monde (campus) 15/10/1991 in Livret dvd.
7 : André Bazin : Qu’est-ce que le cinéma ? 1951.
8 : Jean Collet, Culture cinéma avril 1978 in Gilbert Cabasso, 08/02/2014, Transitions n°8.
9 : Philippe Chevallier : Espace, Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction d’Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, Puf 2012.
10 : « le récit se délite au fur et à mesure que l’image affirme son importance » selon Vincent Amiel car d’après Wenders « l’histoire suce le sang des images ». Wim Wenders in Vincent Amiel : Wenders, Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction d’Antoine de Baecque et philippe Chevallier, Puf 2012.
11 : Wim Wenders 2015 in Livret dvd.
12 : Christian Delage : Enregistrement, Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction d’Antoine de Baecque et philippe Chevallier, Puf 2012.
13 : Serge Daney, Montage obligé, in Les fantasmes de l’info, avril 1991 in Devant la recrudescence des vols de sacs à main, cinéma, télévision, information, Aléas éditeur.
14 : dixit Gérard Lefort aux Inrocks…( 07/12/2014).
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).
























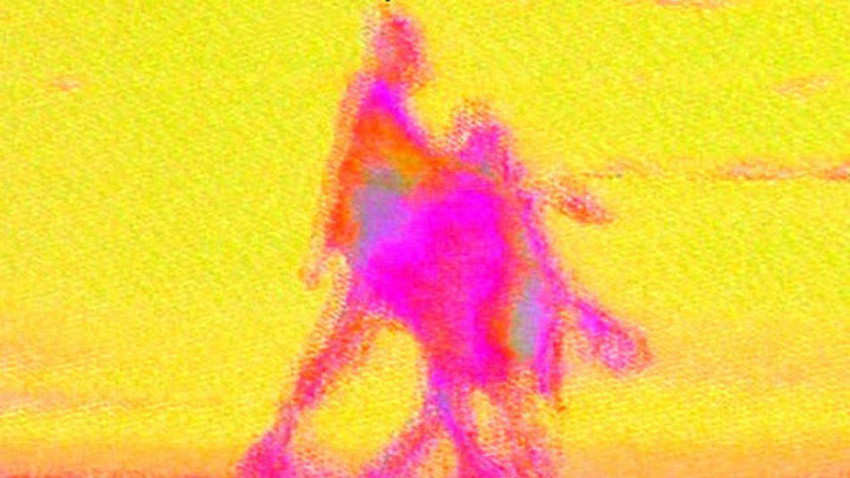





Pierre Audebert
Authoret merci à vous pour cet article passionnant !
Gilbert Cabasso
Merci de vos remarques si justes.