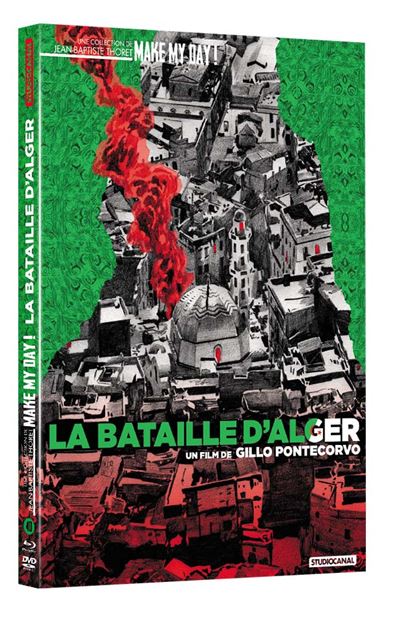Gillo Pontecorvo est un cinéaste précieux. Journaliste et documentariste engagé, inscrit au parti communiste italien, il passe à la fiction en 1957 en réalisant Un dénommé Squarcio, un drame avec Yves Montand et Alida Valli. Quatre ans plus tard, il crée la polémique avec Kapò, dénoncé par une partie de la critique pour sa prétendue complaisance, notamment Jacques Rivette dans Les Cahiers du cinéma à travers son célèbre article intitulé De l’abjection. On lui reproche alors un certain voyeurisme dans la mise en scène de l’horreur des camps de la mort. Lorsqu’il retrouve son scénariste attitré, Franco Solinas (Salvatore Giuliano, État de siège, Monsieur Klein, ou encore le premier traitement de Colorado, qui devait initialement être un polar), pour un film de guerre, il est loin de se douter que le scandale serait encore au rendez-vous. L’ancien membre du FLN, Yacef Saâdi, cherche alors à adapter ses écrits et propose le projet à Francesco Rosi puis Luchino Visconti, qui lui souffle alors le nom de Pontecorvo. Inspiré de l’expérience de l’activiste et écrivain, La Bataille d’Alger revient donc sur les premières années du Front de Libération Nationale (entra 1954 et 1957), alors que la France envoie sur place un contingent de parachutistes mené par le colonel Mathieu (Jean Martin). Un jeune voyou, Ali la Pointe (Brahim Haggiag) se retrouve mêlé au conflit et va peu à peu s’engager dans le mouvement indépendantiste. Lion d’or à Venise, nommé aux Oscars, le long-métrage, qui pointe du doigt les exactions commises par l’armée française, se retrouve censuré dans l’Hexagone jusqu’en 2004 (après que sa première sortie, au tout début des années 70, se soit vue entachée de diverses menaces et même d’attentats). Le réalisateur (qui tournera après cela Queimada avec Marlon Brando, et Ogro), se consacrera ensuite aux documentaires. Il demeure un auteur à part dont l’œuvre nécessite d’être relue à la lueur de son impact phénoménal sur le cinéma mondial. C’est la mission que s’est donné Jean-Baptiste Thoret à travers cette réédition proposée dans la collection Make My Day ! chez Studiocanal, agrémentée de bonus passionnants. Penchons-nous donc davantage sur cet objet filmique à la postérité sans égale.

(© Copyright Studiocanal)
La volonté première de Gillo Pontecorvo lorsqu’il s’attèle à cette Bataille d’Alger est de retranscrire le plus fidèlement possible les événements, en adoptant un style documentaire véritablement révolutionnaire. Image granuleuse, caméra à l’épaule, acteurs amateurs parmi lesquels certains fellagas, à l’instar de Saâdi, ici dans le rôle de Djafar (seul Jean Martin, comédien très engagé à gauche, est professionnel), l’impression générale est celle d’instants pris sur le vif. En résulte des instants tout droit sortis d’un journal télévisé (les postes se font de plus en plus présents dans les foyers), alors qu’aucune vraie archive n’est utilisée. Des plans tournés au cœur d’Alger montrent la vie foisonnante de la capitale, sur des marchés, à la terrasse de cafés, bondés de figurants qui ignorent visiblement tout du tournage. Au sein du récit, cette recherche de réalisme passe par une approche extrêmement factuelle, éliminant de fait toute narration fictionnelle, tout mélo et tout pathos, comme le précise Jean-Baptiste Thoret dans son introduction. Différentes voix-off lisent des manifestes du FLN, des textes de loi émanant de la métropole, un procès-verbal s’avère même l’occasion de dresser un portrait d’Ali et de son passif de petit délinquant. Pas de sentimentalisme, de psychologisation à outrance. À l’écran, des indications de jour et d’heure apparaissent, renforçant l’impression d’une œuvre documentée, elliptique, quitte à sembler déshumanisée. Les actions des indépendantistes sont très peu théorisées, leurs revendications à peine évoquées, seules leurs actions (et les conséquences de celles-ci) ont droit de cité. Ainsi, la fabrication d’une bombe artisanale en gros plan, un message griffonné sur un bout de papier qui s’échange de main en main, une tenue enfilée à la va-vite pour se fondre dans la foule, deviennent les véritables centres d’intérêt du cinéaste. La lutte pour la liberté s’avère une affaire de gestes plus que d’idées ou de mots. Cette plongée dans la révolte algérienne devint un modèle pour de nombreux groupes qui virent dans le film un manuel de guérilla (Brigades Rouges, IRA, Black Panthers). En 2003, Donald Rumsfeld organisa même une projection au Pentagone afin d’exposer le type de bataille auxquelles l’armée américaine allait être confrontée lors de la seconde guerre du Golfe. L’approche didactique est matérialisée dans le long-métrage lors d’une scène où le colonel Mathieu diffuse des images prises par un reporter (en réalité une séquence précédemment vue, ici filmée sous un autre angle) avant un attentat, pour étudier les stratégies et tactiques de l’adversaire. La sensation de vérité brute que recherche le cinéaste devient alors un enjeu pour les soldats, il faut saisir le réel au plus près et comprendre l’ennemi. L’horreur des actes terroristes ou militaires (que l’on se place d’un côté des belligérants, ou de l’autre), est montrée sans complaisance ni fioritures, au travers de plans sur les victimes sortant des décombres d’une explosion, lors d’une séance de torture où les cris de douleur sont masqués par une chanson dont le volume a été poussé à fond.

(© Copyright Studiocanal)
Si Pontecorvo cherche le réalisme le plus cru, ce n’est pas au détriment d’une vraie puissance formelle évocatrice et de moments de pure mise en scène. Dès le générique, une rafle dans les ruelles d’Alger au son de la superbe bande-originale cosignée par Ennio Morricone et le réalisateur lui-même (collaboration qui entraîna de nombreux désaccords, selon Samuel Blumenfeld, interviewé en bonus) en est un exemple parmi d’autres. Il filme la casbah en plongée, comme pour quadriller la ville, en faire un labyrinthe pour quiconque ignore ses recoins. Il n’hésite pas à utiliser un montage signifiant (la séquence de torture), générateur de suspense (les trois femmes chargées de commettre un attentat, les exécutions de policiers, la première mission du protagoniste) voire d’émotion. Probablement à son corps défendant, le cinéaste n’évite pas une certaine galvanisation, une « romantisation » du geste révolutionnaire, lorsqu’un jeune garçon s’empare d’un micro pour haranguer une foule. C’est cette dichotomie qui fait de La Bataille d’Alger un modèle pour nombre d’auteurs (principalement anglo-saxons, le long-métrage souffrant encore d’un déficit de notoriété en France, probablement dû à sa censure) parmi lesquels Ridley Scott (La Chute du faucon noir), Christopher Nolan (The Dark Knight Rises) ou Steven Soderbergh (Traffic). Construit sur la base d’un long flash-back, le destin d’Ali le voit passer du statut d’arnaqueur déconnecté de tout engagement politique, à celui d’activiste sans pitié. Pour figurer le retour au passé, le film stoppe en un arrêt sur image brutal sur le visage du jeune homme, suivi d’un fondu qui mène en 1954, année de sa prise de conscience idéologique au détour de l’une des séquences les plus fortes. Emprisonné, il assiste impuissant à la mise à mort d’un condamné depuis sa cellule, alors que la caméra s’écarte lorsque la guillotine tombe et qu’elle effectue un zoom brutal sur le regard du protagoniste. Pas de discours édifiant, la simple force de l’image sert à comprendre, à dessiner un personnage. Cette foi en son médium, le réalisateur en fera montre jusqu’à la longue conclusion qu’il achève par un ultime plan iconique, renforçant par là même, le statut d’une œuvre qui peut, par certains aspects relever de la propagande.

(© Copyright Studiocanal)
Quatre ans seulement après son indépendance, l’Algérie, par l’intermédiaire de son gouvernement, cherche à instaurer une mythologie cinématographique, à créer un roman national, qui deviendra une réalité pour ses citoyens, et pour ce faire, elle doit être la première à produire des images de ce conflit selon Blumenfeld. Adhérant à cette volonté, Gillo Pontecorvo aborde son film du point de vue algérien. Issu d’une famille juive qui a fui l’Italie pour immigrer en France lors de la montée du fascisme, ce dernier s’engage dans la résistance et consacre sa vie à la lutte contre la tyrannie, son travail de metteur en scène baignant, quant à lui, dans un anticolonialisme féroce, comme le stipule Thoret. Le cinéaste fait d’Ali (Haggiag était un simple berger analphabète, qui finira par tourner dans l’adaptation de L’Etranger par Visconti) le nœud gordien de son récit, un héros de la révolte rêvant d’émancipation et mû par des principes moraux (il refuse de tirer dans le dos d’un policier). Les conditions de vie des habitants d’Alger sont décrites comme inégalitaires (la différence entre les quartiers blancs et arabes), le racisme omniprésent, allant de l’insulte aux actes de violence (le vieil homme quasiment lynché par une foule), et même les dépositaires de la loi agissent dans l’ignorance de la culture locale. L’interdiction de fouiller une femme, que les soldats transgressent, devient ainsi une arme pour les fellaga. La protestation passe alors par des éléments aussi hétérogènes que la grève nationale, la volonté de célébrer des coutumes traditionnelles, ou être mariés par un membre du FLN plutôt que par un maire nommé par le gouvernement français. S’il ne sombre pas pour autant dans un misérabilisme facile, le réalisateur, fidèle à l’influence de Frantz Fanon et de son essai Les Damnés de la Terre, oppose la misère d’un peuple au train de vie luxueux de ses élites (qui plus est colonialistes). Le commissaire de la ville, passant ses soirées dans le faste des villas occidentales, incarne parfaitement cette bourgeoisie déconnectée des réalités. Brisant le silence alors en vigueur, le metteur en scène introduit son long-métrage par une évocation des tortures perpétrées par la France et filme, avec beaucoup de pudeur, les larmes du supplicié contraint par la force de trahir sa cause.

(© Copyright Studiocanal)
Avant d’être approchés par Yacef Saâdi, Gillo Pontecorvo et Franco Solinas avaient pour projet d’évoquer le sort d’un détachement de parachutistes envoyés en Algérie durant la guerre d’indépendance. De ce projet avorté, il demeure une peinture de l’armée française loin des stéréotypes. Bien moins manichéen que son statut de film propagandiste ne le laisse supposer, La Bataille d’Alger délivre une vision assez critique des agissements du FLN, en même temps qu’il dresse un portrait respectueux de Mathieu (double fictionnel à peine déguisé du général Bigeard). Soldat fidèle et juste, il réprimande ses hommes qui humilient un prisonnier et déclare à la presse avoir beaucoup de respect pour les combattants adverses et leurs idéaux. Cette relation révérencieuse se retrouve même symbolisée à l’écran lors d’une discussion cordiale à l’arrière d’une berline entre le colonel et un chef de réseau qui vient d’être arrêté. Expérimenté et lucide quant à la situation, l’officier convoque le spectre de Diên Biên Phu et l’enlisement des forces françaises, en même temps qu’il rappelle que certains de ses hommes, traités de nazis, furent emprisonnés à Dachau ou Buchenwald (renvoyant sans doute au passé de résistant de Pontecorvo). Les activistes ne sont pas en reste et leur statut de terroristes est maintes fois évoqué. Ali lui-même, simple hors-la-loi au départ, révèle peu à peu un jusqu’au-boutisme qui confine au radicalisme pur et simple. L’islamisation de la société décrétée par le FLN, amène à condamner tout manquement moral aux préceptes religieux et trouve un écho dans cette séquence où des enfants tabassent un homme ivre. L’une des femmes chargées de poser une bombe dans un bar paraît prendre conscience de son geste quand elle aperçoit un petit garçon assis à l’une des tables voisines. Loin d’être des figures résolument positives, les indépendantistes sont aussi sujets à une certaine critique et une remise en cause de leurs méthodes d’action. A contrario, le commissaire qui décide, en compagnie d’autres policiers, de faire exploser une maison, est tout d’abord montré comme un individu esseulé, dépositaire de la loi abandonné par sa hiérarchie et par l’État qui n’a pas encore pris conscience de la gravité de la situation sur place. Contrairement à une croyance bien ancrée, le cinéma français ne s’est pas interdit de parler de la guerre d’Algérie (Samuel Blumenfeld aborde le sujet et cite, entre autres Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard, L’Insoumis d’Alain Cavalier), mais passait sous silence la torture et les exactions. Pontecorvo brise ici tous les tabous, les non-dits, et invente, avec le sublime La Bataille d’Alger, un nouveau langage cinématographique empreint de documentaire. Un grand film politique, viscéral et précurseur en somme.
Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).