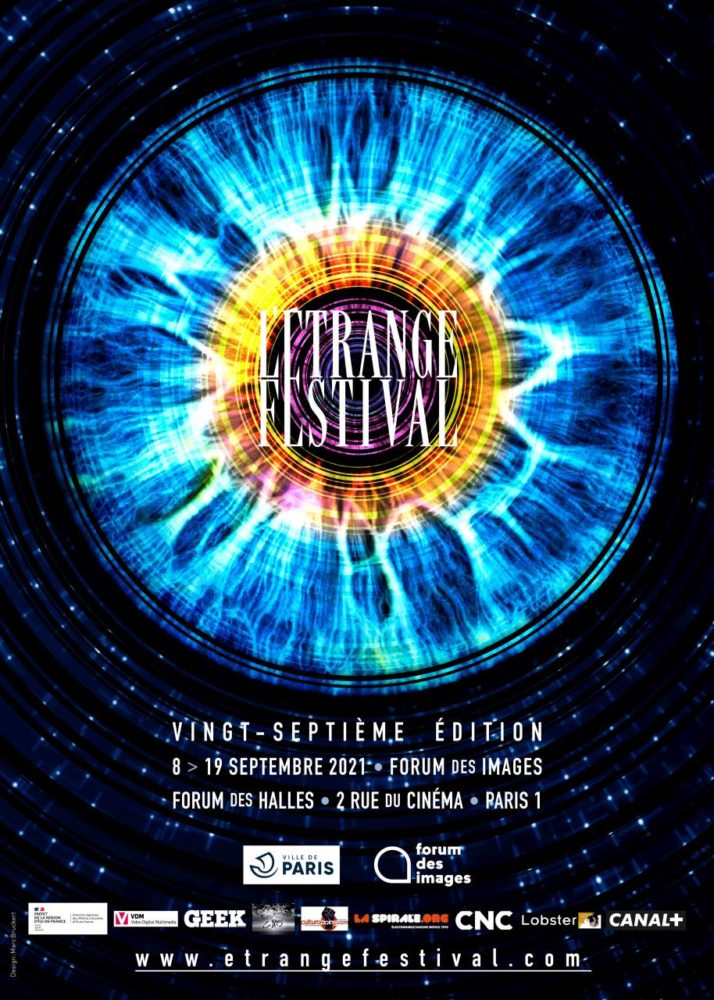Slapstick kazakh
 Surfant sur la vague kazakhe, l’Etrange Festival a placé en compétition officielle Sweetie, You Won’t Believe it, troisième film du réalisateur Yernar Nurgaliyev. Sur le papier, le film était assez attrayant, évoquant par son résumé le plus renommé des écrits de Jerome K. Jerome, Trois hommes sur un bateau. Trois amis, en effet, se retrouvent pour une partie de pêche qui ressemble plus à une fuite en avant pour l’un d’entre eux, en couple avec une virago infernale et sur le point de devenir père. Mais la partie de pêche va devenir un chemin de croix lorsque le futur papa va perdre son pantalon et sa bague de fiançailles, lorsqu’un autre va perdre le lobe de son oreille ainsi que toute une cargaison de poupées gonflables sortis de son sex-shop qu’il transporte dans son fourgon et, surtout, lorsque les Pieds Nickelés vont se faire poursuivre par un gang de caïds pas doués et par un homme borgne et mutique qui ressemble de près ou de loin à une machine à tuer…
Surfant sur la vague kazakhe, l’Etrange Festival a placé en compétition officielle Sweetie, You Won’t Believe it, troisième film du réalisateur Yernar Nurgaliyev. Sur le papier, le film était assez attrayant, évoquant par son résumé le plus renommé des écrits de Jerome K. Jerome, Trois hommes sur un bateau. Trois amis, en effet, se retrouvent pour une partie de pêche qui ressemble plus à une fuite en avant pour l’un d’entre eux, en couple avec une virago infernale et sur le point de devenir père. Mais la partie de pêche va devenir un chemin de croix lorsque le futur papa va perdre son pantalon et sa bague de fiançailles, lorsqu’un autre va perdre le lobe de son oreille ainsi que toute une cargaison de poupées gonflables sortis de son sex-shop qu’il transporte dans son fourgon et, surtout, lorsque les Pieds Nickelés vont se faire poursuivre par un gang de caïds pas doués et par un homme borgne et mutique qui ressemble de près ou de loin à une machine à tuer…
Pas de faux espoir : ce petit film sans véritable prétention est une comédie noire qui ne va pas plus loin que les extravagances que son résumé peut laisser entr’apercevoir. Si Sweetie, You Won’t Believe it est plutôt amusant, il reste cependant très éloigné de la finesse, de l’absurdité, de la force politique, poétique, tragique et formelle des films d’Adilkhan Yerzhanov que nous avons chroniqués dans le premier journal de bord festivalier. Nurgaliyev préfère miser sur quelques facilités slapstick, sur un sens de l’excès et sur un humour noir décomplexé qu’on peut retrouver chez Tarantino et ses multiples épigones. Tout ceci n’est pas sans efficacité ; le réalisateur kazakh s’avère même parfois très talentueux dans ses effets comiques (la scène où l’un des trois compères se dissimule au regard de l’un des tueurs en restant paradoxalement à découvert mais toujours dans son dos est un beau moment directement hérité des grands burlesques). Mais toute cette énergie tourne le plus souvent un peu à vide, le film cultivant une espèce de mauvais goût adolescent (maladresses machistes incluses) tombant à plat la moitié du temps. Au final, une petite comédie potache pas fondamentalement désagréable, plutôt attachante mais dont on oublie vite les tenants et les aboutissants à cause de son récit décousu et de son humour ayant la finesse d’une poignée de gros sel. On est donc loin de Jerome K. Jerome…
Surréalisme pop
 After blue (Paradis sale) est le second film de Bertrand Mandico, l’un des enfants chéris de ce qu’il est confortable d’appeler le « nouveau cinéma français » (il y en a à peu près un par décennie) : un cinéma transgenre, baroque, ultra-référencé mais en même temps très personnel, générateur d’une poésie visuelle le rapprochant d’une façon de « Réalisme magique » post-moderne. Mandico peut être considéré comme un chef de file (de même que Yann Gonzalez), ses formidables Garçons sauvages fourmillant de cinéma à l’état brut étant le film le plus foisonnant, emblématique et impressionnant de ce nouveau mouvement.
After blue (Paradis sale) est le second film de Bertrand Mandico, l’un des enfants chéris de ce qu’il est confortable d’appeler le « nouveau cinéma français » (il y en a à peu près un par décennie) : un cinéma transgenre, baroque, ultra-référencé mais en même temps très personnel, générateur d’une poésie visuelle le rapprochant d’une façon de « Réalisme magique » post-moderne. Mandico peut être considéré comme un chef de file (de même que Yann Gonzalez), ses formidables Garçons sauvages fourmillant de cinéma à l’état brut étant le film le plus foisonnant, emblématique et impressionnant de ce nouveau mouvement.
Son second film, très attendu (la grande salle du Forum des Images était pleine comme un oeuf), est aussi beaucoup plus déconcertant que son fracassant premier coup de maître. Difficile de séparer le bon grain de l’ivraie dans cette œuvre radicalisant la démarche esthétique et poétique de Bertrand Mandico ; After Blue (Paradis sale) est un film-essai en ce sens où chacun des battements de son cœur artistique s’avère une tentative acharnée de renouvellement graphique et narratif, un souhait de Créateur cherchant à créer un univers parallèle au nôtre et à celui qui gouverne le monde du cinéma français plus traditionnel sans conteste constitué d’oeuvres moins uniques que celles de Mandico. Tout cela pour dire que ce second film tente beaucoup de choses, alterne échecs et réussites, moments de grâce absolue et trébuchements laissant parfois dubitatif ; c’est bel et bien l’ensemble de ces creux et crêtes qui font le sel de ce cinéaste si singulier et, de facto, si passionnant.
Sa nouvelle œuvre semble assumer par la mise en situation de son intrigue cette idée d’un cinéma arpentant un univers alternatif : After Blue est une planète colonisée par les Hommes après que la Terre est morte pour des raisons diverses et variées, essentiellement humaines (pollution, guerre, etc.). Disons plutôt colonisée par les femmes : la vie masculine semble impossible en cet endroit de tous les possibles. La jeune Roxie (Paula Luna), fascinée par la criminelle Kate Bush (Agata Buzek), la libère des sables où elle a été enterrée par les « femmes du village ». Après que Kate s’est vengée des amies de Roxie qui l’avaient châtiée, la jeune fille et sa mère (Elina Löwensohn) sont bannies de la communauté jusqu’à ce qu’elles tuent la meurtrière.
Et After Blue (Paradis sale) de mélanger une science-fiction échevelée avec une intrigue presque traditionnelle de western, un cinéma noir que les filtres de couleur faisant de n’importe quel plan de Mandico une griffe artistique transforment en une palette magique avec une sorte de périple médiéval fantastique du genre Tolkien malade, une sexualisation explicite à la Walerian Borowczyc (pourtant moins profondément érotique que Les Garçons sauvages) couplée à un cinéma pop (voire pop art) infusé par une théâtralité presque durassienne. Cette générosité référentielle débouche sur un cinéma-monde pour le moins enthousiasmant du moment que l’on supporte de perdre les repères desquels un cinéma plus classique et habituel nous rend parfois trop dépendants. Il y a quelque chose de la mise en image concrètes des textes surréalistes de Breton ou de Soupault dans cet art tout autant irrigué par les grandes formes classiques que narrativement dilaté, ponctué par quelques images poétiques d’une rare intensité (le personnage de Kate Bush littéralement absorbé par le sable, image sublime et d’une force mystique assez soufflante). La question troublante que pose finalement After Blue (Paradis sale) est la suivante : Bertrand Mandico tient-il plus de l’auteur pérenne ou du phénomène artistique voué à disparaître dans les sables de la mode comme son personnage de meurtrière dans le plus beau moment du film ? Espérons et penchons pour la première hypothèse.
Royaume des Ombres
 On a tous des peurs personnelles enfouies, tapies au fond de nous-mêmes, rendues inaccessibles au monde sensible par les barrières mentales que nous nous forgeons par un réflexe de défense refoulant nos dangers intérieurs. Ce sont ces peurs primitives que le réalisateur canadien Anthony Scott Burns, par le truchement des scientifiques de son film, tente de capturer dans son second long métrage, Bad Dreams (ou Come True selon l’humeur des festivaliers respectant de manière de façon plus ou moins rigoureuse le titre original).
On a tous des peurs personnelles enfouies, tapies au fond de nous-mêmes, rendues inaccessibles au monde sensible par les barrières mentales que nous nous forgeons par un réflexe de défense refoulant nos dangers intérieurs. Ce sont ces peurs primitives que le réalisateur canadien Anthony Scott Burns, par le truchement des scientifiques de son film, tente de capturer dans son second long métrage, Bad Dreams (ou Come True selon l’humeur des festivaliers respectant de manière de façon plus ou moins rigoureuse le titre original).
Le cinéaste et ses personnages ont ceci de commun qu’ils cherchent à sonder l’insondable, à affronter l’abstraction des rêves, à leur donner une texture concrète, à débusquer les inquiétudes qui s’y trouvent dissimulées. Ici, les scientifiques tentant de capter l’essence des rêves et des cauchemars dans un dispositif de recherche sondant l’esprit de cobayes humains profondément endormis filment le contenu onirique de leurs patients, avec pour objectif inavoué d’enregistrer l’image de cet être intérieur que nous recelons universellement en nous, qui envahit nos cauchemars et tente de s’emparer des dormeurs rendus impuissants par leur torpeur. L’une de ces patientes, Sarah (Julia Sarah Stone, actrice ô combien intense !), semble particulièrement réceptive et tente alors de lutter simultanément contre les problèmes éthiques posés par le test scientifique (sonder l’Inconscient, n’est-ce pas sonder l’intimité intellectuelle de l’être ?) et contre le monstre de nos cauchemars qui commence à se matérialiser pour elle dans le monde sensible.
La grande beauté de Bad Dreams provient du fait qu’Anthony Scott Burns élabore sa mise en scène autour de l’idée absolument capitale que l’Inconscient est un territoire inconnu, dont la cartographie a toujours été inaboutie car par essence impossible. L’enregistrement des rêves et les images qu’ils produisent sur les moniteurs des scientifiques donnent lieu à des représentations qui ressemblent moins à une réalité analogique qu’à une sorte d’abstraction au psychédélisme terne (les images cumulent des frises géométriques hypnotiques mais grisâtres et comme griffées eu égard à la vétusté manifeste des appareils vidéo), puis à une agrégation de formes qui semblent créer, en effet, un espace plus concret habité par une silhouette dominante, sombre et apparemment immobile hantant tant l’espace onirique que la représentation graphique. Misant sur la latence de la mise en scène, sur l’inquiétude d’un monde inconnu et figé (que nous retrouvons sous une autre forme dans les rêves de Sarah plus concrètement mis en scène à quatre ou cinq reprises, ostensiblement numériques donc artificiels et constamment hantés par des êtres indéfinis) plutôt que sur le lieu commun d’un monde effroyable où la peur surgit de tous les recoins (option qui peut par ailleurs s’avérer intéressante selon les films), Anthony Scott Burns réalise l’anti-Insidious, faisant de l’Inconscient et du monde des rêves un endroit indéterminé se rebellant lorsqu’on veut le maîtriser, ceci en rognant sur le réel (la scène de la forêt, saisissante et glaçante, provoquant tout à la fois un effroi presque carpenterien et une fascination esthétique proche des rêveries de Weerasethakul). Un espace qui devient une nouvelle forme de Royaume des Ombres, l’état de sommeil se substituant alors à quelque chose qui serait de l’ordre de la mort. Cet effroi sourd et romantique, à la poésie inquiétante, rehaussé par les nappes de synthés presque aquatiques du groupe Electric Youth, font définitivement de Bad Dreams un film marquant et singulièrement émouvant.
Michaël Delavaud
 Dans sa présentation érudite et enthousiaste, Julien Séveon resitua Limbo et son réalisateur dans le contexte de la production hong-kongienne contemporaine, Soi Cheang faisant figure d’outsider à force d’esthétique léchée et de scénarios puisant autant dans la réalité sociale du pays que dans les standards hollywoodiens du genre.
Dans sa présentation érudite et enthousiaste, Julien Séveon resitua Limbo et son réalisateur dans le contexte de la production hong-kongienne contemporaine, Soi Cheang faisant figure d’outsider à force d’esthétique léchée et de scénarios puisant autant dans la réalité sociale du pays que dans les standards hollywoodiens du genre.
Avec son dernier film, on tient clairement l’un des chocs du festival, le cinéaste composant avec son polar un magnifique tableau d’apocalypse, Limbo plongeant à l’image de son titre dans les méandres de l’enfer, faisant graduellement passer son Hong-Kong de bidonville et de décharges publiques du côté du fantastique. Les intempéries déchaînées et la nuit enveloppent les personnages et les font glisser vers l’inconnu, une sauvagerie dans laquelle ils se laissent happer, comme une matérialisation de leurs démons intérieurs.
On reconnaîtra sans doute, dans le duo formé par le vieux briscard Cham Lau et le bleu Will Ren, un archétype du polar. Quand ceux-ci partent à la poursuite de l’assassin, Cham est confronté à Wong To, la jeune délinquante responsable de l’accident de sa femme. Le ressentiment de l’un et la soif d’expiation de l’autre finiront par les mettre en danger quand leurs destins croiseront celui du tueur…Le mal de dents persistant de Will ne semble rien à côté de l’abîme que courtisent les deux autres, leur attirance pour le vide.
C’est peut-être ici que Limbo paraît le plus fascinant et le plus cruel lorsque Wong To, dans son parcours doloriste – quasiment celui d’une martyre – dame le pion aux deux héros, devenant le repère émotif de l’œuvre. Désemparée, désespérée, déchirante. Le spectateur est effaré par ce qu’elle subit, la manière dont ces deux flics se servent d’elle comme appât quitte à l’exposer aux pires horreurs dans une quasi-indifférence. Une femme, comme un objet utile ne faisant l’objet d’aucune compassion. C’est probablement par le prisme de son regard, ses cris et ses pleurs que Limbo devient le plus bouleversant. En ayant l’air d’illustrer les codes d’un polar nihiliste et urbain à la Seven, le film de Soi Cheang déconstruit les clichés de virilité, pointe du doigt une misogynie innée que même le désespoir intime ne peut excuser, à travers cette terrible aventure de Wong To, toujours ballottée, entre la violence légale et celle d’un tueur fou.
Certains reprocheront à cette intrigue de céder parfois à la facilité et de frôler l’invraisemblance, d’autres verront dans ce côté aussi brut dans l’intensité des poursuites à rallonges et la violence des bastons que dans les dialogues secs, l’expression de sentiments tragiques et cathartiques intemporels (nous pencherons de ce côté !). Car plus qu’un simple polar, Limbo ressemble à une tragédie grecque des temps eschatologiques, où l’individu ressemble à une marionnette impuissante – quelle ironie que le tueur soit un coupeur de mains – dans lequel les rouages du destin se confrontent au chaos.
Mais ce qui emporte l’adhésion de tous est la force des images, qui se présente comme une succession de tableaux noirs, parfaitement cadrés, et d’ambiances formidablement malaisantes, nous plongeant allègrement dans les bennes à ordures où le son terriblement réaliste des essaims de mouches autour d’un cadavre laissent place à l’émouvante et lyrique partition du grand Kenji Kawai, dont le lyrisme soutient à merveille le ton à part de ce polar grand format, entre ambiance (littéralement) trash et classicisme.
Loin d’être une afféterie visuelle, le noir et blanc alternant la brume confuse et le contraste est l’un des plus beaux vus depuis longtemps, renvoyant aux plus beaux films japonais tels La Harpe Birmane et Feux dans La plaine de Kon Ichikawa qui filmait si magnifiquement la boue et la pluie. On n’est pas prêts d’oublier ce décor final, cloaque entremêlant mannequins démantibulés et vrais corps, champ de bataille poétique et irrespirable, exposant dans une puissance à couper le souffle la beauté de l’horreur. Un requiem en gris et sang.
Witold Bolik et Olivier Rossignot
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).