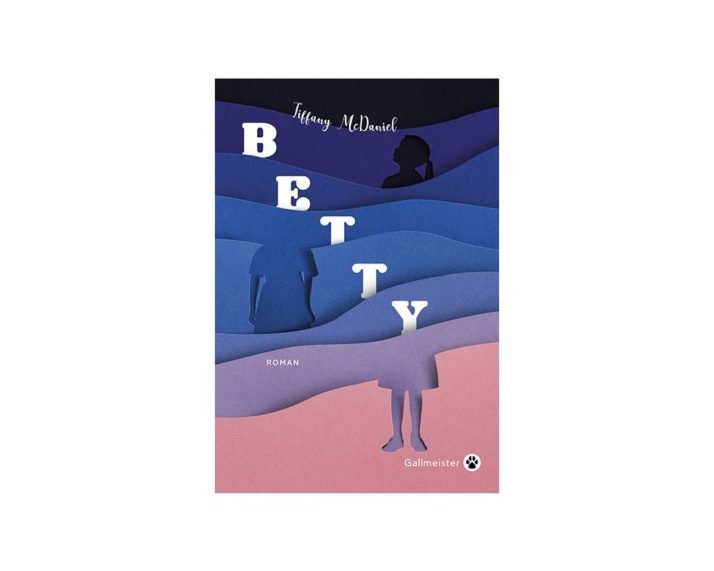C’est un jour de 1954, au cœur sombre de l’Arkansas, et dans une baignoire aussi pauvre que le corps qui s’y trouve, nait Betty. Betty Carpenter : 6e des 8 enfants de Landon Carpenter, d’origine Cherokee, et de sa femme, Alka Lark, fermière blanche. Betty a un malheur : elle nait plus sombre de peaux que ses frères et sœurs. C’est elle, la petite indienne.
Betty, c’est aussi la mère de Tiffany McDaniel, qui a mis plus de 17 ans à accoucher, non d’une biographie, mais d’un roman enchanté et douloureux, autant rêve que cauchemar, et qui, tout juste paru chez les défricheurs Gallmeister (et traduit avec brio et fluidité par Francois Happe), ne pourra jamais mieux se résumer que son exergue :
« Ma mère, Betty, est née le 12 Février 1954 à Ozark, dans l’Arkansas, fille d’une femme aussi saisissante qu’un rêve et d’un père cherokee qui fabriquait son propre alcool de contrebande et créait ses propres mythes. Avec ses onze frères et sœurs, ma mère a grandi dans les contreforts des Appalaches de l’Ohio. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l’histoire qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne.
Je t’aime, maman. Ce livre est pour toi et toute ta magie immémoriale. »
C’est qu’on ne saurait mieux saisir l’étrange magie qui se dégage de cette galerie émouvante de personnages que l’on ne peut que vous laisser découvrir, de ce quasi huis-clos (à l’échelle d’un terrain) où la maison devient le petit théâtre du monde, de cette traversée pourtant initialement vissée à l’American story des confins la plus pure, récit d’une éducation d’une héroïne farouche, empreinte de liberté malgré le poids de l’Histoire, et la description minutieuse sous forme de fresque chorale d’une cellule familiale, entre 1950 et 1960, dont la pauvreté n’a d’égal que la haine que d’aucuns leur porte, notamment à Betty, d’être différents : pas question de jouer une fée au spectacle de l’école, pas question de pouvoir prendre la parole à l’école, et bienvenue aux surnoms, aux humiliations, à la mine ou en ville.
Et encore, si la violence s’échappait uniquement à l’extérieur : mais, famille je vous hais, les secrets et les douleurs se transportent aussi tout au long de l’histoire intime, qu’on ne pourra ici dévoiler.
- Un livre d’histoires.
« Tandis que d’autres parlaient de la réalité, eux parlaient de ce qu’ils croyaient. »
Pour contrer ces violences, il n’y a qu’une solution : l’imaginaire et les mots.
C’est le cœur du projet, et le pouls le plus sublime de l’ouvrage, incarné à lui seul par la petite Betty, enterrant des morceaux de récits dans « Le bout du monde », cette scène de bric et de broc où les enfants viennent rejouer la vie quotidienne sous forme de joute ou s’échapper par le rêve.
Mais c’est aussi et surtout le personnage magnifique de Landon, clef de voute du récit, père sculptant le visage de tous ses enfants dans la canne qui lui sert à marcher (métaphoriquement et physiquement), et qui choisira la seule issue possible : puisqu’il n’a pas le pouvoir, puisqu’il n’a pas l’argent, puisqu’il n’a pas la « couleur », alors il a au moins ses mots, et il peuple chacun de ses gestes d’un rite, d’un conte, d’une histoire quelconque qu’il peut utiliser pour explique ce qui ne se peut pas.
La violence de la Nature, certes, sa beauté, mais aussi la saloperie des Hommes, dont il cherche à tout prix à écarter Betty et les autres, quitte à s’oublier.
« Tu sais pourquoi ces collines ont été créées, Petit Indienne ? Elles ont été faites pour que les hommes puissent monter au sommet et faire rouler leurs péchés jusqu’en bas. Le Créateur est sage, Betty. C’est pour cette raison qu’Il n’a pas fait de ce monde une simple étendue de terre toute plate.
Il s’est levé et a essayé d’enfoncer le bout de sa chaussure dans le sol. Il est parvenu à déloger deux cailloux de la terre gelée.
-Toutes ces collines autour de nous…Dieu devait savoir que nous, les Carpenter, ferions de ce pays notre maison.
Il m’a tendu un des deux cailloux et il a gardé l’autre pour lui.
En poussant un grognement, il a lancé sa pierre vers le bas de la colline.
-Viens, Petite Indienne. (Il m’a tendu les bras.) Donne-la aux collines. »
Toute la relation bouleversante au père est, au fond, à l’image de ce passage : d’une tendresse et d’une douceur infinie, qui n’exclut pas le malheur, mais le relie. Aux autres, mais surtout à une forme d’animisme millénaire, de contes séculaires, où les cœurs sont en verre, les étoiles des fruits pas mûrs, les bois environnés de propriétés magiques, les colibris porteurs de feu au milieu de gouttes de pluie.
« Peut-être que quelque part, mon père joue encore de cette trompette et que ma mère est toujours en train de le regarder. Je crois qu’à eux deux, ils auraient pu être plutôt bons en amour. Dommage que le chagrin ait tout transformé en mythes. »
Cet horizon apotropaïque protège finalement moins du Mal, impossible d’être contenu, que de la tristesse : celui du spectre d’une mère qu’on imagine un temps dépressive et folle, des deuils et des douleurs, le frère absent, ceux morts trop vite, le petit Lint sans doute autiste.
« Fraya a semblé sur le point de pleurer à cette idée. J’ai compris une chose à ce moment-là : non seulement Papa avait besoin que l’on croie à ses histoires, mais nous avions tout autant besoin d’y croire aussi. Croire aux étoiles pas encore mûres. Croire que les aigles sont capables de faire des choses extraordinaires. En fait, nous nous raccrochions comme des forcenées à l’espoir que la vie ne se limitait pas à la simple réalité autour de nous. Alors seulement pouvions-nous prétendre à une destinée autre que celle à laquelle nous nous sentions condamnées. »
Qu’importe, au fond, si personne n’est dupe, au contraire :
-Quel goût ca a ?
-Ce qui compte, ce n’est pas quel goût ca a pour vous, mais quel goût ca a pour le serpent. C’est pour ca que vous toussez. Vous avez un serpent juste ici, a poursuivi Papa en lui touchant la gorge. Et le serpent va trouver cette boisson très très bonne. Si bonne en fait, qu’il va avoir envie de se glisser hors de vous immédiatement. Si vous sentez cela, allez à la rivière et laissez le vomi sortir. L’eau apaisera la colère de la toux et rafraichira la chaleur du serpent.
-On m’avait prévenue que vous pourriez dire des choses bizarres comme ca, a réagi la femme.
-Je trouve qu’une petite dose d’histoire à raconter complète bien le remède. »
Tant pis si l’on ment, tant que l’on sauve et que l’on poétise le monde et le livre tout entier se perfuse à cette magie.
- Des femmes puissantes
« -Dieu nous hait.
-Nous, les Carpenter ?
-Nous, les femmes. »
S’il n’était que cela, Betty serait déjà un conte sublime, d’une poésie folle qu’elle établit avec une précision hallucinante, dans un univers qui doit autant aux fables, au Grand Sud ou à une forme de « naturalisme magique », si tant est que cela puisse exister.
Mais alors que le temps passe, que défilent les pages, Betty devient le roman d’une éducation féministe, une ode aux femmes et à leur corps : celui qui change (l’arrivée de la menstruation chez les sœurs), qui vieillit, que l’on craint (« Sorcière » répété régulièrement), que l’on possède, bien trop souvent de force.
Sans trop en révéler, deux séquences parmi des dizaines témoignent de cette tension qui court dans le roman comme sur un épiderme.
Au mitan du roman, Betty voit dans l’ombre de la nuit le corps vieillissant de la femme chez qui elle travaille, que l’on surnomme « la vieille » (et tout un panel autour de prostituée), et qui souffre de ne pas être désirée encore. Quand dans la moiteur nocturne Betty lui avoue les surnoms dont on l’affuble, elle lui révèle le secret de ce corps fatigué. Celui d’une âme aimant les filles, qui a vu son amante démolie physiquement, internée, et qui a décidé de faire commerce de soi, de préférer l’insulte à l’accusation.
« On n’essaie pas de guérir une femme qui couche avec des hommes. On la paie. »
Quelques pages plus tôt, Betty avait donné rendez-vous à un garçon l’ayant pris en autostop, et s’était récrié au dernier moment, se refusant à lui. Quand il lui a demandé pourquoi, elle lui a simplement répondu : « pour savoir si non signifiait encore quelque chose ».
La maman et la putain, la blanche ou la noire, la femme ou la sorcière, la magicienne ou la romancière : Comment être libre et tourbillonnante ? Comment être soi ? Comment être femme ?
- Ode, danse, chant : « aussi saisissant(e) qu’un rêve »
Chronique douce et amère, biographie rêvée ou cauchemardée, traversée intime de plus de 700 pages, roman d’une innocence perdue et d’une renaissance, conte qui aurait remplacé le merveilleux par l’ancestral. On ne saurait dire, et la beauté poétique de Betty est d’être sans doute tout cela à la fois.
Un livre de Tendresses, un livre de violence. Surtout un très très grand livre d’Amour, seule issue aux maux.
On pourra trouver que le malheur s’abat un peu trop sur les Carpenter, que de la fiction au réel, il se tisse un mouchoir par trop larmoyant de morts et de tristesse. On pourra, aussi, trouver que, bien que superbes (les histoires entendues devenant des histoires dites), les 100 dernières pages tirent un peu trop en longueur et en explicatif, comme incapables de s’en aller. Trouver que la magie du début s’y perd un peu, dans les adieux, et que le roman, passé sa poésie, reste dans les clous d’un récit des confins comme l’Amérique en produit tant. On pourra.
Mais il faudrait alors aussi pouvoir dire ce que les critiques, celles-ci incluse, ne parviennent pas à dire. Réussir à dire cet équilibre envoutant qui fait qu’on ne parvient jamais à les quitter, cet entrelacs indistinct de réel et de conte, de tendresse infinie et de violence bouleversante. Dire à quel point ils nous hantent : Landon, Trustin, la mère, Bettie-Flossie-Fraya, Leland, aussi, et les petits absents, morts trop vite.
Dire enfin que l’on ressort de ce grand roman avec le sentiment, non seulement d’avoir rencontré les Carpenter, mais d’avoir partagé, au long de 700 pages et quelques années, leur existence de magie et de douleur. N’est-ce pas, là, au fond, le signe émouvant de la Littérature ?
« Je ne sais pas si je t’ai déjà dit que je t’aimais, Petite Indienne. Je ne sais pas si je t’ai déjà dit ces mots.
-Tu les disais à chaque fois que tu me racontais une histoire. »
Editions Gallmeister, 720 pages, 26.40 euros. En librairie.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).