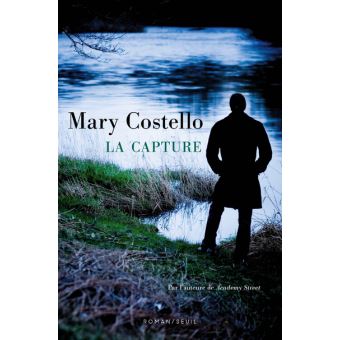Un matin, on frappe à la porte. Luke O’ Brien est surpris, lui, le professeur de lettres et spécialiste du vénérable James Joyce (quand il ne soliloque pas sur Bloom) qui a fui la ville pour s’installer sur les terres de famille pour écrire son grand œuvre sur l’irlandais d’Ulysses.
On frappe, et c’est le coup de foudre : Ruth. Le cœur s’anime, la vie revient hanter Luke. Mais quand il décide de présenter son amour à sa tante, le froid glacial avait laquelle il la recoit l’interpelle.
Mais quand elle lui demande de cesser de la fréquenter, la fêlure est installée : Luke va s’enfoncer peu à peu dans une spirale mentale vertigineuse.
Après « Academy Street », méditation sur la solitude et la puissance du monde intérieur (et, déjà, la consolation qu’apportent les livres), le nouveau roman de Mary Costello, « La capture« , traduit par Madeleine Nasalik et tout juste paru au Seuil est surtout et avant tout, au-delà de son histoire de cœur, l’histoire de cette ligne de rupture. L’histoire d’une douceur et d’une violence, qui contamine le récit, son héros, et sa structure.
- “Now those memories come back to haunt me” (The river, B. Springsteen)
« Ce n’est pas le travail qui manque. Le souci, c’est la motivation. Cette vie solitaire engendre chez lui une inertie extrême. Certains jours il lui arrive de penser qu’il est resté assis sans bouger dans la même position pendant quelques minutes alors que plusieurs heures se sont écoulées et soudain midi sonne, ou l’après-midi est entamé, ou il est seize heures, et dehors la journée n’a plus du tout la même allure.Il pourrait réintégrer son poste d’enseignant à Belvedere. Ces années-là comptent parmi les plus heureuses de sa vie, l’époque où il se réveillait allongé près de Maeve dans leur petit appartement sur Harold’s Cross. Son souffle tiède, son corps. Une étreinte, mal réveillés, avant l’aube, le goût et l’odeur qu’elle laissait sur sa langue, sur ses doigts. Debout sous le jet de douche brûlant, hébété, propre, puis à l’assaut de l’air vif du matin. Les pieds au chaud dans des bottines en nubuck souple achetées chez Clarks sur Grafton Street. »
Dans ce long monologue qui s’ouvre sur un mouvement lento à la Woolf (pour ne pas citer, une fois de plus, l’évidence Joyce qui perfuse le roman), Mary Costello accouche d’une écriture d’une exquise élégance, où dans le flux de pensée du regardeur rôde la mort : celle des proches, bien sûr, dans cette grande bâtisse où le personnage principal erre comme un spectre, de son père, d’un enfant perdu, de l’AVC sans retour de sa, celle de Joyce, aussi, dont l’obsession le mènera au seuil de la folie.
Cette lente litanie teinte l’espace même, injectant sa longue traîne de douleur au monde : il suffit de voir comment une simple visite de la ville voisine se transforme en lente litanie d’absence et de drames. Les fantômes hantent les pubs, le supermarché du coin fait ressurgir les diners dominicaux, la longue route rappelle les enfants violés pour quelques sous par le chef de chantier.
« D’un regard nerveux il examine les troncs. Il doit presque se faire violence. Il remonte la rangée. Pas de nécrose en vue, rien qui suinte. »
Mais la véritable force de la première moitié du récit, c’est qu’à la manière d’un Caspar David Friedrich (auquel la couverture, plutôt moche, rend hommage), en l’attachant au paysage, à la ville, à la maison, le deuil ne s’y teinte jamais de douleur exhibitionniste : on passe dessus comme on l’effleure du regard, avant d’apercevoir du coin de la rétine le perron des marches, et de passer ainsi au souvenir suivant.
Avec l’élégance toujours, de la promenade.
- avec l’amour et avec la mort.
« Il poursuit sa marche. La marée ne va pas tarder à s’inverser au niveau de la Pointe et entamer son périple retour. Il aimerait arrêter le temps à cette seconde précise, assister au moment où la volte-face se produit, où le courant opère sa bascule et entreprend de rallier son point de départ, l’océan. Il incline la tête, l’oreille tendue. »
Au fur et à mesure de sa partition, La Capture se dévoile alors comme un livre de crête : entre la vie et la mort, bien sûr, le présent le souvenir, le réel et Joyce (l’un contaminant l’autre, aussi), le désir et le devoir, le romantisme suranné et la modernité de sa déconstruction.
C’est qu’après la révélation de Tante Ellen, le livre plonge à corps perdu dans la dissolution que subit son personnage, dans un jeu de questions/réponses faussement méthodique au ton d’interrogatoire et de procès, oscillant du factuel à la déréliction mentale.
Le pastiche, à la manière de Luke s’obstinant jusqu’à la folie (ou la capillotraction) à se chercher des similitudes avec Bloom, n’est jamais loin, dans cet hommage plus qu’appuyé au chapitre 17 de « Ulysses », Ithaca, créant une distance inaltérable avec le lecteur, exacerbée encore par le fond conceptuel, puzzle mental repoussant.
Quelle est donc cette chose qui s’abat soudain sur son esprit ?
Ce sont les ténèbres qui s’abattent soudain sur son esprit.
Causées par ?
Par l’image de sa tante dans la position où il l’a quittée ce matin. Une image qui la montre assise dans sa chambre jusqu’au soir tandis que lentement les heures s’égrènent. La conscience de toutes ces heures, tous ces jours, toutes ces années, où il n’a rien su de sa souffrance.
Quelles autres images, suivies de quel mot précis, lui traversent-elles l’esprit ?
Une rue de New York un matin de mai, une femme le poing fermé sur un morceau de papier, une adresse griffonnée dessus, un concierge sur Park Avenue qui lui montre l’ascenseur et l’enfilade de pièces au quatrième étage. Un homme distingué, grand, les cheveux gris, en blouse blanche. Ses trompes de Fallope où il fait noir et silence, son utérus rose tendre en jachère éternelle. Le mot intacte.
Quelles opinions, quels sentiments nourrit-il à l’égard de Maurice Mulvey ?
Malgré ses efforts, il se trouve incapable de se représenter cet homme. Une silhouette sombre et floue, comme le protagoniste d’un film noir, qui entre dans sa conscience et en sort à pas furtifs, avec Ellen parfois à proximité. Ensuite, lorsque sa souffrance lui revient en mémoire, un déferlement de fureur. C’est, songe-t-il, la quintessence du mal, la façon dont Mulvey a agi. Il lui semble inconcevable qu’un homme puisse se conduire ainsi – quelles seraient ses motivations ? Le mal pur, atavique ? Ou le démon de la perversité ? Non, le mal pur.
Pour quelle raison Luke repense-t-il soudain à Raskolnikov ?
Parce que Raskolnikov est un pécheur, et c’est le péché, la psychologie du péché et la propagation des ténèbres à travers l’âme qui fascinait Dostoïevski. Et qui fascine Luke, également, rien de ce qui est humain ne lui étant étranger.
La folie y trace alors son chemin d’une manière implacable, mathématique, implosant autant au coeur récit, de l’esprit de Luke que de l’expérience du lecteur, dans cette longue logorrhée aqueuse et acérée, aussi cartésienne qu’obsessionnelle, cherchant dans un geste absolument épuisant à joindre les étoiles impossibles que sont Joyce, Ulysse, la Syphilis, la quantité de viande ingurgitée par un adulte, l’attirance homosexuelle, le poids du passé, le destin de l’univers.
De cette décomposition, cette expérience des frontières (de la santé mentale, de la fiction, de l’hommage), que seule un bapteme magnétique parviendra à laver (renouant ainsi avec le début romantique du récit), on ressort essoré, rejeté comme son personnage sur la rive, à la fois épuisé du dispositif écrasant, vaguement ennuyé ou écœuré, mais avec le sentiment que son architecture fasciste et inébranlable est aussi la clef de sa proposition littéraire et du vertige qui nous habite suite à son expérience, avec le sentiment d’avoir approché au mieux, dans ses délires comme dans son socratisme, le glissement quasi entomologiste d’un « Moi » qui se dissout.
- La capture
Si la Capture est un phénomène géologique qui voit le cours d’une rivière changer son lit pour en rejoindre une autre, oscillant et se détournant parfois durablement, on se questionne, alors, dans ce livre aussi intellectuel que sensible, théorique que poétique, aussi raté (la mécanicité de sa seconde partie, qui oscille du fascinant au « truc ») que puissant et émouvant : du lecteur à l’auteur, de nous à Luke, de Ulysse à l’Irlande, de Luke à Bloom, de Joyce au réel, de la fiction à la Nature, de la folie à la Nature, quel limon charrie notre âme, qui capture réellement qui ?
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).