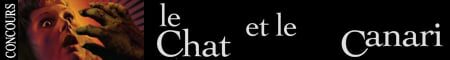Alors qu’approche la prochaine édition du Festival de Berlin, le grand gagnant de la dernière en date, Mère et fils du Roumain Calin Peter Netzer, est enfin à l’affiche en France, et on ne peut que souhaiter qu’il y fera la même très forte impression qu’Une séparation, récompensé lui aussi par l’Ours d’or il y a deux ans, car il fait bel et bien partie, lui aussi, de ces films qui vous frappent comme la foudre d’une manière qu’on n’oublie pas et rendent presque palpable, par la puissance de l’effet qu’ils produisent, une certaine idée de la perfection cinématographique. Le scénario comme la mise en scène sont impeccables, rapides mais profondément intelligents, infiniment nuancés et complètement implacables. Le réalisme de l’approche de Peter Netzer fait honneur à cette précision toute roumaine qui ne limite pas l’observation aux faits mais scrute tous les détails des mécanismes psychologiques et sociaux qui les déterminent, et fait ainsi résonner pleinement tout le réseau des enjeux représentés, offrant du même coup des scènes de dialogue à couper le souffle.
Comme Une séparation, ce lauréat de l’Ours a une carrure presque monumentale. C’est un film finement ouvragé mais aussi massif, imposant. Cette qualité architecturale tient peut-être au fait que les deux oeuvres émergent de deux cultures marquées par l’incontournabilité de structures de toutes sortes – étatiques, morales… – dont elles véhiculent tout le poids, peut-être au fait qu’elles donnent à l’intime qu’elles pénétrent une telle amplitude que son écho retentissant embrasse des réalités de plus en plus vastes, passant de la famille à la société et au système qui lui donne sa forme.

Il ne faut pas longtemps à Mère et fils pour passer du chuchotement au brouhaha. Le titre annonce une histoire personnelle, le tableau d’une relation, et la scène d’ouverture est une confidence (à une personne invisible que représente la caméra), mais ce ton de confidence est déceptif : à mesure que Cornelia , une mère sexagénaire appartenant manifestement (entendre : « elle le manifeste ») à une haute société cultivée et riche, prolonge son monologue geignard, au lieu de compatir, on est rapidement amené à ressentir pour cette femme une répugnance croissante. Ce revirement coïncide avec le moment où l’on s’aperçoit que l’ingratitude des hommes que déplore Cornelia, et le fait qu’ils sont systématiquement en dessous de tout, sont des torts attribués en particulier à son fils Barbu (Bogdan Dumitrache), cette vile, lâche et paresseuse prunelle de ses yeux qui ne viendra même pas à sa fête d’anniversaire ! L’élément malsain introduit à ce moment-là est redoublé par le sentiment d’importance qui transpire de toute la personne de Cornelia, bien qu’elle se présente comme une victime. Ce sentiment d’importance devient vite infect placé dans le contexte plus vaste de la société dont cette femme s’entoure et qui se repaît de son snobisme (elle colle au plus près à l’étymologie du mot, « sans noblesse »), exacerbé par la mention régulière que ces gens font de leurs « contacts » hauts-placés – et les multiples coups de téléphone qui vont avec.

C’est justement par le téléphone qu’arrive l’affreuse nouvelle. Soudain, en pleine fête d’anniversaire, le prélude pour violoncelle de Bach que Cornelia a choisi comme sonnerie précède une funeste annonce : Barbu a eu un accident pour excès de vitesse et il a tué un enfant, réduisant son corps en charpie. Cornelia est saisie d’horreur : cela pourrait mettre en danger la future carrière de médecin de son rejeton trentenaire !
La scène de commissariat de police qui suit est particulièrement immonde, car elle expose la répugnance éhontée qu’ont la mère et son fils meurtrier à obtempérer aux tests et questions qu’impose l’enquête. Barbu, qui a une telle phobie des bactéries qu’il refuse qu’on le touche directement sans mettre des gants ou stériliser l’environnement, est outré qu’on ose lui imposer un test sanguin sans lui avoir prouvé que l’aiguille du kit réglementaire est bien neuve. À lui comme à sa famille, il semble scandaleux que les agents se permettent de le loger à la même enseigne que le reste des administrés.

Comme l’accident et les frictions qui se sont ensuivies avec l’indigente famille de la victime ont bien fatigué l’éternel étudiant, de concert avec sa compagne, Cornelia décide comme toujours de préserver son malheureux garçon. Son instinct maternel tentaculaire se met en position d’attaque. Il va lui falloir acheter un faux témoignage (dans une scène de marchandage qui est un autre parangon de bassesse humaine), financer l’enterrement, convaincre Barbu de s’y rendre pour avoir de meilleures chances de contourner la sanction pénale qu’il encourt… La mère ne néglige aucun détail : aucun secret n’échappe à sa surveillance intrusive et en tant qu’ancienne décoratrice pour le cinéma, elle sait manier les apparences, les forcer. Elle fait de la négociation une manipulation dont l’iniquité est parfaitement étouffante. Les dialogues sont époustouflants parce que les dés sont pipés : quiconque s’oppose à la domination de la mère devra ployer sous ses sophismes perfides et son masque d’émotions feintes.

Tandis qu’elle « s’arrange » avec les uns et les autres (entendre : « elle les soumet à la machine de guerre argumentative qu’elle déploie »), on prend aussi la mesure de sa responsabilité dans la couardise de son fils. L’embryon d’une prise de conscience se forme d’ailleurs un instant chez ce dernier, mais il est vite anéanti. C’est que plus que l’emprise de Cornelia sur son fils, le coeur du récit est vraiment l’effrayant tableau que fait Peter Netzer de la manière dont le pouvoir dominant en général s’impose au reste de la société, faisant de sa fausse logique (d’autant plus abjecte et lâche qu’elle se sert d’une notion qu’elle-même rejette : la compassion, l’empathie pour l’Autre, cet Autre qui l’indiffère absolument) la raison de tous, de son mépris une valeur absolue qui l’accompagne fidèlement jusqu’aux extrêmes de la bassesse et d’une inhumanité que l’esprit refuse de toutes ses forces à se représenter – et qui atteint son point d’orgue dans un plaidoyer final qui laisse bouche bée.
Mère et fils se veut révoltant, suffocant, insupportable. Il se veut désespérant, il est l’expression d’un écrasement, d’une impuissance totale à tous les niveaux devant un système organisé en castes. Il parle de toute une société, de tout un pays, avec une dureté inflexible car sans aucune illusion. C’est un film magistral, magnifique.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).