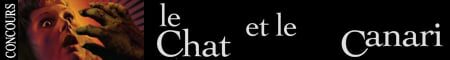Réciter ! Quand je suis pris par la folie
Je ne sais plus ce que je dis et ce que je fais !
Pourtant… c’est nécessaire… force-toi !
Bah, tu es peut-être un homme ?
(Vesti la giubbia, issu de l’opéra « Paggliaci », de Ruggero Leoncavallo. Traduction libre)
« Je n’ai qu’une certitude dans la vie. En vivant assez longtemps on se met à perdre des chhoses. On finit par se les faire voler : d’abord on perd sa jeunesse, et puis ses parents, et puis on perd ses amis, et puis finalement on se perd soi-même. »
On ne peut pas vraiment dire que ca aille au mieux, pour Scott, alors que démarre « Le livre de Sarah » : alcoolique notoire en déshérence, il réalise peu à peu que sa femme veut divorcer, et que cette fois-ci rien n’est réparable. De cuite sur le parking du Walmart aux souvenirs heureux, d’appartement minables en passage chez le juge, il prend donc son désespoir à bras la plume, pour nous conter l’histoire d’un naufrage. Celui d’un mariage, celui d’un amour, d’un père, d’un homme.
Difficile de résumer en plus de mots ce « Livre de Sarah » et paru aux Editions de l’Olivier, dont le héros ne s’intitule pas simplement Scott, mais Scott McClahan, auteur aussi du présent opus, et qui perpétue ici son œuvre autobiographique et enragée découverte en France avec le percutant Crapalachia : celle d’une Amérique des oubliés, des laissés sur le bord de route par le rêve, au cœur de l’une des régions les plus déshéritées du pays, la chaine des Appalaches où viennent s’éteindre les feux de la côte Est avant le grand vide.
- Des tripes et du triste.
C’est ce grand Vide, intime, lui, que vient conter Scott dans ces courts chapitres à la langue rythmée, aux phrases serrées et syncopées par une forme d’urgence, de celle de la connivence de piliers de bar (je t’ai raconté la fois où ?). Le lecteur y avance à tâtons, claudiquant d’un souvenir à l’autre, passant du présent narratif du divorce aux éclats du passé (les moments d’intimité, de rire, les premiers rendez-vous, les choses absurdes que l’on fait par amour comme créer une plage dans le salon après des vacances annulées).
« Sarah s’est essuyé la morve du nez et s’est levée. Elle voulait se coucher. Elle était fatiguée.
J’avais gâché Noel.
Et puis j’ai vu qu’il y avait d’autres cadeaux. Et qu’ils étaient remplis de rien.
Attachés dessus, des mots disaient : Il n’y a pas d’autre monde. Il n’y a que celui-ci. Tes souvenirs ne sont que des voix idiotes dans ta tête. L’amour n’est rien d’autre que biologie et instinct animal de transmission des gènes, comme chez les rats. Il y avais d’autres mots de grand-mères qui disaient : Nous finissons en cendres dans la maison d’un étranger. Indésirables et anonymes. D’autres mères qui disaient : Tu as toujours été agacante. Et un autre de votre père qui avait écrit : Dieu merci, je suis mort. On n’a jamais été proches, toi et moi. Et on ne s’est jamais vraiment connu. Jamais.
Et ca c’étaient les vrais cadeaux.
C’était le vrai passé. »
- Repoussoir et empathie : catharsis.
On pourra alors au choix, selon sa sensibilité bukowskienne, plonger corps et rots dans cette spirale négative, ou s’ennuyer poliment de cette geignardise. Mieux : passer sans cesse de l’un à l’autre, hésitant à reposer cette littérature du too much, « voici mes entrailles et comment j’ai été minable ».
Dans son pire (volontaire), cette descente aux enfers white trash d’une Amérique profonde où rien ne pourrait survivre, provoque alors la répulsion : c’est que dans cette exposition brutale de l’intime, qui n’évite aucun des errements, des bassesses, des fluides (on y pisse, on y chie, on y vomit), il y a de l’obscène, de l’ordure, une forme même parfois de complaisance induite envers cet effondrement pathétique. De la douleur, surtout. Enormément.
« Une nuit Sam s’est réveillé à deux heures du matin et impossible de le rendormir. Je lui ai chanté des chansons et puis je lui ai donné un bibou mais il refusait toujours de dormir. Je lui ai dit : « C’est comme ca que les petits garçons se retrouvent avec un syndrôme du bébé sécoué mon pote. » Mais l’a fait rire et il m’a regardé avec un air de dire : « On rigole pas avec des trucs comme ca, gros tas. » Je l’ai bercé encore un peu et j’ai touché son front comme si je savais murmurer à l’oreille des bébés. Il s’est mis à sourire et glousser mais il voulait toujours pas dormir. Il m’a regardé, genre : « Et tu vas faire quoi, alors ? T’es trop dans la merde. » Je me suis dit que c’était rien qu’un bébé et qu’il savait même pas parler, mais j’arrêtais pas d’imaginer que si.
J’ai pris Sam, je suis allé dans la salle de bains et je l’ai posé sur le sol froid à côté des toilettes. Et puis je me suis mis à genoux et j’ai cru que j’allais vomir. J’ai posé les mains sur la lunette des toilettes et Sam me regardait. Et puis j’ai roté et c’était tellement bruyant que Sam s’est mis à pleurer. J’ai tapoté Sam dans le dos et j’ai dit : « Papa fait juste une petite crise de panique. T’inquiète pas. Papa va arrêter ses conneries je te promets. » […] Et là : le vomi a ri. Et puis Sam et le vomi ont ri tous les deux. Ils ont dit : « Tu vas faire quoi, gros tas ? T’es trop dans la merde ». Et Sam a fait une tête du genre : « J’espère que je vais pas tarder à avoir un nouveau beau-père. Un qui fera pas des crises de panique et qui sera riche. Je changerai même surement mon nom pour celui de mon beau-père. Histoire d’avoir un nom qui déchire. McClanahan c’est vraiment un nom de merde. Je veux un beau-père riche. Je veux une BMW. » » (pp.213-214)
- Dirty realism
Mais le réduire à une expérience traumatique serait lui faire déshonneur. C’est que, à la manière de la plupart des grands noms du « réalisme sale », sorte de courant de brut allant de John Fante à Chuck Palahniuk jusqu’au maitre élégant Raymond Carver (personnages en désespoir, ouvriers ou middle class sans histoires, etc), Scott McClanhan, retors et malin, sait provoquer le pas de côté, à coup d’aphorismes grand guignolesques à la Cioran qui concluent chaque chapitre (la vie est une merde et on finira tous seuls à en crever), de personnages haut en couleur (le chien aveugle qui se fait lécher les orbites vides ou l’histoire du patient à qui on a dû couper la moitié du pénis), de comparatif entre la vie et les ailerons de poulet ou de bringues paranoiaques, d’engueulades foirées et de coups d’éclats minables (le suicide avorté au doliprane, la paranoïa du braquage conté façon Hunter S. Thompson alors que le quidam ne voulait demander que son chemin).
« Et les chicken wings ont ri et murmuré ce seul mot : « Souffrance ».
J’ai demandé aux chicken wings ce que l’avenir nous réservait à tous, ce qu’il vous réservait à vous.
Les chicken wings ont ri et murmuré : « Souffrance ».
Et puis elles ont ri encore comme des folles et chicken wings m’ont dit que j’allais perdre la tête à compter de maintenant. J’allais vouloir mourir tous les jours et il y avait de grandes chances que je ne m’en sorte pas vivant. Elles ont dit que je m’apprêtais à vivre la pire période de ma vie. Elles ont dit que la planète Terre était en train de mourir de toute façon, et elles ont dit que c’était la fin et que le jour du Jugement dernier était arrivé. D’abord le réchauffement climatique, et maintenant le jour du Jugement dernier n’allait plus tarder. Elles ont dit que c’en était fini des êtres humains et que les chicken wings allaient prendre le contrôle. Je me suis renversé contre le dossier de mon siège et j’ai souri : « On dirait qu’on va bien se marrer. On dirait que ca va être sympa. » » (p.56)
Se regardant avec un sourire aux lèvres, l’horreur y côtoie brusquement l’humour, et on se prend à rire de bon cœur. De l’obscène nait l’empathie : le lecteur entre dans la danse.
- Diamants bruts et yeux vitreux.
Et, par un tour de passe-passe qu’on appelle littérature, cette déglingue de vomi, de matelas gonflables et de phrases stupides, donne encore plus d’éclat aux instants forts (on songe alors au grand Ray Carver, dans ces scènes poignantes) : la naissance d’Iris, bouleversante, les petits chatons et leur fin douloureuse, le chien aveugle et tendre, la mort d’une patiente entourée de tous les hommes qu’elle a aimé.
« Elle m’a embrassé et on a regardé dehors. Il neigait une drôle de neige de printemps et j’ai dit : « Fais semblant. » Et là on a vu que le monde entier recommencait à faire semblant.
(page suivante, ndlr)
Mais quelques mois plus tard, Sarah est rentrée à la maison et elle m’a raconté la plus belle de toutes les histoires. Elle m’a raconté qu’elle allait avoir un bébé. » (pp. 138-139)
Bouffon de nos vies, cette commedia dell’arte chez les rednecks, perfusée au bourbon et au désespoir pince alors le cœur. Et dans ces bras qui s’agitent trop, ceux d’un alcoolique qui gueule pour ne pas s’effacer dans le néant, apparait une drôle de lueur, de mille teintes. Dans ses yeux vitreux, il y a un reflet.
« Alors Sarah a posé sa main sur mon épaule et elle s’est levée. Elle m’a lancé un regard du genre « Tiens bon. » Et je me suis apitoyé sur mon apitoiement. J’ai regardé Sarah récupérer les enfants et les installer dans la voiture. Elle les a attachés dans leurs sièges-autos et je les ai regardés s’éloigner. J’ai vu le futur et je me suis vu acheter une télé et me suicider. Je me suis vu acheter une maison et me suicider. Je me suis vu faire un boulot que je déteste et j’ai vu tous ces petits suicides de la vie. Je savais que j’avais un millions de façons de me suicider et j’avais trop hâte de toutes les essayer.1
(Note de bas de page) 1. Je suis sûr qu’un bouddhiste quelque part est en train de dire « Tout douleur vient de notre désir pour les choses matérielles, mais rien dans cette vie ne nous appartient vraiment. ». Alors voilà ce que je lui dis au bouddhiste : « VA TE FAIRE ENCULER LE BOUDDHISTE. » »
Ecce homo : tour à tour pathétique, touchant, irritant, hilarant, sincère, minable, repoussant. Médiocre, si médiocre. On pourra alors questionner la nécessité de sa vulgarité, de son outrance. Se demander s’il fallait enchainer avec tant de complaisance autant d’émanations du corps pour réussir à conter. Mais il faut sans doute le laisser dire, même le pire, se dérouler cet exercice à la limite de la mutilation et du masochisme, en respecter l’impudeur pour qu’enfin y résonne notre part sombre à nous, lecteur qu’il invective régulièrement.
Notre espace, notre vie, banale, tristement banale, fait de peines et de rien : le premier coup de coeur qui ne ressemble pas au cinéma, la naissance d’un enfant, l’amour qui s’en fuit et les beaux amants qui vieillissent. Les divorces tristes et froids d’un tribunal, les enfants qui viennent et partent, la vie qui suit son cours et la tristesse ouaté d’une famille recomposée autour d’un déjeuner, d’une passion défunte.
« Cette nuit-là, j’ai rêvé qu’on était tous des aimants. J’ai rêvé que tous les êtres vivants étaient des aimants et que dès notre naissance on était attirés les uns vers les autres par une force invisible. J’étais un aimant et Sarah était un aimant et les livres aussi étaient des aimants. Nous nous étions enfin trouvés. » (p. 212)
Il ne se passe rien, dans ce requiem en mots. Rien que nos existences et nos souvenirs : fais nous rire, Paillasse, pour que nous n’ayons à trop pleurer.
Au matin banalement triste du divorce Scott écrit à Sarah : « Je sais que tu m’as dit que je ne t’écrivais plus jamais de lettres d’amour, mais je vais essayer de me rattraper. Un jour j’écrirai un livre magnifique plein de douleur et de rires. ». On ne saurait mieux dire.
Editions de l’Olivier, 213 pages, 22 euros. En librairie.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).