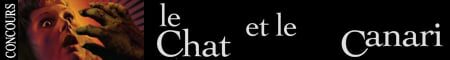Après des années passées à Louis Lumière, Thomas Cailley réalise le court très remarqué Paris Shangaï ( 2010 ). Mais c’est en 2014 qu’il s’impose comme le porte-drapeaux du nouveau cinéma français. Depuis des années, le festival Itinérances ( Alès en Cévennes ) n’a eu de cesse de soutenir les jeunes réalisateurs et il était donc logique d’accueillir l’Auteur de l’excellent Les Combattants en lui offrant au passage une carte blanche pour y présenter le très délicat et mélancolique, La dernière corvée, du merveilleux Hal Ashby. L’homme est éminemment modeste et réfléchi, féru de cinéma classique et grand fan de Ford, Eastwood ou Lumet. Rencontre avec un cinéaste passionné par son art, aussi indépendant et inclassable que ses personnages.
Avec le recul, comment analysez-vous le succès public ( plus de 400 000 entrées ) et critique ( César du meilleur premier film ) des Combattants ?
C’est très compliqué de savoir pourquoi à un moment un film trouve une résonance. Ce que je crois, c’est que le film est assez lumineux et généreux dans ce qu’il propose. Cette rencontre entre deux inconnus et le fait que par la découverte de l’autre, on peut inventer des mondes. En fait, il y a une dimension d’espoir assez importante et on rentre dans le film, malgré le contexte de crise et d’apocalypse tel que vécu par les personnages.
A titre personnel, j’ai beaucoup pensé à des films comme Stand by me, Un monde parfait, A bout de course ou encore Mud. L’Américana est-il une source d’inspiration pour vous ?
Certains films que vous citez sont très importants pour moi : A bout de course, je trouve que c’est vraiment un chef d’œuvre absolu. Un monde parfait, j’ai énormément d’affection pour ce film ! Je l’ai beaucoup revu et il m’a beaucoup marqué parce que je pense que c’est un film de duo particulièrement réussi. La transmission est toujours au cœur du film de duo , mais là je trouve qu’elle est belle justement parce que c’est une transmission malgré soi. On ne fait pas exprès de transformer et de contaminer l’autre, et d’être contaminé par l’autre. Je trouve aussi que les films que vous avez cités intègrent en outre les personnages à leur décor. Ils ont à la fois une dimension humaine et géographique, ce qui est très important pour moi, parce que je pense qu’on peut faire passer énormément de choses par le décor, que ça peut être une vraie dimension introspective pour les personnages. Un personnage qui regarde, qui évolue, qui se fond dans un décor, qui essaie de disparaître dans le décor, ça dit quelque chose de son rapport au monde. Et c’est vrai que le cinéma, et le cinéma américain en particulier, a beaucoup travaillé cette dimension là, ce qui est peut-être un peu moins vrai en France. Moi, c’est une dimension qui m’intéresse beaucoup. Je crois qu’on est aussi le produit de son environnement.

THOMAS CAILLEY, RÉALISATEUR, PHOTOGRAPHIÉ AU FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS ITINÉRANCES, MARS 2017 ©Patrice Terraz/Signatures
Vous semblez connaître votre sujet sur le bout des doigts. Avez-vous réalisé un stage d’immersion au sein de l’armée avant le tournage des Combattants?
Oui, pendant l’écriture du film, j’ai fait le stage que les personnages font en fait dans le film ! Déjà histoire de ne pas dire n’importe quoi, de savoir comment ça se passe exactement. J’avais pas mal de témoignages. En réalité, c’est assez facile de se documenter là-dessus mais je voulais voir de l’intérieur. Évidemment, ce qui est intéressant ce n’est pas le programme du stage, ce ne sont pas les actions qu’on y fait mais les aspirations des candidats. C’est ça qui m’intéressait et je trouvais que l’Armée était une toile de fond intéressante pour le récit parce que c’est un récit existentiel dans lequel deux personnages qui ont une vingtaine d’années essaient de se projeter dans un avenir qu’ils ont du mal à définir, qu’ils ont du mal à voir, qui les angoisse et l’Armée sert de creuset à cette interrogation. C’est le berceau dans lequel on voit évoluer leur crise existentielle. C’était intéressant de voir chez les jeunes gens que j’ai rencontrés durant le stage ce qui les avait amenés là et c’est assez marrant de constater que ce ne sont pas les idées qu’on a : ni forcément une passion pour l’Armée, ni un réflexe par rapport à la recherche d’un emploi stable par exemple. Ce n’est pas ça ! Il y a beaucoup de recherche de valeurs, de soi au fond. Il y a quelque chose de très intime là dedans et c’est ça qui vient directement en opposition avec ce que l’Armée attend d’eux. Évidemment, une institution comme celle-là n’a pas forcément vocation à ce que tout le monde s’épanouisse individuellement, l’idée c’est de fabriquer un corps, quelque chose de collectif. Du coup, c’est à cet endroit là qu’il y a des réflexions qui sont intéressantes et qui sont aussi génératrices de comédie.
Quelle est votre rapport avec la nature qui semble avoir une place importante dans votre univers ?
Comme je le disais, la nature, les cadres naturels, les décors, le paysage ont une vraie fonction pour rentrer en profondeur, pour rentrer dans une intimité avec les personnages. Quand on connaît le lieu qui habite quelqu’un, on connaît mieux cette personne. Ça a d’abord ce lien là et puis ce qui m’a excité sur Les combattants, c’est l’idée de faire évoluer le décor. Il y a deux personnages qui se rencontrent : on a Arnaud d’un côté, Madeleine de l’autre. Et le film est structuré en trois parties : on a d’abord le monde d’Arnaud, puis celui de Madeleine et enfin, le monde qu’ils décident de s’inventer pour eux-mêmes. Jouer avec ces décors, jouer avec la nature, voir comment on peut illustrer le monde d’Arnaud par les paysages et en quoi il est différent des paysages mentaux, mais aussi de ceux que rêvent Madeleine et quels paysages ils peuvent s’inventer pour eux-mêmes, c’est un défi qui est intéressant parce qu’il est à la fois, à hauteur de personnage tout en évitant de faire de la psychologie. D’autre part, ce rapport à la nature est quelque chose qui nous manque aujourd’hui. Le film parle de survie, sur un plan métaphorique, sur un plan social, parce que ce n’est pas évident de se construire aujourd’hui et de s’inventer un futur, mais il parle aussi de survie de manière très littérale. Comment on survit dans ce monde… Les personnages ont envie de se confronter à cette expérience là, de revenir à l’aube du monde. C’est en ça que je trouve qu’il y a de l’espoir : la fin du monde, elle ressemble aussi à un commencement du monde. Faire un feu, pêcher, chasser, faire l’amour en pleine nature, c’est le début de l’Humanité.

Thomas Cailley au festival itinérances 2017 – © Alix Fort
Le film que vous avez choisi pour votre Carte blanche a-t-il une résonance personnelle ?
J’ai choisi La dernière corvée d’Hal Ashby. Il y a une résonance qui est contemporaine parce que je pense que c’est vraiment un film sur la crise, en l’occurrence celle du modèle américain dans les années 70. Le film date de 1973. C’est une critique à peine voilée, et du rêve américain, et de la guerre du Vietnam dans un voyage à travers les marges, à travers la violence de ce que c’est que de traverser ces villes et ces territoires déshérités, ces banlieues. Plus personnellement, c’est vraiment un film d’aventures au sens le plus large du terme. L’aventure ? Je ne sais plus qui disait ça mais, la définition du film d’aventures consiste à programmer le dérèglement et dérégler le programme. Sans arrêt dans ce film, on a l’impression que le programme est déréglé. Ces deux militaires doivent escorter un troisième homme, un troisième militaire vers une prison et tout au long du film, ils s’éloignent de cet objectif. En ça, je trouve que ça change complètement du cinéma hollywoodien classique où un personnage a un objectif et se bat pour ce truc là pendant tout le récit. Là au contraire, c’est découvrir que les personnages du film sont plus importants que le film lui-même et là dedans, il y a une douceur, il y a un vrai amour des personnages et des acteurs, qui est hyper sensible et même, qui transparaît dans le film. Et puis sur la forme, qui est éminemment moderne, qui est extrêmement bien écrite mais qui est aussi tout au long des scènes, très improvisée. On a laissé énormément de place au jeu, à l’acteur. C’est vraiment une modernité de cinéma qui est intéressante, qui lance des pistes, des puits de fiction pour aujourd’hui.
Quel est le film qui est à l’origine de votre passion pour le cinéma et qui vous a envie de devenir cinéaste ?
Le film où je me suis vraiment dit « Le cinéma c’est pas simplement les films que je vois le dimanche soir à la télé », celui qui a vraiment changé la donne, c’était La fureur de vivre que j’ai découvert un peu par hasard à douze ou treize ans et qui a été un vrai choc ! Je n’ai pas vraiment compris ce qu’il s’y passait, parce que le film est vraiment très particulier, très lâche dans sa construction. Il avance caché, avec une espèce de violence sourde qui travaille en creux et avec cet acteur fascinant, James Dean, qui a fait très peu de films et là, dans ce film, il donne toute sa complexité. Il est à la fois masculin et féminin. Tout est trouble. J’ai trouvé que le film posait beaucoup plus de questions qu’il ne cherchait à en résoudre et du coup, c’est ça qui te travaille une fois que le film est fini. C’est à ce moment là que je crois qu’un film devient important et continue à nous suivre. Parce qu’il nous laisse de la place pour vraiment rentrer dedans. Donc ça, ça a été le film fondateur de mon amour du cinéma. Après je ne me souviens pas qu’il y ait un film qui m’ait poussé à devenir réalisateur. Ça s’est un peu fait comme ça, déjà en commençant à écrire des histoires, en tournant un peu par hasard un court-métrage ou deux pour s’amuser, en regardant les autres faire. Ensuite, l’appétit vient en mangeant, on en fait un premier, on trouve ça super. On voit à quel point on est mauvais aussi, on a envie de progresser. En fait, je crois que c’est un métier dans lequel il y a une marge de progression infinie !

Paris Shangaï – © Ivan Mathie (2010)
Comment étaient les conditions de tournage ?
Sur Les combattants…, on a fait le film avec une joie sérieuse, c’est à dire avec beaucoup d’envie. L’équipe était très jeune. Les chefs de poste, c’était la première fois qu’ils occupaient leurs postes. Il y a avait cette spontanéité, presque de l’insouciance… A côté de ça, le film était difficile à faire, parce que ce n’est pas un film qui a été financé très confortablement . On avait un nombre très important de décors. Je crois que ça c’était la difficulté majeure. En fait, le film est écrit comme un road movie. Très tôt, on quitte les lieux des personnages et on avance dans le film avec un décor différent à chaque scène. Je ne sais plus mais sur 110 séquences, il y avait 80 ou 85 décors, ce qui est très compliqué parce que ça veut dire qu’il faut tout le temps se déplacer, tout le temps changer l’équipe de bain. Donc on fait bain chaud-bain froid, parfois trois lieux différents dans une même journée, avec vingt cinq personnes à bouger, plusieurs camions, les acteurs, le matériel et tout ça en essayant de jongler avec les conditions météo qu’on ne peut pas maîtriser, en essayant que ce soit raccord dans le film. Ça, ça a été une bonne galère… Mais une aventure hyper importante, hyper intense !
Quel est votre dernier choc ou coup de cœur cinématographique ?
Je pense que c’est The lost city of Z de James Gray que je viens de voir peu de temps auparavant. Ce film m’a fait beaucoup de bien parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un film au premier degré. En fait, c’est une quête archéologique, c’est quelqu’un qui recherche une cité perdue. On a vu plein de films comme ça, on se souvient tous des Indiana Jones etc. Mais on a un peu l’impression aujourd’hui que tout a été découvert et que ça va être très compliqué de nous faire croire à cet émerveillement là, à ce que c’est que de découvrir un monde… Je trouve qu’il y arrive… par le temps. Il a une gestion du temps magnifique, de son épaisseur dans cette découverte, dans cette quête qui devient une obsession. Donc il prend vraiment le temps de jouer ces scènes et de tabler, de miser sur l’usure de son personnage et ça, c’est hyper beau. Je trouve que le dernier acte, la dernière demie-heure est vraiment bouleversante.
Le mot de la fin… Quel sera le sujet de votre prochain long-métrage ?
Dans ce cas là, il n’y aura pas de mot de la fin car je n’en parlerai pas ! ( rire )
Entretien avec Aïssa Deghilage pour Culturopoing et Radio Escapades. Moyens techniques : Radio Escapades. Remerciements Festival Itinérances, en particulier Julie Plantier, Julie Uski-Billieux et Eric Antolin. Photos: Patrice Terraz, Alix Fort et Ivan Mathie.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).