We cannot begin to express our shock and sadness, there aren’t words.
We will say more in the coming days, but for now, please…play Motörhead loud, play Hawkwind loud, play Lemmy’s music LOUD.
Have a drink or few.
Share stories.
Celebrate the LIFE this lovely, wonderful man celebrated so vibrantly himself.
HE WOULD WANT EXACTLY THAT.
C’est par ce poignant communiqué que le site officiel de Motörhead s’affiche aujourd’hui alors que la nouvelle de la disparition de Lemmy Kilmister est désormais connue de tous.
L’une des plus icones les plus emblématiques de toute la scène rock n’est plus. Cette nouvelle paraît à la fois logique et incompréhensible. Logique car le bonhomme partageait avec Keith Richards des Stones la place enviable de contre-exemple parfait aux dangers liés aux excès en tout genre. L’un et l’autre n’ont pas ménagé leur peine en effet entre drogues (à l’exception de l’héroïne pour Lemmy) et alcool, jusqu’à devenir des miraculés, des survivants, de la graine d’immortel(s) en un mot. Mais si les Stones ont depuis longtemps mis la pédale douche sur les concerts, se limitant à de vastes et ponctuelles tournées, Lemmy aura passé l’essentiel des trente années de carrière de Motörhead sur la route aux quatre coins du monde, le tout à un rythme plus que soutenu, surtout quand on connaît l’énergie requise pour jouer pareille musique. La nouvelle de la mort de Lemmy reste malgré tout un choc, tant le bonhomme paraissait inoxydable avec sa constitution hors-normes et un statut acquis depuis longtemps de bonhomme revenu de tout ou presque. Si les dernières années ont rappelé à Lemmy qu’il n’en était rien avec un état physique qui déclinait lourdement et des prestations scéniques qui n’avaient qu’un lointain rapport avec la fougue et la vista d’antan, le vigoureux sexagénaire symbolisera pour longtemps encore la vigueur et l’elixir de jouvence associés à la mythologie rock.
Né en 1945 en Angleterre, Lemmy est un enfant de l’après-guerre comme ses contemporains des Stones ou des Beatles mais plus encore de Black Sabbath avec qui il partagea (sic) une enfance grisâtre et dénué du moindre horizon ensoleillé. Comme ces derniers, comme beaucoup d’autres, c’est dans le rock que le jeune Ian Fraser trouva matière à liberté. Avoir vingt ans en 1965 pouvait finalement être une bénédiction pour ceux qui comme lui n’avaient que peu, sinon rien, à perdre. Comme le chanta sensiblement à la même époque Janis Joplin :
« Freedom’s just another word for nothing left to loose »
Lemmy a alors la bonne fortune de croiser la route d’un certain Noel Redding, le bassiste du Jimi Hendrix Experience avec qui il va partir sur les routes comme roadie l’espace de quelques mois. Avant et après cette parenthèse enchantée, Lemmy usine comme guitariste dans plusieurs groupes, certains signés et d’autres non. C’est en 1971 que sa carrière accélère pour de bon alors qu’il rejoint les allumés de Hawkwind en qualité de bassiste, instrument qu’il découvre d’ailleurs au fil des concerts donnés avec le groupe. Oh sweet seventies ! Puissant combo de ce qu’on n’appelle pas encore le Space Rock (du rock puissant plongé tête la première dans le psychédélisme et les drogues, toutes les drogues). Développant sa technique si particulière de bassiste (Rickenbacker, haut volume, style très agressif), Lemmy passe près de quatre années avec Hawkwind jusque sa rocambolesque éviction de 1975. Ce conglomérat de drogués patentés se débarrasse en effet du volumineux bassiste au poste frontière USA/Canada et en pleine tournée au motif que le sieur s’y est fait prendre avec quelques « vitamines » dans son cabas !
A peine rentré en Angleterre, Lemmy s’attelle à ce qui sera son grand Œuvre, la création de son propre groupe. Après différents essais infructueux, c’est sous le nom de Motörhead qu’il repart au combat, accompagné d’un dénommé « Fast » Eddie Clarke à la guitare et du batteur Phil « Philthy Animal » Taylor. L’ensemble forme un trio survitaminé et rapidement expert en rock’n’roll puissant et rapide.
1977 fut une année géniale pour le rock anglais, Motörhead y sortit son premier album.
Avec un premier album éponyme rapidement enregistré (deux jours de studio et hop), Motörhead se trouve tout d’abord un (maigre) public entre hard et punk. Il faut dire que le disque sort sur le label Chiswick Records que le trio partage avec les Damned, ce qui peut aider dans ce sens. C’est là d’ailleurs une particularité du groupe que d’avoir toujours été regardé (enfin écouté plutôt) avec bienveillance aussi bien du côté des agités à crêtes que des graisseux. Une promiscuité presque logique pour une musique aussi basique que puissante. Motörhead joue en effet fort, très fort, à la limite même du seuil légal en la matière. Il sera même brièvement interdit de concert aux USA pour cette raison. Le groupe joue également vite, très vite, une version au carré du MC5 qui était déjà une version au carré de Chuck Berry.

On le sait, la carrière du groupe est émaillée de maintes difficultés contractuelles. Celles-ci sont déjà présentes au tout début, puisque si ce Motörhead est bel et bien le premier album du trio à être commercialisé, c’est en fait le second album à avoir été enregistré, le dénommé On Parole prenant quelque part la poussière depuis 1975. Quoiqu’il en soit, le succès est pour l’heure…et bien heu…comment dire… inexistant et deux années passent avant qu’Overkill ne sorte en mars 1979 suivi de Bomber puis Ace Of Spades, le tout en deux petites années seulement. Triangle d’or créatif de la bande de Lemmy, ces trois albums vont également être de grands succès commerciaux en Angleterre (Top 24 puis Top 12 et enfin Top 4 !). Tout se passe alors comme si, dans la continuité du punk, le besoin en énergie brut du public se radicalisait au milieu des sucreries pop habituelles et du disco monopolisant les radios. Le fameux On Parole sort même dans la foulée de ce succès, alors que Ace Of Spades est distribué aux Etats-Unis, une première pour eux. Nous sommes en 1980 et Motörhead éprouve alors le sommet commercial de son Histoire.
Son climax est sans nul doute la sortie en juin 1981 du live No Sleep ‘Til Hammersmith, l’un des disques en concert les plus célèbres du hard rock, et même du rock (tout court). Numéro 1 des charts anglais, ce disque couronne une période intense de créativité comme de succès pour le gang avec une cinquième sortie sous le nom de Motörhead en moins de deux ans, auxquelles s’ajoutent différents Ep. dont le fameux St. Valentine’s Day Massacre réalisé conjointement avec les filles de Girlschool, partenaires du même label.
Paraît ensuite Iron Fist, produit par le guitariste Eddie Clarke. Le disque ne retrouve pas le succès de ses prédécesseurs, malgré sa légère teinte mélodique rendant la musique du power trio sensiblement plus accessible, comme quoi. Lemmy en parlera plus tard comme un disque raté et bâclé, dont acte. Un constat semble-t-il partagé par son guitariste puisque Clarke quitte alors le groupe en pleine tournée américaine. Le trio prend toutefois ici congés, même s’il ne le sait pas encore, de son âge d’or et s’apprête à retrouver, pas à pas, album après album, contrat discographique après contrat discographique(1) , le chemin plus tortueux du groupe culte.
Another Perfect Day est ensuite édité, un disque enregistré avec l’aide éclairée de Tony Platt. C’est sans doute l’album le plus décrié de la carrière du groupe (trop mélodique vous pensez !), celui qui voit l’ex Thin Lizzy Brian Robertson reprendre la guitare là où Fast Eddie Clarke l’avait laissée, c’est-à-dire en plein milieu de tournée américaine. Robertson ramasse la guitare, la nettoie, la brique puis la lustre et le trio anglais se retrouve ainsi à mettre de l’eau mélodique dans son vin. Le résultat est plus qu’honnête mais le public semble quoiqu’il en soit lassé, sinon déçu de ce pourtant léger virage. L’album entre brièvement dans le Top 20 anglais mais la mayonnaise ne prendra pas plus cette fois. Le succès semble peu à peu quitter Motörhead. Autre fuyard, le batteur Animal Taylor qui signifie son congé en avril 1984, Lemmy se retrouve ainsi plus que jamais seul aux manettes. La compilation No Remorse, enrichie de quatre titres inédits dont le flamboyant « Killed By Death » est publiée peu après. Ce disque est historiquement important puisqu’il s’agit du premier album enregistré à quatre, la paire de guitaristes Phil Campbell et Würzel (de son vrai nom Michael Burston) accompagnant l’inoxydable Lemmy ainsi que le nouvel arrivé Pete Gill, ex-Saxon, à la batterie. Bel objet à l’époque avec sa pochette gainée de véritable cuir, l’album s’appréhende comme la conclusion du second chapitre du groupe, celui des années triomphantes, celui des années Bronze Records également puisque le prochain disque sortira sur une autre maison de disques à la suite de la faillite dudit label .
Après un silence discographique de deux ans ponctué d’innombrables concerts, Lemmy et sa bande sortent le vociférant Orgasmatron en 1986. Deux ans d’attente pour un album, c’est une goutte d’eau pour le Def Leppard d’alors mais c’est un plein océan pour les graisseux tête-de-motorisés, la faute à un long procès avec l’ancien label du groupe Bronze Records. Les deux dernières années furent parmi les plus essentielles au niveau du metal alors en plein boom commercial et le pauvre Lemmy s’est retrouvé emberlificoté dans un galimatias juridique, mauvais timing ! C’est d’autant plus dommage que Lemmy était sur le point de finaliser un duo avec la popstar la plus hot du moment, Samantha Fox, lorsque son label se mit à sérieusement tanguer. Orgasmatron est produit par une sommité, Bill Laswell, un bassiste et producteur tournant autour de la scène arty new-yorkaise et tout auréolé alors du carton réalisé par « Rock it » d’Herbie Hancock qu’il a co-écrit. Le retour de Motörhead sur disque, et qui plus est avec un producteur comme Laswell, s’annonce excitant au possible. Le rendu de cet Orgamastron s’avère d’ailleurs de belle qualité, notamment avec la chanson-titre ou encore le volatile « Deaf Forever ». Le come-back du groupe trouve un écho certain en Angleterre, où l’album frôle le Top 20, mais rien ou presque du côté des Etats-Unis, une habitude malgré deux mois passés là-bas sur les routes en compagnie de Megadeth. Orgasmatron a néanmoins le mérite de remettre le nom de Motörhead sur l’échiquier, dont acte.
Commence alors la période véritablement californienne de Motörhead, période entamée avec la signature du groupe chez Epic Records aux USA (et un nouveau management en passant) et le déménagement de Lemmy dans la Cité des Anges, ville qu’il ne quittera désormais plus, sinon les deux pieds devant. Lemmy participe indirectement au grand succès rencontré par Lita Ford avec son album Lita sorti en 1988, un disque couronné d’or et de platine sur lequel Lemmy signe un titre, le speedé « Can’t Catch Me ». De quoi lancer sur une belle dynamique un nouveau pan de carrière pour Motörhead, un nouveau départ qui va curieusement par la suite prendre la forme d’une devinette.
Devinez en effet l’intrus parmi Motörhead, Los Angeles, le violoncelle et Epic Records.
Piège grossier car d’intrus il n’y a point ici avec l’album 1916, le premier à sortir chez la major company. Voilà un disque étonnant, produit par Ed Stasium (Living Colour récemment alors) qui lui donne un son plus clair et chaud que jamais. Visant clairement un plus grand succès aux Etats-Unis, partant sans doute du fait que l’Europe est depuis bien longtemps et définitivement acquise à leur cause, Lemmy et sa bande sortent l’album le plus varié de leur carrière, le plus soigné aussi avec des séances d’enregistrement étalées sur près de trois mois, une première pour ce qui les concerne. C’était en tous les cas une grosse côte d’imaginer a priori un disque de Motörhead incluant un titre (ici l’éponyme) sur lequel Lemmy narre plus qu’il ne chante un récit de guerre tandis qu’un trio batterie/violoncelle/orgue marche au pas à sa suite. Autre curiosité, le lancinant « Nightmare/The Dreamtime » qui joue l’hypnose dans une inquiétante mais remarquable ambiance. Blasphème absolu sur un album de Motörhead, une power-ballad d’école, oui oui une ballade, intitulée « Love Me Forever » et d’ailleurs plutôt bien troussée. Voilà donc trois titres, par ailleurs intéressants, plongés (rassurez-vous) dans l’habituelle houblon frelaté du gang dont émerge un hommage/clin d’œil aux Ramones (« The Ramones »). 1916 reste un album à part de la discographie de la Tête de Möteur, un des plus intéressants dans ce qu’il creuse la psyché Lemmyesque (son obsession pour les deux conflits mondiaux, des goûts musicaux bien plus variés que ce que nous donne à entendre son groupe) et qui nous présente surtout un disque inspiré mais aussi versatile, même si beaucoup hurlent aux loups devant tant de (relative) mollesse. Cerise sur le maigre gâteau, la nomination aux Grammy Awards 1992 pour la Best Metal Performance. A noter que nous avons ici le dernier album à voir figurer le batteur historique Philthy Animal Taylor, viré cinq années après son retour dans le groupe pour manquements répétés à la bonne marche du groupe (le monsieur ne faisait pas ses devoirs à la maison avant les répétitions, que voulez-vous).
Après un apport plus que remarqué sur l’immense album No More Tears de son vieux compère Ozzy Osbourne(2) , Lemmy retrouve rapidement les studios d’enregistrement. Si 1916 avait dérouté les fans avec ses morceaux inattendus (une ballade, une chanson avec du violoncelle) et la volonté affichée par le groupe de se faire enfin connaître aux Etats-Unis, March Or Die achèvera quelques-uns des survivants à l’écoute d’un album où la vitesse d’exécution est absente et où le tempo est globalement divisé par deux par rapport aux standards passés du groupe. Plus rock’n’roll que jamais, les morceaux les plus enlevés font d’ailleurs plutôt dans le rythmé que dans l’échevelé, à l’instar de l’hymne presque mainstream (à l’échelle du groupe bien sûr) « Stand » qui ouvre les débats avec ses relents de post-punk et son refrain quasi-caritatif. C’est d’ailleurs une constante de l’album que d’avoir l’impression d’y entendre le résultat du Lemmython, vaste programme visant à saluer le travail du maître en compagnie d’invités de luxe comme Slash et Ozzy Osbourne. Comme sur 1916, deux morceaux se dégagent musicalement du lot. Non pas qu’ils soient l’un et l’autre profondément marquants mais simplement qu’ils détonnent au milieu d’un ensemble certes limé comme jamais mais toujours bien rock. Tout d’abord, la ballade « Ain’t No Nice Guy » en duo avec Ozzy (après Lita Ford, quel choc) entre pignolade acoustique, piano doucereux et petite montée de sève électrique puis « March Or Die », le titre qui clôt l’album sous forme incantatoire et narrative, superflue également. Refaisons le compte : Une reprise de Ted Nugent (superbe « Cat Scratch Fever »), la version Motörhead de « Hellraiser » déjà entendu sur le No More Tears d’Ozzy, un blues d’école certes bien travaillé mais dont l’ébauche musicale tient sur un timbre-poste (« You Better Run » (3) ), un titre dit de studio avec moult effets sonores en guise de musique (l’éponyme), voilà donc du Motörhead de croisière ensuite, tendance repos du guerrier. Le fait est que l’album va gentiment se ramasser des deux côtés de l’atlantique, surtout aux Etats-Unis
Commence alors véritablement pour Motörhead la longue et plutôt attachante litanie d’albums peu ou prou identiques, tous marqués par un tempo à nouveau accéléré et une musique globalement débarrassée de toute poudre d’escampette stylistiquement parlant. Citons simplement Sacrifice de l’été 1995, l’album qui va sceller le départ du guitariste Würzel et le recours jamais démenti depuis à la formule du trio, Phil Campbell tenant vaille que vaille le manche jusque hier encore. Dix albums studio suivront ainsi au fil de ses vingt dernières années. N’oublions pas non plus les nombreuses compilations ou publications live, de quoi remplir longtemps encore le disque dur du groupe.
Autant de prétextes en fait à des tournées toujours nombreuses, toujours fructueuses, de plus en plus d’ailleurs. Car ces deux pleines décennies vont être paradoxalement, alors que les ventes de disques suivent irrémédiablement une courbe descendante, celles de la reconnaissance pour Lemmy et son groupe. Motörhead est ainsi devenu avec le temps une icône rock pour le grand public, à l’instar des Ramones (RIP) et d’AC/DC (qui vont bien, merci, enfin j’espère), la profusion de tee-shirts H&M célébrant leur classe d’emblème en témoignant au milieu de dizaines de produits estampillés Motörhead, jusque la layette pour enfant, c’est dire. Il fallait pour cela le déclin artistique d’un genre qui semble n’avoir aujourd’hui plus rien de neuf à proposer, même s’il reste dynamique et vivace, surfant lui-aussi (comme tout en fait) sur la vague de la nostalgie et d’un âge d’or révolu. Il fallait pour cela surtout une longévité patente, un emblème facilement identifiable et une tête de gondole charismatique et fédératrice, Lemmy et Motörhead avaient tout cela et plus encore.
Outre un groupe et une discographie de légende, Lemmy laisse à la postérité une personnalité plus qu’attachante, gouailleuse et sarcastique comme il faut, libre en un mot. Il laisse le souvenir d’un homme continuellement sur la route, entre deux verres, deux comprimés vitaminés (sic), deux femmes également. Le personnage était pourtant bien plus profond que ce vernis lubrique et vociférant ne le laisse croire. Passionné d’histoire, notamment des deux guerres mondiales du siècle dernier, grand collectionneur d’ailleurs d’objets et insignes nazis, Lemmy était un amoureux fou des Beatles et du rock’n’roll originel, une poignée d’albums publiés sous son nom ou via des side-projects en attestent(4) , un homme finalement pépère hors tournée qui aimait passer ses journées au mythique Rainbow Bar & Grill de Los Angeles devant un jeu vidéo. Si vous ne le connaissez pas encore, le documentaire Lemmy réalisé en 2010 vous permettra d’ailleurs de le découvrir sous toutes ses facettes, du père de famille au conducteur de panzer !
Avec la mort il y a quelques semaines de cela du fidèle compagnon de route Phil « Philthy Animal » Taylor, l’année 2015 scelle définitivement la carrière et la trajectoire oh combien singulière de Motörhead et de son mentor Lemmy Kilmister. Comme il le chantait dans la chanson qui a donné son nom au groupe :
Motörhead, remember me now, Motörhead alright
Ian ‘Lemmy’ Kilmister
1945 -2015
Born To Lose, Lived To Win
(1) Le groupe détient sans doute le record du monde de disques enregistrés pour des labels différents.
(2) Lemmy y est crédité sur quatre chansons.
(3) Cerise sur la chouquette, ce titre sera même utilisé d’ici quelques temps pour la bande-originale du film… Bob L’Eponge !
(4) Citons The Head Cat, un trio rockabilly formé notamment avec Slim Jim Phantom, le batteur des Stray Cats.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).






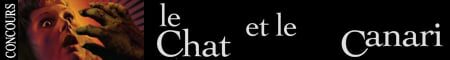

vinylicious
article rondement mené je pense que Lemmy l’aurait adoré après une rasade de jack daniels et ….un accord de basse ! Beat the bastards ! 🙂