« Les papillons noirs de la mélancolie »
Cinéaste éclectique et talentueux, Guillermo del Toro a fait le pari de commencer son film avec la subtilité d’un roman de Henry James et le clore dans un déluge charnel et pulsionnel. Le résultat est fascinant.
Le titre du nouveau film de Guillermo del Toro incite le spectateur à pénétrer dans un univers romantique et inquiétant, qui nous invite en terrain connu et en terre intime : bienvenue à Crimson Peak. Alors que L’échine du diable et le Labyrinthe de Pan revisitaient un aspect tragique de l’histoire de l’Espagne, la défaite de l’armée républicaine pendant la guerre civile, le dernier opus du cinéaste opère un déplacement dans le temps et dans l’espace : l’intrigue de Crimson Peak se déroule à la fin du XIXe siècle entre les Etats-Unis et l’Angleterre. Mais derrière le charme du film en costumes et l’imagerie baroque affleure une œuvre complexe et tourmentée. C’est ce que révèle l’affiche du film qui rappelle d’un côté, par la position des personnages, l’univers fantaisiste dans lequel baignaient Morticia et la famille Addams, et de l’autre, un célèbre tableau de Füssli représentant Lady Macbeth somnambule. Dans Crimson Peak, le gothique ne se limite pas ici à une simple imagerie. Dernier rejeton du romantisme noir, le film de Guillermo del Toro s’inscrit dans la tradition de toute une littérature anglo-saxonne, de La Dame en blanc au Tour d’écrou, des Hauts de Hurlevent à Rebecca. Mais si le réalisateur multiplie sur un mode discret les références érudites, il les intègre harmonieusement à un ensemble cohérent et personnel.
- © Universal Pictures International France
- Johann Füssli, « Lady Macbeth somnambule »
Crimson Peak, c’est l’histoire d’Edith Cushing (voyez l’hommage), jeune romancière en herbe, qui a perdu sa mère quand elle était enfant. Elle vit à Buffalo avec un père aimant qui la protège tout en l’encourageant à devenir la femme indépendante qu’elle rêve d’être. Alors qu’elle sort d’un rendez-vous avec son éditeur, à qui elle a soumis son roman, elle rencontre Thomas Sharpe, un jeune aristocrate anglais dont elle va tomber passionnément amoureuse. Celui-ci est accompagné de sa sœur Lucille, qui forme avec lui un bien étrange duo.
Si Crimson Peak élève le film d’horreur au rang de chef-d’œuvre, il n’en respecte pas moins tous les codes et fait montre d’une efficacité redoutable. Comme souvent chez Guillermo del Toro, les corridors et les couloirs – espaces transitionnels qui jouent sur une grande profondeur de champ – sont des lieux où tout peut arriver. L’architecture gothique du manoir des Sharpe, qui multiplie les encadrements de porte et joue sur des effets de perspective, participe de cette angoisse. Les portes – poignées et trous de serrures mises en valeur par des fermetures à l’iris au montage – cristallisent la peur des personnages et des spectateurs, seuils terrifiants où se rencontrent hommes et créatures de l’au-delà. Une ombre projetée sur les murs, une horloge qui tout à coup s’arrête, des portes qui grincent : rien ici qui renouvelle foncièrement les ingrédients du film d’horreur et pourtant, la recette fonctionne à plein. Surtout, Guillermo del Toro est habile à susciter l’épouvante chez le spectateur en usant des situations les plus banales, en faisant naître la terreur de l’ordinaire et du quotidien : installée dans l’inquiétant manoir de son époux, Edith joue à lancer une petite balle à son chien puis recommence… jusqu’à ce que la balle revienne sans le chien. C’est paradoxalement dans ces moments–là que le film effraie le plus. Les fantômes ont un aspect terrifiant chez Del Toro – on reconnaît là l’ancien maître en effets spéciaux – mais pour autant, ils ne sont pas maléfiques : seuls les hommes font du mal à leurs semblables et se montrent redoutables. Comme chez Mary Shelley dans Frankenstein, les monstres ne sont pas ceux qu’on croit : la pauvre créature crée par le docteur Frankenstein est bien plus à plaindre que les humains qu’elle épouvante. Le fantôme de la mère d’Edith, en dépit de ses apparitions cauchemardesques, cherche à prévenir sa fille du danger qui l’attend : « Prends garde à Crimson Peak » lui chuchote–t–elle à plusieurs reprises. Comme dans le Labyrinthe de Pan ou L’échine du diable, c’est dans les profondeurs – cave ou grotte – que se trouve l’origine du mal ou que le crime originel a été commis : le personnage, à qui on a interdit de pénétrer dans ces lieux infernaux, doit alors transgresser l’interdit pour découvrir ce qu’on a voulu y cacher et délivrer le fantôme de la malédiction qui pèse sur lui tout en se sauvant. Cette verticalité est retravaillée dans Crimson Peak puisque au sinistre escalier se substitue un ascenseur vétuste, cage de fer branlante qui descend jusqu’aux entrailles de la maison. Cet espace infernal dissimule tout autant les méfaits du personnage criminel qu’il symbolise son intériorité malade et dérangée, ses pulsions destructrices et son érotisme tourmenté. Dans Crimson Peak, la cave accueille les cuves où est recueilli l’argile qui rougit l’eau et le sol. Or ce rouge cramoisi n’est pas sans rappeler le sang caillé du petit cabinet de Barbe-Bleue ou la chambre cadenassée du Secret derrière la porte de Fritz Lang, autant de références qui confèrent au film de del Toro une dimension mythique.
Les nerfs du spectateur sont mis à rude épreuve dans Crimson Peak, mais celui-ci ressort surtout ébloui par la splendeur visuelle et plastique du film. Le travail sur les couleurs est admirable. Au cours des premières scènes d’épouvante, les intérieurs sont dominés par le rouge et le vert, à l’instar des films de Mario Bava qui créait des éclairages expressifs à partir des couleurs primaires. On pense notamment au sketch « La Goutte d’eau » dans Les Trois visages de la peur où les lumières vertes et rouges clignotent, en baignant d’une aura inquiétante l’appartement de Miss Chester. Dans le film de Guillermo del Toro, le meurtre sauvage du père fait lui aussi l’objet d’une remarquable mise en scène où dominent les contrastes : ainsi le sang de la victime éclabousse puis inonde les carreaux immaculés de la salle de bain du club, scène dont le modus operandi et le cadre rappellent immanquablement Profondo Rosso de Dario Argento. On relève aussi dans Crimson Peak des effets d’écho ou de rime visuelle, procédé cher au réalisateur mexicain : ainsi deux scènes d’enterrement se répondent, à quelques années d’intervalle. Le jeu sur les perspectives et les forts contrastes donnent lieu ici à deux scènes de toute beauté. Dans la première, deux rangées de personnages en deuil, dont les vêtements sombres se détachent sur la neige, encadrent le cercueil qu’on transporte jusqu’à sa dernière demeure. Dans la deuxième, la neige a laissé place à la pluie, comme pour suggérer une détérioration, une déliquescence qui épouse le destin de l’héroïne. Le délicat service à thé chinois, leitmotiv du film dans sa deuxième moitié et clin–d’œil au genre du film policier ou aux victimes des romans d’Agatha Christie, participe lui aussi de la poésie de Crimson Peak, d’autant qu’il est souvent redoublé d’une rime musicale, la berceuse que joue régulièrement Lucille au piano. Enfin, le film est construit comme un diptyque pictural puisqu’à chaque espace correspond une palette cohérente : en Amérique dominent des tons beiges, or, orangés, qui semblent évoquer la douceur qui entoure Edith et le bouillonnement de ce nouveau monde. Une fois en Angleterre, des couleurs beaucoup plus froides et métalliques envahissent l’écran, signe du dépérissement d’Edith.

Le manoir des Sharpe, lieu envoûtant et maléfique, joue un rôle tout aussi essentiel que les protagonistes de Crimson Peak, ce que confirme du reste le titre du film. Guillermo del Toro ne se cache pas d’avoir voulu faire d’Allerdale Hall le personnage principal de son film. Cette maison imposante mais vermoulue, témoignage de la grandeur passée de la famille, constitue bien l’enjeu de l’intrigue : c’est pour la conserver et la restaurer que Thomas et Lucile sont prêts à tout. La maison est envahie de papillons de nuit, qui agonisent faute d’avoir pu retourner à l’air libre. Ces papillons, montrés en gros plan, se font dévorer par d’autres insectes, et présagent du destin d’Edith, dont la vie elle aussi s’étiole, prise au piège de cette prison grandiose. Le manoir n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’imposante demeure délabrée et envahie par les araignées de Miss Havisham dans De Grandes Espérances, le roman de Dickens. Mais c’est peut-être Edgar Allan Poe qui constitue la source d’inspiration la plus manifeste pour Allerdale Hall dans Crimson Peak : dans sa nouvelle, la Chute de la maison Usher, les fissures de la maison symbolisent la décadence de la lignée et les héros de Poe, frère et sœur jumeaux, ont pu inspirer les Sharpe. A l’image de la maison Usher, qui finira par s’effondrer, le manoir de Crimson Peak s’enfonce lentement dans le sol, irrémédiablement amené à disparaître, tout comme l’ancien monde qu’il symbolise.
Cette ruine à venir des valeurs et du monde aristocratiques, Edith, la jeune américaine, ne semble pas y prêter attention. Elle n’est pas insensible aux marques de noblesse et de distinction liées au statut de son fiancé, et, sans se l’avouer, est grisée par ce rêve de grandeur. Poursuivant la réflexion entamée par Henry James dans ses meilleurs romans, le réalisateur mexicain oppose ici de manière subtile le vieux continent au nouveau monde, l’Angleterre aristocratique au dynamisme démocratique de l’Amérique, et fait se confronter deux systèmes de valeurs fondés sur le privilège ou le mérite. La pâleur de sir Thomas Sharpe et de sa sœur les apparente à des vampires, ce qui ne fait que renforcer le mystère qui entoure leur identité et leur passé trouble. Mais au-delà de cette apparence sinistre, les personnages sont aussi des vampires dans la mesure où ils s’emparent de la fortune des êtres sur lesquels ils mettent la main. Incapables de subvenir à leurs propres besoins et de s’adapter à la modernité, ils sont anachroniques. L’usage qu’ils font du poison contribue à les rattacher à des êtres vampiriques puisqu’ils vident progressivement les autres personnages de leur force vitale. Coïncidence plaisante, Mia Wasikowska et Tom Hiddlestom ont déjà joué ensemble dans le dernier film de Jim Jarmusch, Only lovers left alive, où ils interprétaient déjà des vampires en retrait du monde.
En dépit de l’atmosphère crépusculaire qui imprègne Crimson Peak, le film de Guillermo del Toro n’est pas dénué d’humour et d’humanisme. L’humour apparaît ici et là, par petites touches. C’est ainsi un personnage de médecin, passionné de Conan Doyle, qui finira par mettre en pratique les leçons de Sherlock Holmes pour enquêter sur la disparition tragique du père de l’héroïne puis partir à la recherche de celle qu’il aime. A la différence des films d’épouvante typiques, les personnages de Crimson Peak ne sont pas monolithiques : même les méchants sont amenés à évoluer, à s’humaniser. C’est en relisant le manuscrit de l’héroïne et en se laissant aller à l’amour que Thomas Sharpe redevient sensible, qu’il redécouvre cette part d’humanité qu’il avait ensevelie.
Crimson Peak est un film intime et hanté, y compris par ses références. Guillermo Del Toro a une façon particulière de se réapproprier les éléments tout en jouant la carte du classicisme. Les tourments, les malédictions, les amours meurtris, la peur de la vie – et celle de la décomposition – suintent dans Crimson Peak, mais comme l’écho camouflé d’un créateur craignant le monstre de la vie à l’instar d’un enfant inquiet face aux cauchemars de la nuit. Cette carapace de conte gothique s’effrite enfin, se fissure et laisse transparaître une toute autre fragilité, bien plus autobiographique. Cette maison qui saigne et respire, c’est la terre de Del Toro, son Art, son âme.
Pourtant Crimson Peak et ses spectres bienveillants ouvrent la porte sur un étrange espoir. Empreint de mélancolie, s’il commence de la même manière que Le Labyrinthe de pan et que l’Echine du Diable, par une image où dominent le chaos et la désolation, suivie d’un retour en arrière, la fin est moins tragique. Dans les premiers plans des deux opus précédents, on pouvait voir un enfant à terre, gisant dans une marre de sang. Ici, l’enfant à l’agonie laisse place à une jeune fille blessée, meurtrie, qui a définitivement tourné la page de l’enfance.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).






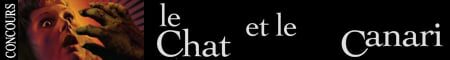









Claire
On sort de ce film en apparence simple, hanté, sans bien comprendre pourquoi. A ce sujet, votre article est remarquablement éclairant. Il donne un véritable relief au film.
Un grand merci !