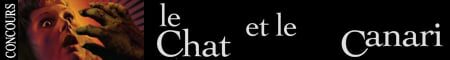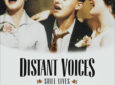Doriane Films sort dans sa collection Typiquement British les trois premiers moyens métrages du réalisateur anglais Terence Davies (dont les durées oscillent entre 20 et 40 minutes). La trilogie, d’inspiration autobiographique, rassemble « Children » (1976), « Madonna and Child » (1980) et « Death and Transfiguration » (1983). Le réalisateur l’entame, par les balbutiements de l’adolescence – c’est « Children », le volet le plus factuel mais déjà, d’une temporalité divergente – et va jusqu’à imaginer, non sans ironie, comment il vieillira, enjambant les âges, tous confondus, jusqu’à l’extrême vieillesse de l’épisode final.
Davies nous livre en guise de fils conducteurs : son homosexualité, un amour fusionnel pour sa mère, ses fantasmes sexuels, et le sentiment de culpabilité permanente qui l’habite. Son cinéma, d’une intensité peu courante, est suspendu entre un réalisme quasi documentaire, dans la lignée du cinéma anglais des années 60, et un montage lyrique, fait de trouées imaginaires et de passerelles temporelles. On l’aura compris cette première œuvre, inclassable et fulgurante, est d’une inaltérable singularité.
La trilogie s’ouvre donc sur « Children », par un récit plus réaliste et moins ramassé que ceux qui suivront. Terence Davies créé un double fictif, Robert Tucker, que l’on verra alternativement préadolescent et adulte, mais toujours hanté par les humiliations qu’il a subies. Le jeune Robert, complexé par un corps peu développé, devient la proie de ses camarades. La sévère autorité de l’enseignement catholique anglais, fondé sur les punitions corporelles, ne l’aide pas davantage à s’épanouir ni à se défendre. Il sert d’exutoire à tous ceux, qui, étant plus forts, n’ont qu’une hâte : asseoir comme les maîtres leur domination sur les plus faibles. La maison n’est pas un meilleur asile avec ses violences domestiques. Devenu adulte, Robert souffre toujours des mêmes rejets, d’autant que son homosexualité, difficilement admise, s’est affirmée. C’est donc le mal être et la dépression qui inaugurent la trilogie.
Le film rappelle les réalisations de Loach ou de manière plus évidente encore, la trilogie de Bill Douglas, mais il s’en distingue aussi par une manière de découdre la chronologie, par un jeu de renversements et de croisements incessants. Sans cette liberté plastique, qui s’affirme au gré de l’épisode, et ce point de vue du personnage, qui ne cesse d’évoluer dans des directions temporelles opposées, l’auto-apitoiement et l’hostilité dépeints seraient véritablement insoutenables. La beauté de la photographie en noir et blanc, tantôt profonde, voilée ou lumineuse, avec son grain affleurant, finit de l’emporter. Comme on le verra dans les autres épisodes, cette peinture de soi, de plus en plus fabulée et projetée au fil des épisodes (le réalisateur n’a pas plus que 35 ans à l’époque) contient sa part d’autodérision, même subtile. La narration, elle, gagne en liberté et en expérimentation, au profit d’une sorte de réalité poétique, sur le fil d’un fantastique intérieur. Au terme du premier volet, Terence Davies se démarque manifestement du cinéma réaliste anglais, dans lequel on serait tenté, par hâte ou par ressemblance, d’inscrire sa trilogie.

Dans le deuxième volet, « Madonna and Child », Robert a vieilli. Il est désormais un petit employé de bureau, solitaire et consciencieux. Ses traits se sont considérablement creusés, perdant le peu de grâce que lui conférait sa visage poupon. Il déborde de sollicitude envers sa mère, très âgée et de plus en plus dépendante. Sa dépression ne l’a pas quitté sans que l’on en identifie exactement la cause. C’est davantage un complexe de raisons qui apparaissent au fil de l’épisode : la solitude, la clandestinité, la honte, la morosité du quotidien. Le titre, et les rapports mère fils développés dans le film, évoquent une piété, mais inversée, pour ces catholiques toujours fervents. La mère console ce « bon » fils, qui ne la comble pourtant pas entièrement avec son célibat et sa vie nocturne, tandis que lui, porte de bonne grâce le fardeau de son déclin, à elle. L’intrication de ces sentiments est insoluble.
Le sacré et le blasphématoire se superposent également. Un panoramique balaie la nef d’une église tandis qu’on entend simultanément Robert appeler un tatoueur, pour le supplier de tatouer ses parties génitales. Ce second épisode est de loin le plus cru, dans ses audaces et ses évocations. Pour le reste, le spectre de la mort rode tout du long. A chaque voyage quotidien, dès l’ouverture, les larmes de Robert semblent anticiper la perte de la mère, sans que l’on sache si les plans juxtaposés, qui montrent les moments partagés, sont contigus ou appartiennent à un passé déjà remémoré. L’enchevêtrement des visions a déjà gagné en complexité et en ambigüité par rapport au premier volet.

Dans la trilogie, les plans, reliés en séquences, sont d’une malléabilité et d’une musicalité, permanentes. Il suffit d’un simple panoramique, amorcé par un regard en fuite, et le spectateur « switche » entre deux âges : il se balance dans un jeu d’allers-retours achroniques. La temporalité chez Davies est toujours en construction, mais les enchaînements sont très fluides, comme une série de glissements. C’est une mémoire qui s’imagine, se relate, et se réécrit, selon une logique plus intérieure que descriptive. Malgré cela, chaque épisode suit une ligne narrative très identifiable, avec une particularité thématique et un ensemble de segments qui se poursuivent. Plus les volets de la trilogie avancent, et, avec l’âge, leur confusion devient plus marquée et chaotique.
Dans « Death and Transfiguration », une série de boucles visuelles se déploie à partir du lit sur lequel repose Robert Tucker, devenu impotent et édenté, dans un hospice. Les souvenirs qu’il projette deviennent indissociables. Ils se confondent avec le présent et semblent investir réellement l’espace. Les séquences, précipitées, et d’un éventail chronologique toujours plus vaste, matérialisent l’épuisement du temps et sa compression. Le procédé, figure très littéralement la fin du personnage, et même, un appel mystique : Robert tend ses bras comme pour accueillir la force irradiante qui va l’embrasser. Pourtant, on ne ressent aucune lourdeur, ni symbolique, ni illustrative, car l’image, ahurissante, a un impact émotionnel direct. Elle est justifiée par une longue expérience visionnaire, qui rend son surgissement naturel. Elle est le terme poétique de la série.
%20copie.jpg)
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).


%20copie.jpg)