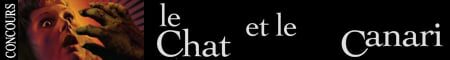Le nom de la rose (France-Italie-RFA, 1986) de Jean-Jacques Annaud (TF1 video)
Le nom de la rose (France-Italie-RFA, 1986) de Jean-Jacques Annaud (TF1 video)
Il est des films qu’on a envie de revoir pour mesurer le temps parcouru, et vérifier, justement, si les années leur ont été bénéfiques ou pas. Le Nom de la Rose fait partie de ces œuvres qui nous avaient captivés, lorsque notre regard n’était pas encore aiguisé… Qu’on se rassure, le film de J.J.Annaud vieillit vraiment bien et l’on reste toujours happé par les aventures de Guillaume de Baskerville et de son novice, Sherlock et Watson médiévaux confrontés à de mystérieux crimes dans une abbaye au Moyen-âge. Le livre d’Umberto Eco était réputé inadaptable par sa complexité, charriant d’innombrables thématiques, de la réflexion sur le mot et la culture, à l’étude sémantique, œuvre de linguiste, de métaphysicien et d’historien autant que d’écrivain, ce qui rendait le livre assez ardu. L’adaptation, sans être aussi impossible que celle de Süskind, présentait une difficulté comparable à celle d’un autre chef d’œuvre (et best seller, ce qui n’est pas si courant) du XXIe siècle, Le Parfum, sur lequel bon nombre de cinéastes se cassèrent les dents, dont Kubrick, avant que Tom Twyker s’y attèle honorablement… et avec beaucoup de simplicité. Annaud et ses co-scénaristes, débroussaillent l’œuvre d’Eco et plutôt que d’évoquer l’adaptation fidèle, le nomment malicieusement « palimpseste » du livre d’Eco, soit le parchemin effacé et réécrit. S’ils en changent parfois de manière regrettable certains éléments de l’intrigue en particulier dans la dernière partie, probablement pour se plier aux obligations de la production et donc d’un happy end (le méchant tué, la jeune femme sauvée), ils en gardent néanmoins l’essentiel, et surtout l’essence, le discours spirituel qui étaient la matière géniale du livre. C’est tout d’abord cette formidable et hallucinante enquête qui nous happe, dont l’atmosphère presque surnaturelle se nourrit de son décor, gigantesque espace clos au milieu des montagnes, digne du monastère népalais du Narcisse noir. Mais ce que n’oublie pas l’adaptation c’est le discours sur la subversion culturelle, la force du mot, du verbe, et ce débat sur des siècles de fanatisme religieux qu’illustre ce livre « maudit » d’Aristote sur le rire. On ne se lasse pas de l’intelligence de la réflexion, de l’évocation de ces manuscrits religieux derrière lesquels se dissimulaient protestation et provocation à travers les dessins délicieusement licencieux et blasphématoires dessinés par les moines eux-mêmes à grand renfort de sens caché. Le Nom de La Rose opère une fusion peu fréquente du divertissement parfait et de la réflexion, de la spiritualité. Le mystère à élucider se double d’une révélation liée à l’histoire des mentalités et l’histoire religieuse, et Le Nom de La Rose finit par résonner comme une ode à la culture et au livre, la force de l’Art comme arme suprême contre l’intolérance et les injustices. Le Moyen-âge d’Umberto Eco est plus qu’actuel. Comme il l’avait fait avec La guerre du feu, à grand renfort de spécialistes en préhistoire et de conseillers linguistiques (Anthony Burgess se chargeait de l’invention de la langue), le cinéaste perfectionniste qu’est Annaud s’octroie les services d’historiens de renom, dont l’incontournable Jacques Le Goff et la reconstitution s’en ressent, d’une authenticité confondante. On a beaucoup parlé de la distribution et effectivement la direction d’acteur est particulièrement impressionnante, de Sean Connery au tout jeune Christian Slater, en passant par Lonsdale tous plus crédibles les uns que les autres. Mais c’est peut-être le jeu de Ron Perlman qui impressionne le plus, acteur facilement cabotin, qui livre ici sa prestation la plus juste et la plus déchirante. Enfin, Le Nom de La Rose ne serait rien sans la partition de James Horner qui là aussi surprend à plus d’un titre. Musicien capable d’être affreusement emphatique et pompier lorsqu’il est symphonique, il compose ici au synthétiseur l’une de ses plus belles bandes originales, avec un leitmotiv particulièrement entêtant qui participe énormément à l’ensorcèlement que procure encore le film d’Annaud. La patte du coscénariste est visible, au point de donner parfois au film une allure presque polanskienne, dans ce mélange d’anxiogène et d’absurde. La constitution de son duo Guillaume-novice n’est pas sans ramener régulièrement à celui du professeur Ambrosius et de son élève Alfred dans Le Bal des Vampires. A l’heure où la plupart des blockbusters risquent l’accident de vitesse, où l’action ne connaît plus de moment d’attente, Le Nom de La Rose permet de constater combien le cinéma populaire n’a pas toujours été soumis à la rapidité. Il est d’une lenteur hypnotique propre à entretenir le mystère, jusqu’à sa résolution incendiaire. Combien d’œuvres grand public peuvent se vanter d’offrir actuellement une séquence aussi saisissante que celle de la bibliothèque labyrinthe du Nom de La Rose ? (O.R)
_______________
Il faudrait l’avis de J.J.Annaud lui-même sur le nouveau master du Nom de La Rose, car s’il aurait pu probablement subir une restauration un peu plus poussée, il semble qu’il respecte bien le grain d’origine qui est pour beaucoup dans l’atmosphère brumeuse et enveloppée du film. La copie est perfectible mais elle n’altère pas notre plaisir à le revoir dans de très bonnes conditions. En plus du commentaire audio d’Annaud cette édition nous présente le très beau making off de 1985 de 64 mn, invisible depuis presque 30 ans et dans lequel sont notamment présents, J.J. Annaud, U. Eco, S. Connery et C. Slater

The Bay (USA, 2013) de Barry Levinson (ARP Selection)
Le projet pouvait sembler incongru : la drôle de rencontre entre deux entités presque mortes, du processus du found footage qui, à force de se vivre comme fin, avait déjà épuisé toutes ses ressources pour finir à bout de souffle entre les mains de cols blancs peu scrupuleux, à un réalisateur oublié dont les dernières œuvres marquantes participent dorénavant d’un souvenir patrimonial du cinéma. The Bay aura tout du film de survivants, voir du « réflexe de survie » : une aura particulière qui fera, finalement, coup double. Réalisateur anachronique dans un film qui n’est pas fait pour lui, Barry Levinson s’amuse beaucoup à travers une vivifiante expérience vécue comme terrain de jeu. Insensible au « truc », renvoyant le dispositif a ce qu’il aurait du rester – un ensemble d’images archivées ici et là -, Barry Levinson se livre à un très bel exercice de montage qui fait glisser The Bay sur le terrain du journalisme et tourne le dos au témoignage faussement subjectif. On glisse vers un regard absolu : dans The Bay tout est filmé, par tout le monde, dans un univers de surveillance totale. Il suffira d’assembler : une tentative de reconstruction du réel qui sonne le glas d’un cinéma « faussement vérité », qui s’auto-érige en réalité indiscutable. The Bay s’assume en tant que fiction et c’est sa grande force. Née d’un projet de documentaire sur les ravages de l’industrie agroalimentaire, le film de Barry Levinson réinsuffle du politique dans un dispositif moribond et principalement au service des mensongers « inspirés de faits réels ». Ce n’est pas rien. (B.C)
_______________
Pour une fois le maigre making of de 8 mn offert par l’édition blu ray est loin d’être superflu. L’entretien avec Levinson est passionnant, en particulier lorsqu’il évoque son désir premier de faire un doc sur Chesapeake Bay, déclarée zone morte à 40 %. Face à un public qu’il juge peu concerné par les catastrophes écologiques, il opte pour le film d’épouvante, en exagérant la réalité. Que le pou de mer, en une étrange mutation rogne les poissons de l’intérieur, est une réalité : le scénariste métamorphose le fait, passant du microscopique au macroscopique. L’intelligence des propos de Levinson se retrouve dans son film, qui effraie justement par ce ce glissement, cette sensation de réel, et cette incapacité à déterminer ou se trouve les frontières. Aussi bluffant que les « documents interdits » découverts sur Arte, joliment subversif, si The Bay pouvait être l’un des derniers exercices de found footage, ce serait sans doute également l’un des meilleurs.
 L’Aventure de Mme Muir (USA, 1947) de Joseph L. Manckiewicz (Fox)
L’Aventure de Mme Muir (USA, 1947) de Joseph L. Manckiewicz (Fox)
On peut penser que Mrs Muir est un film un peu à part dans la carrière de Joseph L. Manckiewicz. Déjà, il ne fait pas partie de ceux dont il a écrit le scénario, il n’est pas directement imprégné non plus des grands jeux de constructions et dédales narratifs de certain de ses opus les plus sophistiqués. Le scénario de Philip Dunne renferme bien un sens du dialogue tout à fait digne de l’auteur d’Eve et Cléopâtre, mais dans ce conte habillé d’apparats tours à tours gothiques et victoriens, une grande linéarité semble en prime abord de mise. Elle tient même à un degré admirable tant le cinéaste gère un récit d’apparence limité qui vire en la création d’un « monde à part », qui subtilement abolit les frontières entre recours au fantastique et bulle rêvée, sans que l’on puisse déterminer ce qui tient de l’un ou de l’autre. « A quel jeu sommes nous en train de jouer ? » se demande l’héroïne, semi consciente de la douceur de son piège… Débutant comme une comédie qui met rapidement le spectateur dans sa poche, avec ce couple de fait platonique mais pas nécessairement prude, isolé et chassant le reste du monde. Manckiewicz pousse ensuite sa logique de prison intérieure subtilement, même si la tension qui prend plus concrètement forme entre entre corps et esprit, animant l’unique rebondissement central avec le rôle ingrat de Georges Sanders, parait un peu évacuée. Au-delà de la déception de son « autre » aventure pour Mrs Muir, s’est interposé pourtant sans discontinuer cet envoûtement et ensorcellement de la jeune veuve, à l’aide de ces décors côtiers qui restent parmi les plus beaux jamais utilisé par Hollywood, et un art des intérieurs, une profondeur de champs habile, qui font de ce cottage un navire qui parait embrasser un panorama infini alors qu’il fait figure de reculé et isolé aux yeux de beaucoup d’autres personnages. Signe de son « sacrifice » un peu sournois, pour laisser libre place à la chair qui lui aurait finalement damné le pion, le Capitaine Gregg ensorcelle Mrs Muir une « dernière » fois d’un souvenir onirique sans doute plus puissant que son spectre matérialisé. Ce rêve amoureux clairement exprimé fait pourtant bien du cottage de White Cliff un vraie pendant du futur Hanging Rock de Weir : on s’y laisse disparaître, spectateur compris. Il s’en suit une dernière partie qui reste encore stupéfiante en matière d’ellipse, faisant s’éclipser les années en deux temps avec autant d’aisance que d’ambiguïté, jusqu’à ce que ce jolie drame de chambre puisse virer presque au dantesque dans son ultime mouvement : l’héroïne en quête d’indépendance financière et sociale qui parvient à ses fins, sa (fuite) quête de solitude parrallèle, son isolement et son bien curieux compagnon de mer n’ont pas finis de tournoyer et de hanter le cinéphile. Mrs Muir tient d’un cinéma qui semble unifier tous degrés de lecture au lieu d’afficher crânement leurs multitudes, alors qu’ils sont pourtant bien réels. Dans une fluidité hypnotique qui nous amène aux confins de la fantasmagorie, il possède en prime une élégance et un humour d’une finesse redoutable. On discute un moment d’architecture dans le film…et clairement la plus puissante de toute la filmo du cinéaste s’avère peut-être bien celle qui ici se « voit » le moins. (G.B)
_______________
Fox réédite plusieurs classiques de son catalogue en Blu-ray ce mois-ci et outre Mrs Muir on peut retrouver le 15 décembre des titres comme Frankenstein Junior, La Folle Histoire du Monde, ou Le brigand bien aimé d’Henry King. Mrs Muir pour son passage en HD récupère ses bonus du dvd zone 1 (commentaire audio et bande annonce), excepté le documentaire sur Rex Harrisson. Piste anglaise et française 5.1 pour servir la fantastique musique de Bernard Herrmann…
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).
 Le nom de la rose (France-Italie-RFA, 1986) de Jean-Jacques Annaud (TF1 video)
Le nom de la rose (France-Italie-RFA, 1986) de Jean-Jacques Annaud (TF1 video)
 L’Aventure de Mme Muir (USA, 1947) de Joseph L. Manckiewicz (Fox)
L’Aventure de Mme Muir (USA, 1947) de Joseph L. Manckiewicz (Fox)