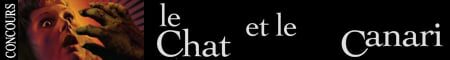Il est toujours difficile de découvrir des œuvres qui appartiennent au patrimoine cinématographique. Mankiewicz fait partie de ses « super-auteurs », assez intimidants, qui ont été sanctifiés par la critique et l’histoire du cinéma. Beaucoup de ses films sont posés, de fait, comme des chefs d’œuvres incontestables, qu’il faut recevoir comme tels. Pourtant, et c’est le cas avec « Chaînes Conjugales », la maîtrise de Mankiewicz ne saute pas immédiatement aux yeux (ou au cœur) – il n’a pas la vigueur baroque de Welles, pas le sensationnalisme ni la perversité de Hitchcock – ; sa maestria est d’abord dans l’écriture (il fut scénariste avant de passer à la réalisation, cela reste) et plus dans le dire que dans le faire, du moins dans un faire qui n’apparaîtra pas, d’emblée, comme démonstratif. Malgré l’audace de sa construction – trois flashs-back imbriqués dans un récit linéaire, lui-même surplombé par une narratrice en voix-off, sorte de metteuse en scène ironique -, « Chaînes Conjugales » donne l’illusion d’un film « classique », à la fois par son ton assez égal, sa stylisation subtile, son apparence naturaliste, et son réalisme psychologique.
Le film s’inscrit dans le cadre habituel de la bourgeoisie aisée, ici provinciale (les milieux populaires étaient plutôt l’apanage du film noir), sans l’ampleur lyrique du mélodrame hollywoodien. C’est plutôt une suite de conflits psychologiques, ténus et presque insignifiants, au sein de trois couples, qui narre la difficulté pour trois femmes à s’épanouir dans le mariage. Seule exception, le couple central déplace sensiblement la problématique et inverse le rapport de dépendance (ou de crise) présent dans les deux autres. George Phipps (Kirk Douglas) y est un professeur de littérature aux revenus modestes, qui doit son confort de vie, cette fois-ci, à son épouse. Là, se joue la question de la compromission artistique, mais aussi des valeurs et des idéaux, contre l’accession aux biens. Rita, sa femme (Anne Sothern), écrit des dramatiques pour la radio, qui ne sont que des prétextes « artistiques », pour placer des spots publicitaires très lucratifs. Ailleurs, c’est la difficulté à endosser un habit social et une fortune, qui sont ceux du mari. La femme, coupée de son milieu d’origine, s’aliène dans le mariage, même si cet asservissement est sans violence : c’est une « confortable » promotion.

L’ironie et la cruauté de ces « satires » conjugales n’apparaissent qu’indirectement, par une série de petits éclats. Rien de didactique ou d’expressionniste, tout survient dans le cadre très feutré d’une sociabilité ordinaire : soirée mondaine, réception privée, petits conflits ou appréhensions dans les antichambres domestiques. Avec beaucoup de pertinence, Mankiewicz choisit ce temps de l’avant, laps des préparatifs précédant les mondanités – se farder ou dresser la table – pour cristalliser les crises et les hypocrisies conjugales.
Un film de Mankiewicz s’appréhende d’abord par l’intelligence de son propos, plus que par le spectaculaire de sa forme (la chose est sensiblement différente avec « Eve », qui est comme une démultiplication, théâtrale et baroque, du récit gigogne de « Chaînes… »). L’intelligence formelle, qui en fait un chef d’œuvre, « subtil », ne se saisit que dans l’après, sinon elle ne serait qu’un truc, un procédé superficiel pour impressionner le spectateur qui prendrait le pas sur le récit. La thématique l’emporte de loin sur la démonstration, et la mise en scène se coule dans le sujet pour en souligner le ton. Les trois chicanes narratives des récits en flashs-back, amenées par un artifice – un son ou une image qui déclenche les remémorations -, s’inscrivent sans hiatus dans le cours de l’histoire. Ce sont des bonds dans une antériorité proche qui n’interrompent pas réellement la linéarité dramatique ; la temporalité, présente et revécue, reste continue. Il n’y a pas non plus le sentiment de labeur ou de répétition, lié à la reprise en « sketch » du procédé.

L’invention d’Addie Ross, le personnage mystère qui plane sur le récit sans jamais apparaître, est le prétexte qui motive ces retours en arrière. Femme idéale pour les maris, et menace pour les épouses, elle annonce sarcastiquement à ses trois « chères amies » qu’elle part avec l’un de leurs époux tout en se gardant de préciser lequel. Les trois femmes reçoivent sa missive alors qu’elles partent encadrer une sortie avec les orphelins de la ville. Il leur faudra attendre la fin de la journée, pour connaître à leur retour, laquelle des trois a été abandonnée.
Ce faux suspense est un prétexte à susciter l’examen conjugal et à ressouder les couples qui peuvent encore l’être ; mais en soi, sa résolution importe peu. Addie est une sorte de Deus ex Machina, une dramaturge piquante qui s’amuse à provoquer la destinée des personnages. En ne voulant pas trop marquer ces artifices, pourtant très modernes, Mankiewicz montre qu’ils ne sont pas une fin en soi, et en neutralise l’effet. « Chaînes conjugales » n’est pas un manifeste cinématographique qui découd la narration traditionnelle, mais une série de variations inscrites dans une unité de récit et de thématique. Son attrait ne tient pas véritablement dans ses procédés ou dans sa chute en trompe-l’œil mais bien dans son entre, sa conduite narrative, ses jeux d’échos et de différences entre les situations des épouses. Ceux qui attendront le grand spectacle « promis » par l’aura du chef d’œuvre, risquent d’en être, dans un premier temps, pour leurs frais ; car c’est une œuvre de finesse, au formalisme contenu, malicieuse, et presque « déceptive ».
En dernier lieu, restent cette ironie et cette férocité, que l’on prête exagérément, encore, à Mankiewicz (ironie que l’on peut lire aussi dans l’artifice convenu, mais peu dupe, des happy-end finaux). Or, la particularité du réalisateur semble être, justement, de ne jamais l’énoncer de front, mais plutôt avec une forme de distance, voire de hauteur, qui n’est pas de la condescendance stricto sensu (il compatit avec ses héroïnes) ni de la cruauté. Ce recul d’observation associé à un commentaire discret, au creux du récit, peut le rapprocher d’une certaine manière de Max Ophuls. Mankiewicz est là tout en restant en retrait. Il ne s’impose pas comme l’énonciateur du récit, ou son contempteur lucide, mais passe toujours par une médiation, de voix et de regards, qui dissout son point de vue. Cette sorte de contrôle flegmatique peut « rappeler » les films (postérieurs) de Kubrick qui produisent un sentiment similaire : très maîtrisés et sans une instance d’énonciation trop affirmée. C’est cela qui me fait dire que Mankiewicz est d’une certaine manière un héritier du classicisme hollywoodien tout en étant une figure moderniste, adepte des récits inusuels et retors, formalisés en flashs-back, mais tellement assis, qu’ils en finissent par paraître transparents. Et c’est peut-être là, finalement, en sus de l’écriture, que réside son génie tant loué : un art suprême de l’illusion et de la réserve ironique.
Reprise en salles le 9 juillet 2014 (DCP)
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).