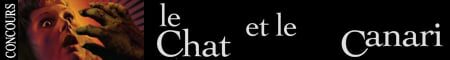« The Immigrant » réalisé quasiment vingt ans après « Little Odessa » est un film symptomatique sans que l’on puisse statuer définitivement sur le sens desdits symptômes. Volonté de conformisme? Aspiration néo-classique au mélodrame hollywoodien? Tentation du grand spectacle? Le tout est que, sans être mauvais, « The Immigrant » reste un film assez hybride, où se télescopent le récit historique et la tragédie lyrique, dans un soufflet d’ambitions un peu paradoxales. Il donne l’impression d’un Gray, tantôt retenu, tantôt exubérant, un peu lesté par la picturalité convenue des images. Malgré cet improbable mélange, le film se regarde sans déplaisir même si l’on peine vraiment à se sentir concerné par ce grand (contre) récit fondateur, avec ses icones boisées de maquereau tragique ou de sainte putain…
Un mélodrame de l’immigration
Ewa (Marion Cotillard) et sa sœur Magda, deux jeunes immigrantes polonaises démunies, débarquent à Ellis Island en 1921, dans l’espoir de retrouver une tante et un oncle qui ont prospéré sur le continent. Au contrôle, Magda, tuberculeuse, est mise en quarantaine tandis qu’Ewa est refoulée par un agent. Celui-ci lui rétorque que l’adresse qu’elle a donnée, celle des parents newyorkais, n’existe pas. En passe d’être renvoyée, Ewa est sauvée in extremis par Bruno (Joaquim Phoenix), un faux agent de l’aide sociale, qui soudoie les gardiens du bureau de l’immigration pour recruter des « danseuses » qu’il installe dans son petit théâtre du Lower East Side. Désormais dépendante de Bruno, qui ne pourra faire sortir Magda de l’hôpital d’Ellis Island qu’au prix d’un lourd pot-de-vin, Ewa doit se plier aux volontés de son souteneur
Le pari du « grand » film historique
James Gray est assurément l’un des réalisateurs majeurs à être apparus dans les années 90 mais la réception de son cinéma a toujours été partagée. Certains ne voient en lui qu’un habile maniériste quand d’autres apprécient son art tout à fait personnel de la synthèse, entre influences européennes et américaines. Mais ce qui distingue Gray de nombre de ses contemporains reste par-dessus tout son grand talent de narrateur. Cela lui permet de concilier la sobriété d’un récit intimiste avec des envolées romanesques et d’impitoyables échafaudages tragiques. Toute la particularité de Gray vient de sa capacité à pétrir cela, tout en s’inscrivant plus ou moins directement dans l’économie du film de genre, le polar ou le policier, au risque d’apparaître parfois comme un avatar sophistiqué du Coppola du premier Parrain. Depuis ses dernières années, Gray a également tenté de casser sa mécanique : « La nuit nous appartient » s’autorisait une longue scène d’action très spectaculaire et « Two Lovers » abandonnait totalement l’univers du polar pour se recentrer sur un nœud passionnel et familial. « The Immigrant » s’inscrit en plein dans cette logique de rupture en osant le pari d’un film vraiment historique, bien au-delà du léger anachronisme qui semblait animer son cinéma jusque là. C’était un pari risqué, puisqu’on pouvait craindre que le réalisateur, en adoptant cette voie, n’entre un peu trop dans les couloirs, ou le hall béant, du Grand Cinéma.

Euphémisme et fausses ambigüités
Dans « The Immigrant », on retrouve toujours les éléments propres au cinéma de Gray, mais un peu en creux, comme s’ils avaient été vidés de leur substance et considérablement aplanis. Bruno, le personnage joué par Joaquim Phoenix, est un souteneur ambigu dont on ne sait pas dans un premier temps, s’il s’applique à sauver ses pairs ou bien à les exploiter sans vergogne. Ewa, la jeune immigrante interprétée par Marion Cotillard, est partagée entre son apparence ingénue et l’immoralité des actes qu’on lui prête. Malheureusement, Gray se sent obligé de désamorcer ces ambigüités et il contraint ses personnages à passer à la confession, dans des scènes finales aussi embarrassantes que superflues. Cette tendance à tout clarifier et à canoniser les personnages, y compris par une photographie à mi chemin entre l’iconographie religieuse et les clairs obscurs, excède ou ne provoque qu’une indifférence polie. A trop forcer la représentation, Gray en finit par négliger la composition de ses personnages. Le film provoque un sentiment de flottement comme s’il était constamment dans la sur-représentation et jamais dans une incarnation, plus complexe et émotionnelle. Il en va de même pour son lyrisme, bien plus formel et imagé, que véritablement investi. La violence des actes et en premier lieu, la représentation de la prostitution, sont curieusement éludés par le réalisateur comme s’il voulait maintenir chez le spectateur l’illusion que Bruno fabrique pour enrôler ses proies. Quand Ewa, acculée par les circonstances, finira par faire commerce de son corps, Gray procédera à une ellipse, dont on ne sait qui, de la pudibonderie ou de la convention désuète, l’emporte. Malgré tout, on pourra prendre un certain plaisir à cette picturalité de fresque très distanciée et relever la beauté de l’objet. Reste que le film demeure une expérience frustrante, surtout pour qui connaît le cinéma antérieur de James Gray, bien plus direct dans ses images et ses émotions.

Facture faste, personnages contrits
On peut s’interroger sur la pertinence de la direction artistique du film avec son image convenue entre clichés sépia et sempiternel chatoiement. Quand les personnages vont mal, c’est la température des images qui descend pour signifier leur sueur froide : la nuit tombe ou le temps pluvieux bleute les cadres comme dans la scène finale sur Ellis Island. Concernant l’histoire, il manque l’un des ciments scénaristiques des précédents opus. Ici, ce n’est plus une tragédie familiale ou intime qui est au centre du récit, mais juste une histoire d’amour perverse entre les personnages, avec une expiation-rédemption à la clé. Au vu du résultat, on n’est pas tout à fait persuadé que Gray ait gagné au change. N’est pas Bresson ou Visconti qui veut. Les emprunts trop référentiels surnagent à la surface du récit. N’est pas, non plus, Falconetti ou Wiazemsky qui joue. Il n’en reste pas moins que Cotillard et Phoenix font un bon travail d’interprétation. La réserve vient davantage de l’unidimensionnalité de leurs personnages respectifs qui les amène à adopter un jeu caricaturalement contrit ou pudique. On s’interroge donc, au-delà des réticences formelles, sur ce qui fait défaut au film pour véritablement prendre. Problème de scénario, de personnages? En voulant s’éloigner des composantes de son cinéma habituel pour casser ce qui aurait pu devenir un moule, Gray et son scénariste ont pris le risque d’une écriture très artificielle. Dans les entretiens, le réalisateur et ses acteurs ne cessent de clamer qu’il s’agit là d’un film très personnel. Cette insistance sur l’authenticité prétendue du film sent un peu le déni et le paradoxe. Que le thème puisse être cher à James Gray du fait de ses propres origines est une chose, néanmoins, d’un point de vue cinématographique, on peut se demander s’il ne s’agit pas là du film le plus classicisant et impersonnel de son auteur. « The Immigrant » illustre, littéralement, le genre de la fresque historique. En dernier lieu, l’hétérogénéité des registres narratifs (récit historique, tragédie, opéra, métaphores religieuses) peine à prendre corps, et ce malgré l’unité de la facture visuelle.

Volonté du trop
« The Immigrant » se situe donc dans cet entre-deux : beaucoup de savoir-faire, des prestations d’acteurs assez convaincantes, mais un manque d’âme et de cohésion. Pour tout dire, cette manière d’emboiter la petite et vile histoire dans la Grande, garde sa facticité romanesque. Le film échoue à documenter et opte pour la fable en imagier. La romance contrariée des deux protagonistes, entachée de perversité, divise la fiction en deux ilots qui peinent à communiquer. Orlando, le troisième larron qui va exciter la jalousie violente de son cousin Bruno, est un personnage bien trop succinct. Charnière du triangle passionnel, il ne fait que rajouter à l’hétérogénéité du couple ennemi Ewa-Bruno. La scène finale où Ewa finit par s’attendrir sur Bruno et lui accorde son pardon, alors même que celui-ci s’auto flagelle en personnage de tragédie, ne convainc pas vraiment. Elle accentue la facticité du film, assumée mais bancale, toujours à cheval entre l’emphase baroque, le réalisme historique et le mythe. On peut penser, finalement, que Gray s’est un peu laissé emporter par des ambitions difficilement conciliables. C’est ce manque de visée, comme parfois de justesse, qui, au-delà du glamour appuyé des acteurs et de la photographie, laisse le spectateur dans un état de suspension insatisfait. Au sortir de « The Immigrant », on se met donc à souhaiter que le réalisateur renoue avec le cinéma qui l’a fait connaître. Un cinéma, où les composantes lyriques et épiques étaient un peu plus contenues, mais qui n’était pas élusif pour autant.
Crédit photo © 2013 Anne Joyce
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).