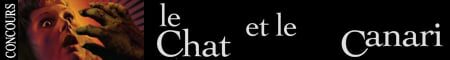reprise en salles le 13 novembre 2013 (version numérique restaurée)
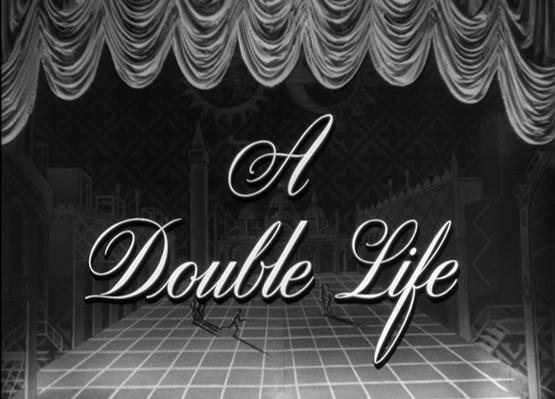
Dissipons tout malentendu. Pour qui craindrait une énième resucée de la pièce de Shakespeare, le "Othello" de George Cukor, va bien au-delà du programme attendu par sa mise en scène aussi élégante qu’inventive. Le film se livre à un jeu de mise en abyme des plus vertigineux avec, à la clé, la bascule d’un acteur dans les affres insondables de la folie. Si cet Othello-là tient du chef d’œuvre inespéré, c’est précisément parce que son sujet, contrairement à ce que le titre français laisse entendre, dépasse autant l’adaptation que la transposition maligne. Il y est question de cette limite ténue entre l’art et la réalité, cette double vie du titre original, dans une puissante valse de registres : drame psychologique, comédie enlevée, film noir passionnel… Au cœur de ce tumulte hallucinatoire qui pourrait bien faire tourner la tête des spectateurs, on trouvera dans le rôle principal un acteur remarquable : Ronald Colman.

Mais qui est donc Anthony John? L’homme, écrasé par son portrait monumental, traverse le hall du théâtre, col d’imperméable relevé, le chapeau bien enfoncé. Tandis qu’il arpente la rue, ce travestissement anonyme fait déjà de lui une figure de film noir. Comme on le reconnaît, les paroles fusent. Admiré ou vilipendé, l’homme, au-delà de l’acteur, est un amalgame contradictoire à la réalité indécise : humble, arrogant, courtois ou volage? Rendu chez le directeur artistique du théâtre, il se voit proposer le rôle de la consécration : Othello. L’acteur en est alors à l’heure des bilans, tant pour ce qui est de sa vie conjugale, ratée, que de sa vie professionnelle, plus réussie, mais cantonnée au registre comique. Pourtant, traversé par le doute, "Tony" refuse dans un premier temps, sans que l’on en connaisse la véritable raison. Serait-il de taille? En réalité, c’est une toute autre crainte, peu formulable, qui le fait hésiter : la peur de s’abîmer dans le rôle. La grandeur de cet acteur populaire tient en effet à cette fragilité : il s’implique au-delà du raisonnable et donne un sentiment de vérité peu commun à ses interprétations.

Passée l’exposition magistrale du film, qui brasse toutes les cartes thématiques sans circonvolutions explicatives, on pourrait craindre un déploiement très prévisible de la fiction, entamée par son faux suspense. L’acteur renoue avec son ancienne épouse Brita, qui interprètera à ses côtés Desdémone. Bien évidemment, dans les coulisses, la jalousie le rattrape. Othello va-t-il tuer sa Desdémone ? Pourtant, en fins renards, Cukor et ses scénaristes, ne cesseront d’aménager des différés et des développements, qui rendront l’échéance bien secondaire. L’une des plus belles digressions est ce tête à queue invraisemblable dans l’univers sordide du film noir. Ce détour ulmerien imprévisible va dédoubler les perspectives. Anthony John se distrait avec Pat, une petite serveuse vulgaire (Shelley Winters toujours excellente), qu’il a rencontrée dans une pizzeria de quartier, sorte de Venise de poche prise en étau entre deux rues malfamées. Il la séduit sans mal en flattant ses aspirations de comédienne. La schizophrénie patente de l’acteur s’illustre dans cet écart clandestin : au faîte de sa renommée, il n’aspire qu’à l’anonymat et à une trivialité médiocre afin d’échapper aux mondanités.

A l’opposé de ce contrechamp insolite, le vrai drame passionnel épouse une direction plus convenue. Bill, qui est l’agent des acteurs, a réconforté Brita lors de sa séparation avec Tony, sans toutefois réussir à le remplacer complètement. Cette tendresse, bien visible, suffit à exciter la jalousie de l’acteur. Elle lui donnera même l’énergie "criminelle" que requiert son rôle en le faisant s’aventurer chaque soir un peu plus loin dans le jeu des violences mimées. Pour d’autres raisons, quand l’intrigue retombera dans les rails d’une enquête policière trop convenue, elle décevra, mais la plupart du temps, elle ne fera que jouer de ces changements de registres impromptus, sortes de fabulations à ciel ouvert, où la vie est contaminée par une mauvaise comédie. Avec ce jeu d’ondes distordues, tantôt pathétiques tantôt grotesques, Cukor ne cesse de faire grandir le malaise du personnage, bientôt assailli par le démon de ses voix intérieures. Ce sera son rôle qui finira par lui édicter sa conduite, le dépossédant et l’amenant à voir des transpositions de la pièce, à chaque coin de rue. Néanmoins, le récit ne s’échouera jamais dans le pathétique attendu ou le simplisme de la métaphore, art et vie confondu. Cukor y met un humour et une folie qui dépassent allègrement l’illustration laborieuse. Ce sont tous les régimes de récits qui semblent être convoqués, et joués par cet acteur fragile, qui organise son destin comme une grande pièce déréglée. Au comble de l’ironie, il y aura chez lui l’orgueil futile de démontrer, par-dessus tout, qu’il n’était pas un piètre comédien…

On connaît mille récits de ce genre, fameux ou poussifs, à jouer sur cette équivoque, ludique ou pathétique, d’art et de réalité. On peut évoquer les plus exemplaires : les fresques renoiriennes empruntant à la commedia dell’arte ou au théâtre ordinaire ; l’actrice Gena Rowlands en plein trouble chez Casavettes. Versant noir, on se remémorera le criminel fragile interprété par Carl Bohem dans "Le Voyeur" chez Michael Powell, ou encore, les bouffées d’une folie bigarrée, qui saisissaient le journaliste arriviste, dans le chef d’œuvre de Samuel Fuller. Hormis sa splendeur visuelle (photographie de Milton Krasner) et son montage très alerte (par Robert Parrish), l’Othello de Cukor se démarque par cette capacité à engranger une multitude de récits possibles et à les emboiter malicieusement les uns dans les autres pour faire ressortir l’incohérence de plus en plus criante de l’acteur. Sa force réside dans le fait qu’il ne se tient jamais dans un monde narratif, ni dans la stricte fable imaginaire, ni dans la comédie, ni dans le drame, mais dans un entre "plusieurs", complexe et virevoltant. A bien des titres, "Othello" est un film précurseur à l’inventivité atypique. Qui plus est, loin de souffrir la comparaison et tout en étant très différent, il rivalise avec les fastes et la démesure du film, postérieur, de Welles.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).