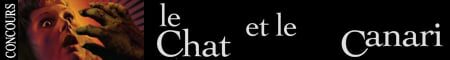Ce film qui vient d’être réédité en Blu-Ray et DVD (Carlotta) est considéré comme l’un des fleurons du cinéma politique italien, et, par certains, comme le chef d’oeuvre d’Elio Petri. Il a obtenu de nombreuses récompenses, parmi lesquelles le Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes (1970) et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère (1971).
Il en avait déjà été question sur Culturopoing, en 2010, sous la plume de Bénédicte Prot : ICI.
Nous proposons pour notre part, ci-dessous, un texte que nous avons écrit en 1995.
—
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon ou le paradoxe du Pouvoir.
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, c’est le pouvoir politique, la prison du pouvoir, l’enfer du pouvoir, avec la dissociation et la maladie que cela provoque (Elio Petri, 1).
Le personnage principal du film réalisé en 1969 par Elio Petri est chef d’une brigade criminelle (Gian Maria Volonte). Au moment où débute l’histoire, alors qu’il vient d’être promu au rang de Commissaire du Bureau politique, ce fonctionnaire haut placé assassine froidement son amante, Augusta Terzi (Florinda Bolkan). À partir de ce fait divers, le cinéaste, oscillant sans cesse entre le comique et l’horreur, va tenter de démonter les mécanismes psychologiques et politiques du pouvoir. Il va pousser jusqu’à l’absurde les dilemmes dans lesquels peut être enfermé tout un chacun quand il a à obéir en même temps à des intérêts ou à des ordres divergents. Plusieurs récits composent ce film : celui de la relation sadomasochiste entre le policier et sa maîtresse, aboutissant à un passage à l’acte fatal, celui des méthodes répressives et démagogiques utilisées par un régime pseudo-démocratique pour parvenir à un contrôle absolu des corps et des consciences et, surtout, comme nous allons le voir précisément dans le cours de notre analyse, celui de la manière dont un potentat peut se révéler, à son corps défendant, soumis lui aussi à l’autorité, qu’elle soit représentée par le Surmoi ou par les Institutions (potentat dont le comportement despotique est le masque d’un infantilisme capricieux et d’un complexe d’infériorité). En entrecroisant ces récits, en décrivant leurs interactions, Petri tisse les liens entre les ordres du social, du politique, du sexuel et de l’affectif. Il explique, aussi, en quelque sorte, que rares sont les relations humaines ne renvoyant pas à des situations oedipiennes où s’intriquent et s’affrontent le désir et la loi.
Par rapport à l’acte délictueux dont il est l’auteur, le commissaire adopte, continuellement, deux attitudes opposées : il se désigne implicitement comme étant le coupable, fournit de multiples indices compromettants aux enquêteurs et, presque simultanément, détruit ces indices, brouille les pistes, s’ingénie à échapper aux pièges qu’il a lui-même tendus. À l’inverse, lorsqu’il s’aperçoit que le tour pris par les événements a pour conséquence de le mettre hors de cause, il fournit de nouvelles preuves de sa culpabilité.
Si, en effet, après avoir commis son méfait, le meurtrier laisse sciemment ses empreintes sur les lieux du crime, lorsque, plus tard, il se rend au domicile d’Augusta Terzi avec les enquêteurs, il fait en sorte de remettre ses empreintes digitales exactement là où il en avait déjà laissé. Agissant ainsi au vu et au su de ses collègues, et avant qu’aucune empreinte n’ait encore été enlevée, il met en cause, nie ses intentions premières. D’autre part, si la réaction instinctive du commissaire, au moment où débute l’enquête, est d’imputer le crime au mari de la victime, lorsqu’il se rend compte qu’en faisant condamner un innocent, son acte n’est pas, en quelque sorte, reconnu, il décide de blanchir bouc émissaire. Il adresse alors de nouveaux indices aux enquêteurs – devant théoriquement leur permettre de découvrir l’auteur du meurtre – et en informe la presse, créant ainsi un coup de théâtre inattendu, relançant l’affaire de manière spectaculaire.
Il joue un double rôle : celui du justicier et celui du hors-la-loi. Il satisfait tour à tour des désirs antagonistes, sert les intérêts de chacune des deux forces qui sont en lui. La première d’entre celles-ci traque le coupable, la seconde cherche à le soustraire à la justice. Le bénéfice tiré par le personnage de cette situation périlleuse, épuisante, est que, en tout état de cause, c’est lui qui mène le jeu, dirige l’enquête – et ce bien qu’il ne fasse plus partie de la « Section des Homicides ». C’est lui qui, à sa guise, met les enquêteurs sur la voie de la vérité ou, au contraire, les fourvoie. Quoi que fassent ceux-ci, il conserve une longueur d’avance sur eux et fait en sorte que ce soit lui, toujours, qui ait déterminé leurs actions.
Le personnage concentre sur lui l’attention de tous. Il est à la fois le metteur en scène et le protagoniste du drame. L’affirmation mégalomaniaque de soi à laquelle il se livre, sa volonté d’omnipotence et d’omniscience, passent par la négation de l’autre, par sa réification.
Manifestement, le commissaire prend un plaisir – dont il ne réussit pas toujours à cacher le caractère jubilatoire – à exercer une domination sur autrui, à infliger douleurs physique et morale, à humilier. Il aime contraindre l’autre à se plier à ses désirs. À tous ses désirs. Il use et abuse des pouvoirs que lui confèrent son rang, jouit sans vergogne de ses prérogatives, y compris celles qui le placent dans l’illégalité.
En assassinant Augusta Terzi, le commissaire exerce le pouvoir dans sa forme extrême, la plus violente qui soit : il dispose de la vie de son amante, fait tout simplement disparaître la jeune femme. Il n’hésite pas à mettre des innocents dans la situation d’être accusés et condamnés à tort, profite de ce qu’il a accès à des archives secrètes pour obtenir des informations sur la vie privée de ses propres collègues, et les menacer de s’en servir, se livre au chantage. Il obtient de son supérieur immédiat des moyens d’action illicites, accordés à titre officieux.
Suivant son humeur, il se comportera avec ses interlocuteurs, avec ses subalternes comme avec les simples citoyens, de façon tyrannique – les considérant avec morgue, leur parlant sur un ton comminatoire, inquisitorial, imposant des arguments irréfragables – de façon paternaliste ou protectrice – donnant à l’un une tape sur la joue, attirant familièrement à lui un autre en le prenant par la nuque – ou de façon hypocritement compréhensive et amicale. Mais, toujours, avec la sournoise intention d’amener les gens à qui il a affaire à ses fins, d’obtenir d’eux ce qu’il veut, au moment où il le veut, et quelle que soit la nature de ce qu’il veut. Le plus arbitrairement possible.
Le pouvoir dont use le commissaire ne se réalise pas seulement sur le mode de la contrainte, mais sur celui, pervers, de ce que l’on appelle la « double contrainte ».
Après avoir envoyé, par voie postale, de nouveaux indices à la police pour innocenter le mari de la Terzi, le commissaire téléphone à Patané, le journaliste auquel il a l’habitude de réserver ses informations. Sans que l’on sache si c’est à dessein ou non, il masque sa voix, mais insuffisamment, de telle sorte que son interlocuteur le reconnaît. Lorsque Patané, qui a révélé par voie de presse les faits dont il a eu connaissance, s’apprête en toute bonne foi à donner aux enquêteurs l’identité de son informateur, le commissaire, menaçant, l’en dissuade : « Moi, je ne téléphone pas ! », hurle-t-il. Plus tard, ayant besoin de se procurer une nouvelle cravate afin de remplacer et de détruire celle qu’il portait le jour du crime et qui constitue une preuve de sa culpabilité, le chef du Bureau politique aborde un passant et obtient de lui qu’il achète à sa place rien moins qu’un lot entier de cravates. Lorsque ce commissionnaire les lui remet, il change d’attitude. Se présentant comme l’assassin de la Terzi, il ordonne à son vis-à-vis de le dénoncer à la police. Se rendant peu après dans le bureau de Mangani, le nouveau chef de la « Section des Homicides », il y trouve le passant et, le persuadant de renoncer à révéler ce qui s’est passé, l’oblige à invoquer une méprise.
Le protagoniste du film produit des injonctions paradoxales : il se révèle à l’autre comme étant le criminel et l’oblige, plus ou moins explicitement, à le dénoncer. Mais, au moment où cet autre est sur le point de s’exécuter, il lui donne un ordre contraire, le met dans une situation où la dénonciation devient impossible, absurde, dangereuse. La double contrainte vise à satisfaire, chez celui qui l’impose, des désirs conflictuels. Elle annihile, chez celui qui en est victime, toute possibilité d’agir. Elle crée en lui une confusion mentale, le déstabilise, le réduit à l’impuissance. Elle l’oblige à fuir pour ne pas sombrer dans la folie. Guy Rosolato, qui a abordé d’un point de vue psychanalytique la théorie du « double bind » chère aux membres de l’École de Palo-Alto, préfère, pour sa part, utiliser le terme de « double entrave » pour insister sur l’idée d’empêchement, de frein mis à l’action (2). Il explique que l’injonction paradoxale manifeste la volonté d’assujettir l’autre et d’affirmer un sentiment d’omnipotence : « La double entrave imposée est le pouvoir, la décision de placer autrui dans un choix indécidable, donc de lui ravir le pouvoir de décision. C’est en cela que se manifeste l’idéale toute-puissance narcissique : de n’y être pas soi-même par ce moyen soumis » (3). Et l’auteur d’ajouter immédiatement après : « Mais (…), comme pour le sadomasochisme, le fait de ne pas pouvoir être soumis est ressenti comme une restriction : de sorte qu’on en vient à intérioriser cette double entrave, à se l’imposer à soi-même par un excès de maîtrise » (4). Les méthodes d’intimidation et de culpabilisation, les peines qu’il impose aux autres, le commissaire semble bien, effectivement, se les appliquer à lui-même. Il est, en fait, l’objet d’un processus immanent de double entrave. Soumis, par clivage, à des instances impitoyables le poussant au délit tout en lui en faisant grief, lui enjoignant de confesser sa faute en même temps que de la cacher, l’entraînant ainsi dans un cercle vicieux, une spirale sans fin.
La secrète intention du commissaire est de démontrer son « insoupçonnabilité ». Et c’est parce que, selon lui, elle ne serait pas alors démontrée, qu’il renonce à faire endosser le crime par le mari de l’assassinée. L’« insoupçonnabilité » du commissaire-meurtrier réside dans le fait que la place qu’il occupe, son rôle social de garant de la loi et de l’ordre, rendent inconcevable pour les autres l’idée qu’il puisse avoir transgressé un interdit, et ce malgré les indices qu’il fournit. Mais la condamnation du mari faisant objectivement, selon nous, la preuve de son « insoupçonnabilité », il faut admettre qu’il cherche autre chose : la prolongation, indéfiniment, d’une situation où il aurait, toujours, inlassablement, à faire la preuve qu’il ne peut être suspecté. Et, à travers cette situation, la possibilité d’exprimer le sentiment d’une faute et de lutter contre l’impunité que, paradoxalement, il cherche lui-même, avec l’aide du système, à s’accorder.
Le besoin d’aveu et de punition qui agite le commissaire se manifeste clairement lorsqu’il procède à l’interrogatoire d’Antonio Pace. Pace est un opposant actif au régime, un de ces révolutionnaires que la police cherche à éliminer ; et il était, par ailleurs, lui aussi, amant de la Terzi. Il sait que le commissaire est l’assassin de la jeune femme, mais, malgré les supplications auxquelles ce dernier va avoir recours (« J’ai mal agi, mais je veux payer »), se refuse à le dénoncer. Il entend l’obliger à vivre avec sa mauvaise conscience (« Tu l’es et le demeures, un criminel qui dirige la répression »). La situation, les rôles se sont brusquement renversés. Le commissaire se trouve à la merci de son rival, il l’implore, en quelque sorte, de le délivrer de son aliénation, de l’aider à trouver la paix. Mais Pace résiste à son interlocuteur ; et il est le seul à sortir vainqueur de la confrontation avec le machiavélique policier. Peut-être l’aveu de faiblesse de celui-ci est-il une ultime ruse ? Toujours est-il que le meurtrier trahit son désir d’expiation et éclaire a posteriori, s’il en était besoin, le comportement dont il fait preuve depuis le début du récit.
Après sa confrontation avec Pace, le commissaire livre des aveux écrits à un Mangani médusé (5), puis, attendant chez lui qu’on vienne l’arrêter, il fait un rêve… Tous ses collègues sont présents, et l’admonestent – là encore, non pas tant pour son crime que pour le fait qu’il en éprouve de la culpabilité. Ils détruisent, invalident systématiquement les preuves qu’il procure pour s’accuser du meurtre de la Terzi. Finalement, le policier accepte de faire acte d’allégeance : « Je vous obéirai. Je confesse mon innocence ». Le rêve est encore une tentative, pour lui, de conformer la réalité à ses désirs, de se mettre en scène et de voir ses collègues agir selon ses directives. Le personnage manifeste ainsi l’espoir que l’issue du drame sera heureuse, qu’il pourra s’expliquer, avouer, tout en rencontrant la bienveillante compréhension de ses pairs, leur pardon ; qu’il pourra, grâce à cette parodie de procès, à ce compromis burlesque, battre sa coulpe tout en se sachant protégé. Son souhait est que le Corps, la famille dont il fait partie soit en fin de compte ressoudée et renforcée dans son pouvoir ; que ses actes de désobéissance, ses écarts de conduite, seront oubliés… … Le commissaire se réveille : tous ses collègues sont là, exactement comme dans le rêve. La réalité va-t-elle s’y conformer ? Le protagoniste reste-t-il encore maître de la situation au point de faire que se vérifie sa prémonition ? En fait, nous n’en saurons rien, car le récit est interrompu. La caméra est soudainement éloignée de la scène qui commence et, tel le rideau d’un théâtre, le store de l’une des fenêtres de la pièce où les personnages sont réunis est baissé. La suite se passera dans le secret d’un huis clos. La conclusion du film est volontairement suspendue. Les arcanes du pouvoir resteront, en définitive, impénétrables (6).
On pourra se demander si la faute dont le commissaire se sent coupable – faute qui trouverait son origine dans la nuit des temps de l’enfance et dont le crime ne serait pas une cause, mais une conséquence – n’est pas donnée comme irrémissible. Et si le châtiment qui la sanctionne ne réside pas, précisément, dans l’impossibilité pour le fauteur de trouver une issue au conflit qui le déchire.
D’autre part, nous présumerons que la réalité à laquelle le protagoniste fait retour, après le rêve, risque fort de lui être défavorable. Dans la pièce où doivent être réunis les fonctionnaires de police, il n’y a pas, comme précédemment, du champagne sur la table – aucune réconciliation, donc, à fêter. Par contre, en voyant arriver ses collègues, le commissaire fait mine de boire un verre – le dernier ? Il ne sera peut-être pas reconnu coupable par ses pairs, mais cela ne veut pas dire que ne le condamnent pas son arrogance et la menace qu’il représente pour le pouvoir…
Notes :
1)
In Elio Petri (sous la direction de GILI J.A.), Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Section d’Histoire, Nice, 1974, p.83.
2)
ROSOLATO G., La Relation d’inconnu, Gallimard, Paris, pp.164-169.
3) Ibid., p.165.
4) Ibid., pp.165-166. Sur ce sujet, on pourra également se reporter à L’Effort pour rendre l’autre fou (Gallimard, Paris, pp.157-174), dans lequel Harold Searles analyse le « double bind » comme étant une des techniques de « désintégration », de meurtre psychique de l’autre, exacerbant chez lui les « conflits affectifs ». Searles parle aussi de la technique consistant à « passer brusquement d’une longueur d’onde affective à une autre ». C’est justement ce que fait le protagoniste du film de Petri. Il change constamment d’humeur, faisant alterner sans transition les éreintements aux aménités, les vociférations aux silences.
5) Médusé, vraisemblablement pas parce qu’il apprend que son collègue est un criminel, mais parce que celui-ci a rompu un silence consensuel. Les enquêteurs connaissent la vérité et ont ouvert une enquête sur le chef du Bureau politique, mais comme malgré eux.
6) Et la citation de Kafka, détournée par Petri et apparaissant sur la dernière image du film, n’a pas pour fonction de dissiper le mystère (« Quelque impression qu’il fasse sur nous, il est un serviteur de la loi, donc lui appartient, et échappe au jugement humain »).
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).