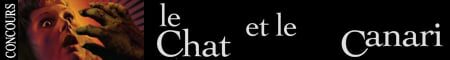Le programme de reprises en salles ou d’édition dvd de haut niveau continue en cette fin d’année et la découverte des quatre derniers films d’Akira Kurosawa restés inédits fait figure de véritable cadeau de noël avant l’heure. Hormis la qualité de la restauration, cette édition de Wild side contient des livrets avec deux textes toujours inspirés de Charles Tesson et des mises au point historiques tranchantes de Michael Lucken. De quoi appréhender ces films méconnus et proposés ici en deux digipacks : rose fuchsia pour la veine fraîche mais sombre du Plus dignement et plus printanière, gaie, nouvelle aussi, d’Un merveilleux dimanche. Le second, bleu marine pour les bleus à l’âme de Qui marche sur la queue du tigre et Je ne regrette rien de ma jeunesse. Ces œuvres de jeunesse où ne figurent donc pas La légende du grand judo et sa séquelle déjà édités depuis longtemps, témoignent du bouillonnement artistique du futur grand maître japonais avec des films imparfaits mais qui n’en passionneront que plus les amoureux du cinéma japonais parce qu’ils trouvent, mais aussi parce qu’ils nous promettent dans le dialogue qu’ils entretiennent avec bien des chefs d’œuvres ultérieurs.
Le cinéma de jeunesse de Kurosawa n’est pas encore totalement mu par cette logique d’opposition – juste un peu martiale et générationnelle chez Sugata Sanshiro ! – et qui structurera par la suite la dramaturgie de la plupart de ses récits. Mais ces quatre films font déjà mentir l’assertion de Yasuzo Masumura, le cinéaste de La bête aveugle qui résumait un peu brutalement que « conflits sentimentaux et autres drames intérieurs sont superflus »1 dans la progression de l’action kurosawienne. C’est même tout le contraire ici puisqu’on est en présence d’un cinéma étonnamment lacrymal. Et ce autant dans les personnages masculins que féminins si l’on songe au finale émouvant d’Un merveilleux dimanche et au désespoir contenu de Denjiro Okochi, le Benkei de Qui marche sur la queue du tigre. D’abord en temps de guerre, le refoulement est de rigueur… Mais Akira Kurosawa triche, car le groupe d’ouvrières exténuées du Plus dignement exprime une large palette de sentiments au sein desquels des larmes très patriotiques coulent allègrement au moindre départ. Ce premier film de la série ( le second du cinéaste donc ) et le troisième par ordre chronologique, Je ne regrette rien de ma jeunesse, se terminent tous deux sur l’image d’une pleureuse. Les sanglots étouffés de Watanabe ( qui porte le même patronyme que le héros d’Ikiru / Vivre ), la meneuse du groupe des jeunes ouvrières de l’usine d’optique, viennent contredire l’image d’un sacrifice un peu trop facile ( elle choisit de ne pas arrêter le travail pour se rendre aux funérailles de sa mère, comme le fera à son tour Kurosawa quand son père décède pendant le tournage de L’ange ivre ). Comme les pleurs de Yukie, l’héroïne de Je ne regrette rien de ma jeunesse, effondrée devant une image du passé, plan terminal qui dément un titre qui devint avec le succès du film, une phrase à la mode de ce Japon dévasté par la guerre. Dans trois de ces scénarios, à héros multiples mais nettement marqués au féminin, Kurosawa met pourtant beaucoup de lui même, particulièrement dans Le plus dignement qu’il a signé. Ce film nationaliste reste pourtant de toute sa carrière un de ceux qui lui tiennent le plus à cœur. En premier lieu parce qu’il lui a permis de rencontrer sa future femme, l’actrice Yoko Yaguchi ( Watanabe, mais aussi comme à l’écran, la déléguée des comédiennes qu’il devra affronter tout au long du tournage ).

Dans ce contexte ultra belliqueux, choisir de peindre les bases arrières et la solidarité de l’ensemble de la société civile avec les hommes au front plutôt que les combats, peut surprendre. L’Auteur obéit néanmoins scrupuleusement aux règles de la propagande comme au contexte, puisqu’à partir de 1943, de nouveaux sujets réapparaissent pour désengorger les écrans d’un trop plein de films de guerre. En particulier dans le créneau mélodramatique, la vogue des films de mères ( un exemple : Les quatre mères ) où il est de bon ton de pleurer la perte d’un fils parti trop tôt et qui n’aura pas l’honneur de pouvoir se battre pour son pays. Un des thèmes inattendu du Plus dignement, c’est la revendication égalitaire de ces filles au travers d’une augmentation de la productivité imposée par les circonstances qui, scandale, n’exige d’elles que la moitié du rendement des hommes. Hors les commentaires amusés mais attendris des quelques mâles chargés de les encadrer, le film est vu du point de vue féminin et assez souvent sous l’angle collectif, quand le récit ne s’attache pas de temps à autre aux petits conflits, aux préoccupations de la responsable Watanabe ou de leur institutrice, concernées plus que tout autre par leur devenir et la santé morale et physique du groupe. Pour ce faire, AK constitue un véritable groupe de vie, hébergé en foyer lui aussi, bien évidemment sous alimenté comme l’ensemble de l’équipe et de la population japonaise en cette dernière partie de la guerre. Il les envoie d’abord travailler en usine, puis soude son groupe par la pratique de la musique et des défilés militaires quotidiens. Après tant d’énergie générée ( et même une véritable productivité au service des forces armées ), il n’a plus qu’à capter des situations réelles sur un mode semi-documentaire, une fois ôtés « l’odeur du maquillage, la pose, les affectations de la scène, cette conscience particulière d’eux-mêmes qui est propre aux acteurs ».2 Une expérience si intense que la plupart des comédiennes renonceront à leur carrière à l’issue du tournage ainsi que s’en vanterait presque le cinéaste exagérant son mauvais caractère.
La femme japonaise s’affirme donc très tôt chez le catalogué « viril » Kurosawa et elle devient même avec la Yukie de Je ne regrette rien de ma jeunesse, la première figure héroïque propre à l’auteur de Yojimbo. A la base récit de jeunesse d’un trio d’étudiants balayé par les événements de l’Histoire, la trame va à marche forcée et larges ellipses, traverser l’histoire japonaise la plus sombre, pour insister sur les choix politiques de Yukie devenant in extremis une pasionaria digne du futur cinéma maoïste ! Envers de cette Watanabe s’interdisant tout jugement personnel sur les situations, cette belle héroïne de mélodrame, de prime abord anticommuniste frivole, se dépouille au fur et à mesure de ses contradictions et de ses vices jusqu’à se trouver indigne de ce Noge dont elle admire et fantasme les activités politiques occultes. Le scénario d’Eijiro Hisaita est aussi marqué à gauche que l’était cet écrivain. Il exalte cette libération de la femme qui par son émancipation hors de la cellule familiale, transcendera le carcan du mariage à force de courage et de réflexion individuelle et promouvra l’émancipation des paysans. Il est aussi pétri de contradictions, cette prise de conscience passant par une phase de régression exprimée dans le retour au costume traditionnel et le changement d’une Yukie soumise aux circonstances quand plus jeune elle était si sarcastique. Mais il exprime bien le désarroi s’emparant de toute la gauche japonaise, alors engagée malgré elle dans la guerre pour soutenir son pays ( un phénomène qui n’est pas spécifiquement japonais…). Michael Lucken définit Je ne regrette rien de ma jeunesse comme un « film de réconciliation nationale ».3 Basé sur des faits historiques emblématiques (un conflit à l’université de 1932 à 1933 dit incident de Takigawa et une affaire d’espionnage autour de Hotsumi Ozaki, le seul japonais à avoir été pendu pour trahison ), il enjolive une résistance alors anémique. D’ailleurs il ne la traite pas vraiment, voir la rend douteuse, y faisant de vagues allusions en dépeignant la vie rangée de Noge depuis son incarcération jusqu’à une scène subite d’arrestation. Le scénario ne charge pas non plus le personnage d’Itokawa, le plus rangé et face obscure du trio, dont la fonction répressive de magistrat et son rôle actif sont laissés dans l’ombre.
Kurosawa choisit donc de privilégier l’histoire sentimentale au détriment d’un affrontement violent façon L’armée des ombres. C’est par l’expérience intime qu’il entend en effet parler à tous les japonais et pas en édifiant un mythe à partir de faits obscurs et trop isolés, à la manière élégiaque des pays vainqueurs ou libérés. Pourtant le lyrisme de la dernière partie tranche avec la pudeur du reste du métrage, même vu à travers le prisme d’esthétiques différentes. En réalité, le scénario a été très critiqué et remanié par un comité de censure dominé par les communistes. Kurosawa, furieux des modifications, choisit alors d’exagérer délibérément la mise en scène de la dernière partie d’où ce résultat hybride mais sidérant. L’héroïne y abandonne son existence urbaine et bourgeoise pour prouver à ses beaux-parents paysans que leur fils n’était en rien ce traître exécuté en prison et traîné dans la boue dans tout le pays. Que le cinéaste se permette de critiquer la méchanceté de paysans ostracisant alors ses parents, étonne en pleine épuration du cinéma japonais et de la part de quelqu’un ayant activement soutenu le régime militaire et ses principes. Mais le scénario d’Hisaita montre bien la complexité des rapports humains pris entre participation générale au conflit et les coutumes ou manières de pensée traditionnelles. Setsuko Hara, décidément le visage féminin le plus fort du cinéma japonais, elle qui a été l’icône de la guerre depuis la fin des années 30 ( La fille du samouraï, coréalisé par Arnold Franck en coproduction mais en réalité, en incompréhension mutuelle avec l’Allemagne nazie d’où une version japonaise rebaptisée La nouvelle terre ) est le double d’un cinéaste en train de se métamorphoser.
Moins en première ligne que dans Je ne regrette pas ma jeunesse, la femme est encore le cœur battant d’Un merveilleux dimanche, et pour aussi symbolique qu’il soit, le déguisement de porteuse du seigneur Yoshitsune dans Qui marche sur la queue du tigre, est l’incarnation du refus du présent insupportable de la défaite comme un regard sur un passé pas si glorieux. Il y a même ici, en pleine ère du Deishin sodoin ou mobilisation spirituelle, un discours sur l’identité, prise entre essence et apparence ( qui se dédouble sur l’ensemble des visages de ce drame historique ) et qui reviendra partout chez Kurosawa, dont le cinéma est d’emblée des plus volontaristes et fait preuve du même engagement quelque soit la couleur politique du film. Après tout, la souffrance est initiation. Mieux, elle rend adulte comme le fut pour Kurosawa la mort prématurée de son frère.
La réputation humaniste qui plane sur son œuvre n’empêche donc en rien la propagande panasiatique et guerrière extrêmement violente du Plus dignement. « Frappons l’ennemi et détruisons le ! » est le mot d’ordre de tout le cinéma japonais en guerre et soumis au Kokutaï, idéologie prônant l’excellence de l’essence nationale. C’est l’occasion pour Kurosawa de redécouvrir tous les arts traditionnels japonais, en particulier ce théâtre Nô dont il ignore tout. Autant d’esthétiques qui lui assurent la grandeur de l’âme japonaise et qu’il sublime dans des textes au service de la guerre et hélas sans ambiguïté : « Pureté de l’être, pureté du cœur des japonais confrontés aux situations ultimes ».4 Non seulement le bonheur individuel, la liberté ou l’amour étaient bannis des scénarios, mais c’est vraiment toute une profession qui a opéré un glissement à l’intérieur des limites tracées au sabre par la loi du cinéma de 1939 et par l’établissement en 1938 de la notion de Tenkô ou conversion idéologique ainsi que le rappelle Mathieu Capel.5
« Je suis bien entendu un pacifiste fervent. Mais aujourd’hui quel genre de justification cela pourrait-il fournir ? Une fois la guerre commencée je ne souhaitais rien d’autre que la victoire de mon pays. Je voulais même faire quelque chose pour cela. J’étais profondément persuadé que la défaite signifierait à la fois ma mort et celle de ma famille. Je croyais que mes proches, mes parents, mes voisins et bon nombre de mes compatriotes mourraient ensemble ». Mansaku Itami6
Comme ses collègues, Kurosawa soutient la guerre, se croit en guerre lui même ( « je me sentais comme un chef de section intrépide… »4 ) à la fois parce que le cinéma est son combat et parce qu’il joue comme ses actrices et son équipe, un rôle, celui de metteur en scène d’une fiction documentaire. En réalité, ce qui germe pendant la guerre ( et plastiquement, ce qui naît de ses images ) à l’instar de notre révolution nationale vichyssoise, c’est la rénovation de tout le cinéma japonais. Le plus dignement frappe par la qualité de sa mise en scène, la variété des plans et leur modernité, les tons et contrastes et ce qu’il montre de son sujet : « la vitalité et la beauté des gens au travail »,2 les chorégraphies et le dépouillement des gestes, les visages laissant affleurer l’émotion, toujours dans les limites imparties à la jeunesse, ce « front domestique » qui obligeait les jeunes à retenir toute aspiration. Son ciné-tract, ciselé comme les mécaniques de précision qui fabriquent les lentilles, effraie tant il est hanté par la peur de l’échec au moment même où de plus en plus de japonais comprennent qu’ils ne peuvent plus gagner la guerre. La chronologie des événements y est alors traitée en plans courts mais funèbres, des images de recueillement qui tranchent avec les défilés enjoués et naïfs. Bien qu’il ait maille à partir avec la censure, le cinéaste a pris un malin plaisir à monter une séquence en usine sur la marche Semper fidelis, composée par l’américain John Philip Souza, détail qui n’a pourtant pas fait tiquer leur rigorisme hystérique.
Qui marche sur la queue du tigre est tourné en remplacement d’un autre projet plus ambitieux de film historique qui achoppe sur le dénuement des productions en cette dernière année de conflit. Achevé après les bombes et la capitulation début septembre, il peut être vu comme une sorte de parabole de l’anéantissement. Un chef méritant du clan Minamoto est trahi par son propre frère le shogun Yoritomo et doit fuir avec ses vassaux déguisés en religieux, les Yamabushis, espérant passer clandestinement un poste frontière qui lui a eu vent du subterfuge. Le film s’ouvre sur un plan de montagne, – berceau spirituel des japonais – un des derniers avant le départ des américains puisque le nouveau bureau de censure, le SCAP ( Supreme Commander for the Allied Powers ) ira jusqu’à interdire la représentation du Fuji. Ici, c’est surtout l’éloge d’une servitude de type féodal qui tombe sous le coup de l’arrêté après que le projet ait été conspué par des censeurs japonais le jugeant « trop américain ». C’est que l’interprétation que Kurosawa donne de la pièce fait débat au Japon comme outre Atlantique. Qui marche sur la queue du tigre paraît en réalité extrêmement complexe de par ses références intertextuelles entre la pièce Nô Ataka et celle célèbre du kabuki Kanjinsho ( La liste de souscription, connue des tous les japonais ), toutes deux basées sur un fait historique du 12ème siècle. Selon Mitsuhiro Yoshimoto,7 Kurosawa ferait ici un commentaire critique sur la relation du cinéma japonais au Kabuki, en soulignant certaines scènes par le dynamisme de sa forme. Non seulement il entretient ici suspense dramatique et évolution chorégraphique par des moyens contemporains, mais surtout il ajoute un prologue et un épilogue en deux parties, afin de créer le rôle du porteur pour le comédien ultra populaire Enoken ( Enomoto Ken’ichi ). Pour Donald Ritchie,8 l’apparition de ce personnage transforme le sens de la pièce originelle. Un crépuscule des dieux raconté à travers les yeux de cette sorte de benshi contemporain, ces commentateurs des films muets dont fit partie le frère de Kurosawa, Goro, avant son suicide au début du parlant. Citée également par Rachael Hutchinson, Keiko Mc Donald9 ajoute qu’au delà de la parodie, Kurosawa joue de façon réfléchie sur les détails spécifiques aux textes originaux pour mieux s’écarter de la formule des films de l’époque, tous basés sur cette loyauté féodale. Il enrichit ainsi la lecture traditionnelle de la pièce en insistant sur la valeur humaine bien plus que sur la simple place de l’individu au sein de la société hiérarchisée.
Même si l’on ne dispose pas de tous les codes et grilles de lecture et qu’il convient en conséquence de rester prudent, il est acquis que dans la foulée du martial et philosophique Sugata Sanshiro, le film délivre un message dans la veine du kokumin eiga, le cinéma citoyen. Il s’agit de boire la coupe jusqu’à la lie comme Benkei le saké amer de l’humiliation et de savoir faire profil bas, au niveau impérial comme pour tous les japonais. Et in fine pour l’Auteur lui-même… De fait, si Michael Lucken3 note que Benkei, le vassal devenu moine, est une sorte d’autoportrait du cinéaste ( il est ici celui qui a le pouvoir d’inventer des mots et par eux, des images ), on retrouve aussi Kurosawa dans le rôle du porteur, observateur sarcastique commentant un état de fait ( le Japon est en grand danger ) pour survivre et témoigner ( résistez à l’humiliation suprême et l’âme japonaise survivra ). Au premier degré, la pièce exalte la ruse ( cet art du camouflage et de l’embuscade que le cinéma chinois prête en général aux ninjas japonais ) plutôt que le sacrifice ultime pour sauver le représentant du pouvoir. Bien que Mac Arthur soit acquis à la sauvegarde de l’institution impériale, le film sera néanmoins interdit comme les autres films historiques ( et n’oublions pas quelques 250 films anciens réduits en cendres ! ) toujours à cause de la vassalité qui lie Yoshitsune à Benkei, même si l’admiration que le porteur – l’opinion publique – porte au groupe n’est pas si différente. Mais c’est la complexité de la situation due au travestissement des fugitifs qui révèle la question au centre de ce film important: Que faut-il abdiquer pour survivre ? D’abord, l’idée de ce chef suprême intouchable, immortel et pour lequel tous les japonais sont prêts à mourir, en acceptant qu’il devienne peut-être un porteur anonyme au sein du tissu social. Une œuvre métaphysique et éminemment personnelle qui comme plus tard chez le maître, contient une longue exposition et ce déroulement dans un lieu ( presque ) unique et clos où « l’espace se dilate et constitue un grand cercle » qui unit les protagonistes. Pas de fuite possible nous dit Deleuze mais « une exploration des bas-fonds en même temps qu’une exposition des sommets pour dessiner ce cercle de la grande forme, traversé latéralement par un diamètre où se tient et se meut le héros ».10 Ce Qui marche sur la queue du tigre, trop libre pour contenter la moindre autorité, se révèle l’œuvre la plus fascinante de cette ultime salve éditoriale.
« La défaite, jour de vérité et de liberté retrouvée ».2
L’armistice est pour l’industrie cinématographique japonaise l’occasion de passer du cinéma comme arme secrète au cinéma spectacle, sur fond d’occupation, d’épuration, de grèves violentes et de ces méthodes de Yakuzas qui régissent la concurrence effrénée entre les studios. Les mauvaises langues remarqueront que des deux premiers films aux deux suivants, Kurosawa a arrêté d’écrire ses scénarios, ce qui n’est pas tout à fait exact puisque Un merveilleux dimanche est un projet quasi autobiographique ( il s’est marié dans de très mauvaises conditions à l’époque des bombardements massifs et les époux ont subi eux aussi cette précarité ). Il en a fixé les grandes lignes avant de le confier à Keinosuke Uekusa, participant à tous les stades de l’écriture. Rien d’étonnant à ce qu’il soit aussi critique et y pourfende les profiteurs de guerre. « Un mauvais soldat ça réussit bien » lâche Yuso à propos d’un ancien camarade de régiment devenu en façade patron de cabaret , plus vraisemblablement caïd local. Yukie pose très directement la question « Qui peut juger ? ». Elle fait écho à la tribune de Manzaku Itami, appartenant au groupe des « cinéastes libres » chargés de désigner les membres de la profession par trop compromis, mais qui s’en désolidarisera en publiant un texte où il demande « Qui diable serait qualifié pour en fixer les critères ? ».6 Kurosawa peut désormais faire retour, un retour partial mais éloquent sur ce passé proche, grâce au sous-entendu de Je ne regrette rien de ma jeunesse où la ferveur étudiante se transforme en un coup de baguette plus fasciste que magique, en défilé militaire des mêmes groupes de jeunes. La conscience politique individuelle s’est alors enfuie dans la collure… C’est aussi l’expression d’une normalisation en vigueur en 1946 et qui sonne l’heure de l’hommage, aussi didactique que possible et en épargnant la clique militaro-industrielle, aux antimilitaristes. Kurosawa appuie par contre le personnage très secondaire du flic incarné par un Takashi Shimura à la lippe agressive. Mais à travers les débats enflammés du trio durant les luttes politiques d’avant-guerre, il remet à l’honneur la dialectique entre deux conceptions du Japon encore d’actualité. Yukie excitée par le bruit des bottes pose une question, si brûlante à la Toho au moment du tournage : « Rouge ou pas rouge ? ». Outil de conciliation, le film de Kurosawa permet à sa génération de faire son mea culpa. Désormais, il adhère avec enthousiasme aux nouveaux mots d’ordre.
«Je me rendais compte que si l’on ne faisait pas de l’individu une valeur positive, il ne pouvait y avoir ni liberté, ni démocratie ».2
Déjà les ouvrières du Plus dignement peaufinaient sans le savoir son œil intérieur dans la scène onirique de l’avion en feu ciblé par la lentille défectueuse de Watanabe. Alors que paradoxalement elles n’existent qu’en tant que groupe, une lumière intérieure y émane des protagonistes, celle de l’amour que le cinéaste porte à leur dévouement. De cette ferveur nationale, Kurosawa entre dans une longue introspection vers la recherche d’une connaissance que le héros de Madadayo n’est toujours pas sur d’avoir atteint au seuil ultime de l’existence. Même si cela relève plus d’une expérience familiale et personnelle que d’une généralité, Kurosawa reste convaincu que « le japonais considère l’affirmation de soi comme immorale et le sacrifice personnel comme une façon raisonnable de conduire sa vie ».2
D’où ce chœur féminin où les jeunes filles chantent autour de la maîtresse comme les pétales d’une fleur, les rires et les mouvements de tête au diapason pour exprimer une pensée commune, celle de ces « jeunes feuillages » sur une même branche, au sein d’un même arbre, ce Japon alors coupé de ses racines universelles, ces arbres de la forêt impériale de Qui marche que AK filme en guerriers toujours debout par de beaux panoramiques en contre plongée. Si Michael Lucken voit dans cette « fusion organique de l’individu dans le groupe » une volonté de spiritualiser l’effort plus qu’une tendance naturelle, il reste que cet ensemble de films dégage un sens de la responsabilité individuelle envers le collectif. Pour la personne comme Watanabe qui tente de s’annihiler dans le dépassement sans pouvoir échapper à la fatigue ou à la tristesse, comme au sein de la famille de Yukie et cette figure paternelle mise au ban de l’Université, puis celle de Noge et enfin, de façon plus émouvante encore, comme le couple d’Un merveilleux dimanche ( Masako, déchirée entre dignité et dévouement ). La scène où l’orphelin insiste pour leur acheter leurs boulettes de riz rend compte de la complexité de ces obligations sociales biaisées par une compassion relative entre miséreux. Elle renvoie en outre aux droits de l’enfant des rues dans le néo-réalisme, à cette lucidité douloureuse mais aussi à un instinct qui refuse tout apitoiement et par ce geste, annonce la réconciliation du monde avec lui-même.11 Même le groupe d’amis de Je ne regrette rien de ma jeunesse le martèle : « La liberté c’est le fruit d’un combat, il faut être prêt à assumer ses responsabilités ». Un sentiment qui se faufile dans le lien transversal et alternatif du vassal au seigneur pour remonter au groupe organique des ouvrières, porteur de valeurs que Kurosawa dont l’esprit d’équipe dans le travail est renommé, gardera tout au long de sa carrière.
Autre caractéristique impropre à la doxa de l’occupation, la relation de maître à élève, cordon ombilical qui court tout au long de l’œuvre kurosawienne. « L’image salutaire d’une personne plus âgée enseignant à un jeune évoque toujours dans les films de Kurosawa de grands moments d’émotions »12 ainsi qu’il le confirme dans son autobiographie en narrant les retrouvailles avec son ancien maître d’école qui lui a écrit sa joie d’avoir découvert la réussite de son élève ( et de son ami d’enfance et scénariste ) au générique de fin d’un film. En plus de cette éducation qui a forgé sa culture et ses valeurs, il est aussi resté proche toute sa vie de son mentor Kajiro Yamamoto dont il fut l’assistant. En tant que tel, c’est le metteur en scène qui l’a le plus marqué, alors que pour le cinéphile d’aujourd’hui, il n’est que le responsable obscur de quelques films, parmi les plus bellicistes réalisés pendant la période. Ces relations d’allégeance se retrouvent dans ses personnages, où les maîtres se doivent de s’inliger les mêmes traitements que leurs élèves. Cette dépendance est moins d’origine féodale que bouddhique, une philosophie qui emplit tout le cinéma de Kurosawa. « La lentille est une métaphore de l’âme humaine. Sa transparence s’oppose aux reflets changeants et impurs du monde des apparences, elle est signe de foi, de non-résistance du moi, d’abandon aux événements, suivant une logique qui témoigne de l’héritage de la culture bouddhique ».3 Bien qu’il se considère lui-même d’un tempérament tumultueux face aux divers aléas, Kurosawa plie comme le bambou, suit les énergies de la terre, du récit et les entrelace avec les lignes de forces de l’univers. D’où également une attitude particulière devant la mort. Au contraire du cinéma de propagande habituel, Kurosawa n’en fait pas abstraction. Après l’avoir glorifiée ( la tentation du suicide de Qui marche, un sabre sur un autel dans Le plus dignement ), il l’accepte comme un de ces incidents qui rythment le temps qui passe et ce faisant, la dépasse.
Car son cinéma kinésique, lui-même en mouvement perpétuel et dans lequel les poses hiératiques de Ran ou Kagemusha ne sont que des respirations dans un tout beaucoup plus vaste, s’intègre à l’ordre cosmique hérité du kabuki. Charles Tesson rappelle « l’importance du jeu corporel chez Kurosawa comme tissu d’expressions des personnages où l’affect est souvent à fleur de peau ».13 C’est ici le cas de l’épaule fatiguée qui trahit Watanabe ou de cette démarche à la Sganarelle du porteur devenant danse sur chanson de geste et enfin de la différence d’attitude et de position sociale entre son accroupissement et l’assise méditative des samouraïs. Et bien entendu du ballet automatique des ouvrières du Plus dignement où « la substance dramatique s’abstrait momentanément dans un dessin ».5 On connaît depuis Rashomon ou Les sept samouraïs l’énergie tellurique qui jaillit dans la course de ses personnages. Si Kurosawa s’intéresse aux propriétés mécaniques d’un affrontement de forces, la manière dont les êtres parcourent la terre japonaise en tous sens suit les flux et reflux énergétiques. Pour le moment, le cinéaste les contient encore dans la douceur de pieds féminins foulant sous la lune la terre ancestrale, puis les laisse éclater à l’occasion de différentes représentations sportives ( matchs de volley joyeux des ouvrières espérant que le mouvement régénère le Qi des corps usés, partie de Base-ball avec les enfants d’Un merveilleux dimanche ), dans la danse du porteur vibrionnant ou les circonvolutions frénétiques de l’apprenti-sorcier Yuso.
Cette propension au burlesque n’est pas qu’innée, elle est même une obligation morale pour le jeune couple d’Un merveilleux dimanche, refusant de se laisser aller comme le gardien dépressif ayant trop longtemps vécu sous la férule et dans l’insalubrité. Mais chez Yuso, c’est surtout l’expression farfelue de sa capacité à rêver. Le langage de Kurosawa est proche des recettes du slapstick. L’humour passe dans la gestuelle clownesque d’Enoken, provoquant l’ire des censeurs japonais mais apportant une dimension picaresque au récit, qui sera plus tard maximisée dans La forteresse cachée. Mais s’il n’est pas canalisé par un mouvement d’ensemble ou des règles ( ou une idéologie…), l’emportement du corps finit par fatiguer, la réalité sociale étouffant la volonté à la fin de la Symphonie inachevée du Merveilleux dimanche. Même dans la prostration, la position des corps dans le plan soutient le vertige de la profondeur de champ lorsque les cols blancs et l’institutrice viennent annoncer à Watanabe le décès de sa mère. Une configuration plastique et dramatique que l’on retrouvera notamment dans ses films noirs ( Les salauds dorment en paix, Entre le ciel et l’enfer ).
Concombre de mer
Tu n’as ni queue
Ni tête.
Takahama Kyoshi ( 1874-1959 )
Alors que durant la guerre, le cinéma japonais fait de gros progrès techniques pour capter les mouvements de foule en expérimentant par exemple les mouvements à la grue ( Yamamoto ), la qualité de direction de ces myriades d’acteurs amateurs va être mise à profit dans le très productif mouvement néo-réaliste nippon. Cette exigence alliée à la variété de plans caractéristiques du Plus dignement débouche sur une tension dramatique et esthétique qui culmine dans le premier climax de Qui marche sur la queue du tigre aux travellings latéraux intenses. Chez Kurosawa, la forme bien qu’inféodée au fond, stimule l’énergie vitale. Lui qui se retrouve au cœur du processus de redynamisation du cinéma japonais de l’après-guerre embrasse naturellement le credo de ce nouveau réalisme : mouvement, légèreté, nouveauté.8 Peut-être aussi parce qu’il a pratiqué le kendo, il conçoit le cinéma comme un combat tournant inconsciemment autour de sa « chambre de calibrage ». Toute sa vie et son œuvre tendront vers ce jardin zen, espace souffle-qui ne part pas de l’individu mais y revient. Le premier degré de lecture se voit doublé d’un sens symbolique hérité du haïku. AK a d’ailleurs fait partie d’un club monté à la Toho et influencé par l’auteur moderne de la doctrine Fleurs, Oiseaux et Suggestion dans la poésie, Kyoshi Takahama. D’où l’importance des phénomènes climatiques comme partie intégrante de son monde diégétique avec ici les premières séquences pluvieuses qui inonderont ses films. La mémoire cinétique de Kurosawa affectionne aussi particulièrement les trains qui fendent l’espace ( au contraire du champ mental d’Ozu dont ils se retirent ) ou la rivière qui circonscrit le récit de Je ne regrette rien de ma jeunesse, l’irriguant de son onde. A l’inverse, cette très belle métaphore d’un ikebana déçu, trois fleurs qui flottent dans un baquet circulaire, symbolisant l’éphémère de l’harmonie entre les êtres dans un monde instable.
L’ébauche de scénographie dirige la mise en scène, à la fois dans le rapport des amants à l’hostilité de la ville et surtout dans ce finale traversé par une musique chassée à son tour par le vent d’automne, sous le regard de cet impressionnant fond de scène en forme d’oreille. Elle découle d’un art du paysage qui prend en compte deux principes fondamentaux de la peinture asiatique : le vide primordial et le souffle vital.10 « Il convient que les traits soient interrompus sans que le soit le souffle, que les formes soient discontinues sans que le soit l’esprit ».14 Des notions que l’on retrouve aussi dans les décors de Qui marche sur la queue du tigre et cette enceinte qui préfigure le dispositif de Kagemusha. Et ici, dans ce mélange d’extérieurs et de studio ( système D motivé par les budgets de misère et les diverses restrictions de l’occupant ) qui font naître une grande étrangeté poétique ( dont l’acmé sera la décharge de Dode’s kaden, qui est à Kurosawa ce qu’est Le champ de blé aux corbeaux pour Van Gogh ).
Cet art chorégraphique et scénographique se frotte dans une dialectique permanente à cet art du montage dans lequel Akira Kurosawa excelle ( il est considéré par ses équipiers comme l’un des meilleurs monteurs au monde ). Si « le film de Kurosawa s’écoule en quelques sortes le long des raccords »,15 le raccord crée donc la dynamique, jusqu’à l’étourdissement, un effet de suspension en bout de course folle au début de Je ne regrette rien de ma jeunesse pour cette belle séquence du pique-nique au mont Yoshida. Ici, cette suture dans le vif du mouvement célèbre avec une bouffée de nostalgie, la vie, l’amour et la liberté. A deux reprises, ce souvenir viendra nous titiller et il n’y a plus qu’à suivre l’envol de ces images-mouvements pour y retourner. Une liesse cinématique héritée d’Eisenstein et qu’on reconnaît encore dans les foules prolétariennes et fraternelles de Je ne regrette rien de ma jeunesse et même quand ces blocs mouvants n’ont plus que les pieds pour avancer dans Un merveilleux dimanche. Il faut citer les gros plans en rafale de Qui marche sur la queue du tigre en rupture avec tout le reste du récit et toujours revenir aux close up cathartiques du Plus dignement. Après les effets de répétition de ce même métrage sur le volley-ball, ce sont les gros plans d’enfants, tous différents et qui une fois croisés avec les regards extérieurs de Masako ou d’un jeune facteur, créent un effet de concentration comique dans la scène de base-ball d’Un merveilleux dimanche. « Tout l’art de l’exécution est dans les notations fragmentaires et les interruptions, bien que le but soit d’obtenir un résultat plénier ».14 Kurosawa sollicite aussi l’attention du spectateur en précédant sa réflexion ( le sac de Yukie dans Je ne regrette rien ). Bien sûr, la narration en est encore au stade de l’essai. Le flash back de la lentille paraîtra appuyé comme les faux raccords sur les réflexions de Noge naïfs – autre leg de l’avant-garde soviétique – d’autant que le cinéaste ne cherche pas à éviter des baisses de rythme certaines. Kurosawa monte au fur et à mesure qu’il tourne, d’où son usage parfois abusif de l’ellipse. Il est également attentif à la bande sonore car « le son digne de ce nom ne s’additionne pas simplement à l’image, il le multiplie »,16 d’où ces rires qui envahissent les rizières ou bruissent dans les arbres.
Rien ne dit
Dans le chant de la cigale
Qu’elle est près de sa fin.
Matsuo Bashõ ( 1644-1695 )
La musique, que Kurosawa n’utilise pas encore en contrepoint, fait de la scène dont elle est le sujet la séquence la plus puissante du meilleur des quatre films présentés. Le cinéaste y trouve une équivalence visuelle, spatiale, à leur Symphonie inachevée quand Yuso tente de recréer par l’imagination le concert auquel le couple n’a pu assister faute d’argent. Détail troublant du tournage, Isao Numasaki ( Yuso ) était « remarquablement dépourvu de sens musical » et « d’une imperméabilité totale aux qualités du son » !2 Il ne s’en exténue que mieux pendant que sous la bise glaciale et battue par la pluie d’automne, Masako continue de croire que ces tourbillons de feuilles mortes sont bien animés par des notes que l’on n’entend pas encore. Et Kurosawa d’organiser ses éléments en chef d’orchestre, l’invisible, l’attente, la puissance du rêve comme nourriture, sans jamais nous ôter de la bouche le goût âcre du désarroi. Il a l’idée folle qu’une Masako insurgée s’adresse à la caméra, à la fois au public de cinéma et à celui, absent, que seule sa foi matérialise aux pieds de leur chimère philharmonique. En imbriquant le spectateur dans la diégèse, l’Auteur introduit dès lors une réflexion sur le film en tant que médium. Ce plan répond à l’entame du film où l’on découvrait Masako, face contre vitre dans un train bondé. Une autre lentille pour scruter ce monde des apparences au microscope. En réalité, c’est à nous spectateur de passer le reste du long-métrage le nez dans une réalité sociale sordide dont nous aimerions bien nous extraire, espérant ce merveilleux auquel nous n’accédons que par la grâce d’amoureux du dimanche. Par ce prodige, le film est la plus touchante de ses professions de foi parce que jamais ni l’Auteur ni ses personnages ne baissent les bras. « L’homme cher à Kurosawa est fait de cette contradiction entre le visible de sa personne et l’invisible de son monde intérieur auquel il croit et qui l’enrichit » conclue Charles Tesson.13 C’est vrai, on ne devine pas les meubles qu’elle affabule quand ils visitent l’appartement bon marché. Par contre, ce qu’on aperçoit passer tout au fond, ce sont les représentations interdites et menaçantes de l’occupation ( les roues des camions militaires ) dans un contexte de délabrement chaplinien. L’idéalisme du couple est aussi revigorant que le souffle de la nuit post-atomique, mais prisonnier de ces cloisons japonaises coulissantes. Circulant de l’un à l’autre comme l’énergie sexuelle tantrique, il a la puissance des désirs inextinguibles et tous peuvent alors admirer le spectacle du bonheur, la « jacinthe, café populaire », et mieux qu’au cinéma, car chacun peut l’agrémenter à sa guise. Le scénario tout entier s’avère une joute poétique et amoureuse dont seul le temps imparti en titre épuise – temporairement – l’énergie. Mais l’œuvre ne consacre pas tant la victoire d’un jour d’un réel revanchard et pénible sur l’illusion cinématographique qu’il n’exhorte à créer dans le shoshimin eiga ( film sur la classe moyenne ), « de grands rêves » communautaires pour ce « nouveau Japon ».4 Cette fois à l’intérieur de codes politiques et esthétiques plus souples.
Si on s’intéresse habituellement plus aux indépendants qu’au cinéma des grands studios, la gestation de ces œuvres est profondément tributaire des tumultes de la compagnie auquel Kurosawa était attaché, cette Toho fondée par Ichizo Kobayashi. « Quant à Toho, il se lançait dans la production de films de romances généralement médiocres, de films de vaudeville et de comédies légères qui se révélèrent suffisamment commerciaux pour permettre à Toho d’attirer vers ses studios ses meilleurs artistes et techniciens des autres compagnies et suffisamment dépourvus d’idées pour valoir à la compagnie la sympathie des militaires qui venaient d’arriver au pouvoir ». 17 Imposée de façon violente avant-guerre comme un zaïbatsu, un super trust, elle voit à l’issue du conflit plusieurs de ses cadres condamnés et la direction confiée aux syndicats, d’où cette longue série de grèves qui compliquent des tournages encore précaires. C’est ainsi que Kurosawa tourne Je ne regrette rien de ma jeunesse entre les deux débrayages du début et de la fin 46, avec les déboires évoqués plus haut. Les oppositions politiques de plus en plus violentes conduisent la compagnie à une sécession qui voit la création en 1947 d’une Shin Toho dévolue aux stars quand la Toho restera elle, la compagnie des metteurs en scène. Après avoir échappé à l’épuration, Kurosawa ne sera pas non plus victime de la chasse aux communistes entamée en 1948, après le revirement brutal d’américains en plein Maccarthysme et qui feront alors tout pour briser ce mouvement syndical qu’ils ont enfanté. Une exclusion qui amènera nombre de cinéastes engagés à fonder des coopératives indépendantes qui prendront une part importante dans la renaissance du cinéma japonais et sa reconnaissance dans les festivals internationaux. Alors que d’autres bataillent pour porter à l’écran les premiers baisers du cinéma japonais, Akira Kurosawa va se laisser hypnotiser par L’ange ivre Toshiro Mifune.
Si les générations précédentes de japonais ont du embrasser violemment la modernité, le cinéma ainsi que le remarquait Tadao Sato est particulièrement sensible aux changements d’époque. Sans vouloir avaler ni éluder une vision orientaliste du cinéma nippon qui analyse l’œuvre par sa manière de s’approprier le langage occidental pour traiter de thématiques purement japonaises, force est de constater que les films de jeunesse présentés ici traversent et parfois transcendent les styles : film de propagande, jidai geki passéiste, néo-réalisme hanté par cette lumière blanchâtre d’après la bombe, avec son temps de chien ( pas encore enragé ) qui glace les survivants et leur donne ces postures à la De Sica ou ce galurin déformé de chez Capra modèle grandes crises. Expressionnisme de ruines reconstituées en studio, aussi stylisées que le seront celles de La barrière de chair de Suzuki vingt ans plus tard ou atmosphère de film noir le long d’un travelling dans les geôles de la police secrète. Les héros de Kurosawa transfigurés par sa caméra cachée égarée à Shinjuku s’enracinent dans ces tumultes au moment où « tout le monde souffre, c’est l’époque qui veut ça ». Autant de « porcs dans la cage aux fauves » pour décrire son pays à l’instant de la révélation de cet autre, l’occidental. Mais au delà de la structure politique de ses films, des audaces formelles, de l’appropriation des codes ou de la transmission – révision d’une culture traditionnelle, Kurosawa effectue avant tout, une opération simple mais nécessaire : un retour sur soi.
________________________
Les éditions proposées par Wild Side proposent un sacré travail de restauration plus visible encore sur les blu-ray. Le grain de l’image est conservé tout en éliminant un maximum de rayures. C’est visible sur Un merveilleux dimanche, offrant une netteté et des contrastes impressionnants mais peut-être encore plus flagrant sur Plus dignement… où ressort la beauté des visages comme on ne les avait jamais vus, privés de ce voile souvent trop présent dans les œuvres de cette période. On en vient à rêver alors d’une édition des Contes de la lune vague après la pluie débarrassée enfin de tout son vieillissement. Je ne regrette rien de ma jeunesse et Qui marche sur la queue du tigre ont peut-être été plus difficile à restaurer et l’image est un peu plus flou en particulier dans les scènes d’ensemble, mais la qualité reste tout à fait honorable. La condition optimale pour découvrir ces merveilles.
1 : Masumura Yasuzô : Sôdai ni shite hisô na eiga sakka Kurosawa Akira, in Fujii Hiroaki (dir.), Eiga kantoku Masumura Yasuzô no sekai, Wides Shuppan, Tokyo, 1999, p. 28. Texte original paru en 1974 dans la revue Kinema Junpô, cité in Mathieu Capel, Pathogénie d’Akira Kurosawa, Trafic, n°74, été 2010, P.O.L, p. 103-113.
2 : Akira Kurosawa : Comme une autobiographie, 1982, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma.
3 : Michaël Lucken, Livret Dvd.
4 : Akira Kurosawa : « Wakarikitta koto », Taikei Kurosawa Akira vol 1 cité par Michaël Lucken, livret Dvd.
5 : Mathieu Capel : De la pédagogie au spectacle – la propagande militariste à travers les films de guerre japonais 1933-1945 in Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Une histoire mondiale des cinémas de propagande, Nouveau monde éditions, 2008.
6 : Mansaku Itami : « Sensô sekininsha no mondai », in Eiga shunjû, premier numéro, Tokyo, août 1946.in Mathieu Capel : De la pédagogie au spectacle – la propagande militariste à travers les films de guerre japonais 1933-1945 in Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Une histoire mondiale des cinémas de propagande, Nouveau monde éditions, 2008.
7 : Mitsuhiro Yoshimoto : The difficulty of being radical : the discipline of film studies and post-colonial world order, Japan in the war, 1993 in Rachael Hutchinson : Orientalism or occidentalism ? Dynamics of appropriation in Akira Kurosawa.
8 : Donald Ritchie : Le cinéma japonais.
9: Keiko Mc Donald : Cinema East : a critical study of major japanese films, in Rachael Hutchinson : Orientalism or occidentalism ? Dynamics of appropriation in Akira Kurosawa. 1983, London associated press.
10 : Gilles Deleuze : L’image-mouvement, 1983.
11 : Yannick Lemarié : Les enfants dans le néoréalisme, Positif n°629, août 2013.
12 : Joan Mellen, Seven Samurai (BFI Classics), British Film Institute.
13 : Charles Tesson : Le réalisme et son double, in livret Dvd.
14 : François Cheng : Vide et plein, le langage pictural chinois, ed Seuil, in Gilles Deleuze : L’image-mouvement.
15 : Hiroshi Nezu, superviseur de production in Donald Ritchie : The Films of Akira Kurosawa, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, Reed 1984.
16 : entretien avec Michel Mesnil, juin 1965 in Michel Mesnil : Kurosawa, Seghers, 1973.
17 : SH et M Giuglaris : Le cinéma japonais (1896-1955), éditions du Cerf, 1955.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).